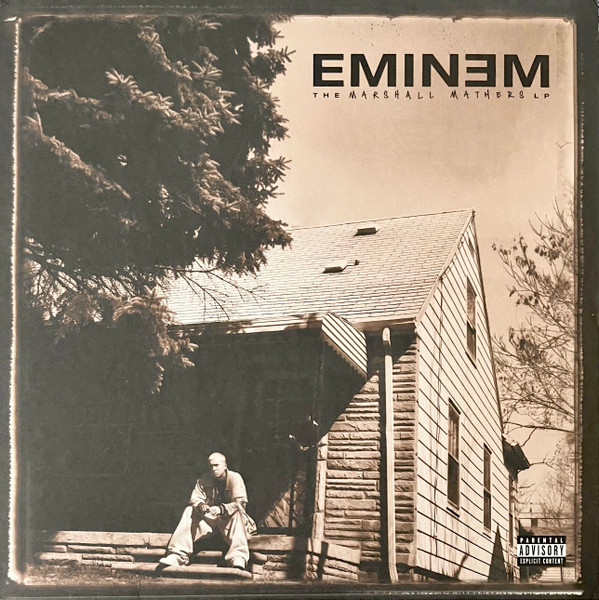Toujours le hasard qui nous porte, dans la même période, de grand monstre en grand monstre.
Avouons-le tout net : je ne nourris pas une passion insensée pour Led Zep. Je pense que c’est l’un des groupe les plus surévalués du rock, collectivement, ses membres pris individuellement se défendant dans leur domaine respectif. Je trouve en particulier John Bonham pénible à écouter sur la distance. Je trouve en général qu’au-delà de leurs qualités de musiciens, il y a une espèce de lourdeur qui n’est pas la maladresse du punk (car en effet, au contraire, ils sont adroits), mais précisément cet embryon de métal, à savoir une espèce de naturalisme forcené. Voilà : Page joue les notes qu’il joue, Jones arrange ce qu’il doit arranger et Plant chante ; il n’y a pas beaucoup d’espace à la fantaisie (contrairement à ce qu’il se passe chez les Who par exemple, doués des mêmes qualités et défauts, mais beaucoup plus… “frais”).
Bon, ceci étant posé, dans ma délirante revue des mille disques, quand Led Zep est passé sur le grill-platine, les résultats étaient conformes à mes impressions initiales : le quatrième disque, le “meilleur”, est 361e, le II 383e, le troisième 534e, Physical graffiti (qui est très lié à celui-ci)… 791e !
Quel est ce disque ? Âprement discuté par les critiques qui lui reprochent son décalage avec la première période, le manque de titre frappant et l’éparpillement hors du champ de lourd métal, ce sont précisément ces raisons, très certainement, qui le distinguent en qualité des autres albums… À dire la vérité, ça ne commence pas très très fort, mais on peut considérer que The song remains the same, espèce de compte-rendu et de point de la situation, fait la transition entre une première mouture du groupe et cette nouvelle ère qui s’ouvre après le IV. Et la seconde chanson montre cette voie nouvelle, car, pour s’identifier à l’univers, mettons, de Stairway to heaven, le gimmick de The rain song tâche d’expliquer la nouvelle formule.
Or si Dancing days offre un paysage sonore prometteur (et serré, et tenu, et sérieux), le sympathique Over the hills and far away n’amène rien de très nouveau sous le petit soleil de la lande à éricacées.
Mais surtout, surtout, les deux tentatives d’excursion en territoire étranger (donc en danger), le funk (?) pour The crunge, et le reggae (???) pour D’yer Mak’er sont des éclatades notoires : ni le son, ni la voix ne conviennent à ces exotismes (encore que les tentatives de clavier et que le ton de Plant pourraient inventer un truc original), mais surtout la batterie est hors-sujet total. Ça ne va pas, la frappe est trop lourde, les tentatives de syncopes sont téléphonées, les roulements grossiers… C’en est presque embarrassant (surtout si on se rappelle le traitement initial par les blancs du reggae de Paul Simon)…
En guise de conclusion, The ocean, qui est typiquement zeppelinien, finit par nous faire douter d’une quelconque possibilité d’évolution esthétique…


 $
$