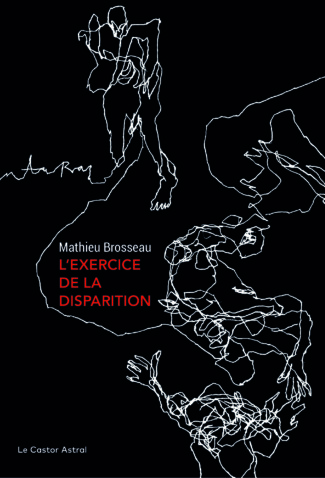Traductions de Codice siciliano de Stefano d’Arrigo, auteur de Horcynus orca, par Emanuela Schiano di Pepe & Benoît Vincent
Premiers cailloux, déposés là, dans une attente furtive, mais lucide ; pouls lézardin dans le soleil, la mer.
Ils avaient été guerriers avec les Dieux,
depuis dix ans mes amis, marins
que je suivais dans les vers d’Homère
sur la mer Peloro comme le vin,
où le jour une voix de sein attrapait
les faveurs du vent,
la vie de mes compagnons et la mienne.
La voix, sa voix qui nous appelle
les nuits de lune dans le détroit,
quand on entend les pleurs des dauphins,
s’atténuant enfin contre nos poitrines,
c’est celle de la soupirante couveuse
qui berçait en mer avec mollesse,
elle, mère-magicienne qui erre dans la demeure
elle a un ventre doré, elle est une Pléiade.
Peut-être la femme est la foi dans la demeure
sa silhouette tisse et détisse
perpétuité d’une sirène
peut-être une fée Morgane dans cette demeure,
de pièce en pièce dans la mémoire de la mer,
au seuil de la fenêtre elle brode
autour de son désir, de son regard
cet homme, le père de ses enfants, contemplant
ému la fumée sur le toit.
À ce moment du voyage en Sicile
nous ne sommes encore jamais partis, nous sommes autour
d’un feu d’hiver, dans un parfum familier
de pommes et de figues de Barbarie,
on écoute la vie qui crépite
comme gemme dans l’œil de la mère.
Nous vivons en île comme en elysée,
avec le coq qui dans son bec
nous apporte la lumière
comme une proie délicieuse.
Ensemble nous palpitons dans un pays
que chacun reconnaît comme le sien,
du fait d’un arbre, d’un cœur dessiné,
d’une pensée ancienne inscrite dans le paysage,
souvenir d’une vue depuis le balcon.
Sous ce soleil nous avons germé
maintenant ce sont nos armures et épées,
dans la voix de notre dialecte
qui est miel sur nos blessures
et miel encore sur nos crocs.
Après dix ans au milieu du détroit,
nous hurlons la nostalgie
de ce visage qui tisse en élysée,
du chien qui sur le seuil nous attend
désormais juste pour mourir à nos pieds
dans un petit gémissement fidèle.
Nous en sommes là, où l’on meurt
de soudaine douceur domestique,
si la dépouille d’un cri dans le détroit
se lève par la voix d’une sirène et clame
dans le soir notre nom aux enchères,
femme depuis cette rambarde de parfums,
jasmin, basilic, en Sicile.
Ici, où je me ressemble, ici au pays,
dans les prés désormais en cendres d’Homère,
moi rescapé d’une guerre, et de tant de guerres,
un grand fils me rappelle ma mère
perdu l’écu sur l’écu,
je voudrais revenir côte à côte
avec mes amis marins qui entrent
toujours plus dans les vers, dans la mer.

 Albino Crovetto est né à Gênes en 1960. Il est photographe et traducteur. Il a publié deux recueils de poèmes : Una zona fredda (Niebo-La Vita Felice, 2004) et Imposizioni, Genova (Il Canneto Editore, 2011), les deux avec une préface de Milo de Angelis. Il a traduit entre autres : Dumas père, Mirbeau, Jaccottet (avec Ida Merello), Régnier, Volodine, Flaubert (avec Emanuela Schiano di Pepe), Judith Gautier.
Albino Crovetto est né à Gênes en 1960. Il est photographe et traducteur. Il a publié deux recueils de poèmes : Una zona fredda (Niebo-La Vita Felice, 2004) et Imposizioni, Genova (Il Canneto Editore, 2011), les deux avec une préface de Milo de Angelis. Il a traduit entre autres : Dumas père, Mirbeau, Jaccottet (avec Ida Merello), Régnier, Volodine, Flaubert (avec Emanuela Schiano di Pepe), Judith Gautier.