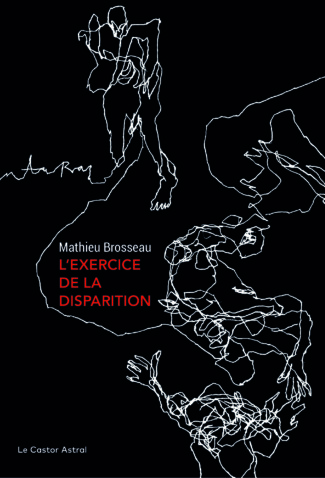Pourquoi chaque matin quand je m’éveille, que je vois les premières lueurs du jour, je pense à une aurore future où je n’aurais plus la force nécessaire pour me lever ? Je me demande comment s’impose en douceur dans mon corps tout entier la paresse de vivre. Seule l’ivresse de la mémoire et de ses incohérences me fait oublier l’inertie comme si la déambulation n’était plus qu’un rêve de voyage dans le temps. Quelques fourmillements dans mes pieds me rappellent que je pourrais peut-être marcher. Les chants d’oiseaux commencent, leur cacophonie chasse le silence de la nuit. Je ne sens plus l’épaisseur de mon ventre. Aurais-je perdu toute sensation de mon volume ? J’ai toujours aimé faire semblant de perdre le centre de gravité de mon corps pour tenter de le retrouver à partir de repères extérieurs. Sans un quelconque recours à ma volonté comme si mon équilibre était en train de naître.
Quand le froid provoque le désir de ne plus bouger sous les couvertures, la chaleur naissante se lie à la fainéantise qui finit par anéantir l’intention de « faire un geste ». Cette parésie morcelle mon corps, endormant les réactions musculaires de ses membres. Imitant une progression de l’impavidité, elle assure le rythme d’un contretemps à la somnolence. Je peux alors divaguer comme un fou, je viens enfin de perdre l’esprit, ni le temps ni l’espace ne m’imposent leurs limites. Si la mort était représentée par cet état du corps, n’importe qui serait tenté de « passer l’arme à gauche », ne serait-ce que pour goûter les délices d’une attente sans lendemain. Flotter et ne point se soucier de se redresser. Fermer les yeux. Ou les ouvrir. Dans l’indifférence à la cécité.
Le monde se compose des images du moment, et celles-ci, je ne les vois même pas venir, elles se donnent l’air d’être toujours déjà là. Je ne les reconnais pas pour autant, ce sont elles qui me signalent avoir déjà rencontré mon regard. J’ai même l’impression qu’elles me font des « clins d’œil », qu’elles cherchent de toute évidence ma complicité. Tandis que de légères crampes s’évanouissent dans mes jambes, peu à peu elles font naître le monde en s’ordonnant pour m’offrir l’apparence d’un récit. A l’arrêt, mon cœur bat plus vite, son agitation excessive vient curieusement de l’immobilité de mon corps. Est-ce l’absence d’intention de « faire un geste » qui l’énerve ? La violence interne de son dérèglement me rend plus léthargique encore, je ne bouge plus, j’écoute l’écho de ses battements accélérés qui résonnent dans ma poitrine. Les images ont brusquement disparu, sans même laisser de traces, ne reste plus que le bruit sourd de cette arythmie cardiaque pour me rappeler à la vie.
Où puis-je aller si je ne peux fermer les paupières pour partir ? Rêver la douceur de l’absence quand celle-ci chasse les désagréments de la parésie. Le lointain ne se représente pas. Le lointain rend pêle-mêle les points de fuite. Et la perspective inversée fait tomber les objets. Retrouver le sens de la vision à partir du plafond blanc, chercher une lézarde aussi infime soit-elle, comme une inscription sur la page blanche. Revenir au rien qui fait naître l’image. Dans le ciel, en contre-haut de la fenêtre, une nouvelle lueur, signe des atermoiements de l’aube.
Une forme qui avance, une forme qui prend consistance en se rapprochant. Rupture immédiate de la vision, la forme s’évanouit, devient une ombre animale qui s’évapore à la lumière. Le désir fou de ne pas se lever, de rester « cloué au lit », de s’abandonner à l’impossibilité mentale de « sortir du lit », de somnoler sans fin à contretemps. Je m’imagine revenir du « royaume des morts », faire quelques pas autour de mon lit comme si j’apprenais à marcher. Par la fenêtre de gauche, je vois les traces d’autres ombres nocturnes en train de disparaître, j’entends l’écho d’une voix macabre interrompue par des cris d’enfant, tels de joyeux contrepoints qui se mettent à rythmer mon souffle en chassant les ultimes esquisses d’un râle. Avant de sortir de la nuit, j’ai eu l’impression de traverser un champ de ruines majestueuses dont les hauteurs variées évoquaient des pics de cathédrales restées longtemps englouties par la mer. Pourquoi je m’acharne à construire encore un tableau avant d’ouvrir les yeux, avant de voir le jour ? Serais-je en mesure de combler le vide avec des images pour faire exister le monde ? Pouvoir inutile puisque le monde n’a pas besoin de moi pour exister.
Franchir cette porte, aller de « l’autre côté », revenir sur mes pas, se laisser prendre au piège attendu de la raison qui ordonne un sens. Et les paupières se ferment sur un glapissement saugrenu. Le jeu n’en vaut pas la chandelle. Il faudra recommencer. Il y a de moins en moins de coqs pour chanter l’aurore. Les scènes des années de l’enfance prennent l’allure d’un futur déjà passé. Elles reconstituent leurs propres détails puisque rien n’a été oublié, elles fabriquent le décor de ce qui est advenu pour demain. Un futur à l’envers, un futur qui ne s’épuise jamais à rétablir l’ordre des choses.
C’est la campagne de France, 1815, quelques grenadiers de Napoléon se sont réfugiés dans le jardin pour bivouaquer. Un artiste peint un tableau à côté de mon lit, il a posé son chevalet près de la grande armoire. Il vient de se tourner vers moi, il dresse son bras droit, écarte son index et son pouce, se met en posture d’évaluer à distance, la mesure de ma tête, je me soulève, j’aperçois la forme de mon visage près d’un brigadier qui tient un mousqueton, je ne veux pas entrer dans l’Histoire, il faudrait que je parvienne à le lui dire, à cet artiste qui ne m’a pas demandé mon avis. J’ai cru aimer le Petit Caporal. L’amour en masse appelle la mort en masse. A l’époque, il y avait de la neige partout dans la campagne. Je m’oblige à commencer par dire « à l’époque » pour éviter la confusion. Est-ce une manière de se donner l’impression de « remonter le temps » alors qu’en remontant le mécanisme d’une horloge, on perpétue le temps, on assure sa durée. Le peintre m’a fait un nez trop gros. Je ne l’apprécie pas. Je vois bien qu’il n’a pas l’intention de rectifier ce que je considère comme une erreur intentionnelle. Pourquoi le peintre se moquerait-il de moi ? L’image disparaît brusquement comme un cliché retiré de ma vue par une main inconnue.
Je chasse l’idée qui s’impose selon laquelle je pourrais ne plus me lever, ne plus mettre mes deux pieds sur le plancher. Je la chasse parce qu’elle me retire le plaisir d’imaginer que ma position horizontale est identique à ma position verticale. Chaque fois que j’ai vu un lit placard, j’ai pensé que s’il ne s’ouvrait pas, c’était le mur qui, de l’autre côté, s’abaissait. Le cœur de la question – la conquête de l’indistinction entre le vertical et l’horizontal -, n’était autre que « l’évanescence de la charge pondérale », le lit se renversant pour retrouver sa position initiale. Seuls les plus gros sont naturellement prédestinés à vivre une telle expérience.
Quand je me lève la nuit pour aller dans la salle de bain, je traverse le couloir de l’antichambre, et chaque fois dans la pénombre, avant de pousser la porte, je tourne la tête vers une sculpture sous cloche posée sur un meuble adossé au mur, je suis persuadé qu’elle m’observe, je crois même qu’elle m’interpelle. Je sors un instant après, je la revois de face, toujours inquiétante avec cette tête de femme en folie et sa robe bouffante. Il m’arrive d’avoir la brusque certitude de pouvoir m’écrouler là sur le champ, d’agoniser sans réussir à pousser un cri. Ma femme m’a avoué un jour que cette sculpture en terre cuite, elle l’avait conçue au moment où elle allait au plus mal dans sa vie, en ce moment où elle avait cru perdre mon amour pour elle. Croiser en pleine nuit l’expression du désespoir de l’abandon dans cette vaste antichambre ne peut que me donner l’envie de me réfugier dans mon lit et de nier le monde. Toute l’histoire du monde. Je n’ai plus alors le moindre désir d’ouvrir les yeux, le noir absolu absorbe les ombres de la mort.
Les ciels se succèdent, s’enchevêtrent pour s’évanouir à la lueur aveuglante de la lampe de chevet. Les couleurs de la nuit n’épousent pas toujours la couleur du temps dont on ignore le nom, elles la détournent et la contournent en s’étirant jusqu’à l’aurore. Apprivoiser la mort en lui souriant pour lui indiquer qu’elle doit me laisser aller plus loin. L’attendrir en lui montrant que je ne suis encore qu’un enfant. La convaincre de revenir plus tard sans prévenir. Elle n’a plus besoin de s’annoncer. Elle est trompée par des sourires qui me donnent la vie.
Elle, elle s’est mise à chanter « qui sera saura », j’entends sa voix légèrement rauque, pourquoi n’arriverais-je jamais à me représenter ce que peut être le timbre de sa parole ? Le sourire de sa voix, la vibration des mots, et les souffles effleurés des sons qui viennent de sa gorge endormie. Il me suffit de baisser les paupières pour entrer dans ses limbes organiques, paysage du vivant d’où naît l’aspiration. Reconnaître encore l’instant où le seuil de l’existence est précédé par une bouffée d’air salvatrice. Les mystères continueront à soulever des questions sans réponse, l’interrogation au rythme de son essoufflement retrouvera cette quiétude d’une sollicitation de la vie. Mais rien ne peut révéler ce qui est pourtant en mesure de l’être.