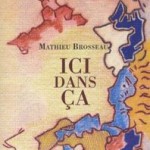Charles Fort-Vert est botaniste, spécialiste impliqué dans le domaine du végétal et de l’environnement. Sa pratique d’écriture trouve son inspiration principale dans la musique contemporaine ; en tant que sources secondaires, la géologie (roches, structures, couleurs, strates, reliefs…), la perception aromatique et la photographie artistique. L’écriture se concentre autour des mots et des lettres, point de départ et d’arrivée des textes, après leur voyage en lignes.
Avant-propos
Ce texte a été écrit d’octobre 1997 à mars 1998 à Mulhouse (Haut-Rhin). L’écriture a été générée par trois sources obligatoires et concomitantes :
— une muse inspiratrice (ici Lucile) ;
— un mot-clé choisi intuitivement, et son étymologie (étudiée avec l’aide du Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey) ;
— et une musique vécue (et non simplement écoutée), ressentie comme propice. Tout démarre du mot qui vibre par la muse et sur la musique. Seuls les deux textes initial et final ont pu s’affranchir de la musique.
Place aux mots qui animent et dominent le scribe.
1. Don bleu
Passionné des teintes, des couleurs, notamment naturelles, mais aussi de celles crées par l’homme sur le fil du temps, il avait un jour passé sa main dans les cheveux de Lucile, presque sans le vouloir, comme un peu absent, en photographe qu’il était, car ce blond et ce paille dans cette lumière incidente venue de l’arrière, par la main qui atténuait l’épaisseur de la chevelure, la présentait en mèches fines dans le soleil, se muaient en mille teintes voisines, des miels, odorants échos des forêts sombres ou reflets tilleul de fragiles parchemins, des bruyère et terre, fils, veines de merisier, traits de bruns, éclats de Sienne, et rideaux de fibres fines dont le lent glissement animé par sa main devant l’or de l’arkhe-machine solaire avait fait scintiller dans l’œil véronèse de Fordern des lumières profondes.
La main avait gagné l’épaule, puis ils s’étaient serrés l’un contre l’autre.
Vous m’intéressez vous !
Cette réaction à la fois volontaire et spontanée – le verbe, l’action bien enchâssée, bien corsetée entre deux incisifs “vous” — avait surpris Fordern.
Lucile était venue le voir dans le cadre de sa thèse. Elle recherchait des sources botaniques anciennes, liées à l’histoire de Mulhouse. Le sujet qui lui avait été confié conjointement par l’Université et l’École de Chimie de Mulhouse — la très ancienne école fondée en 1822 — s’attachait (s’attaquait) à l’histoire des colorants. C’était à Mulhouse que l’industrie des colorants artificiels était née, rupture avec un long passé d’utilisation des plantes, et aussi des terres (ocres et autres). Alizarine, garance, fuchsine, Mer Rouge… une ribambelle de mots colorés avaient depuis quelques mois investi le vocabulaire de Lucile, prolongeant et démultipliant sa passion naturelle pour les bleus sombres – nuit – Prusse – bleu-noir et autres pastels.
Fordern – on connaissait sa vieille passion pour la Botanique — était ravi, comme tout naturaliste, historien ou collectionneur,… d’exposer son savoir , même s’il demeurait conscient de ce fait et détestait l’érudition pour l’érudition , mais tentait toujours par volonté de pratiquer la connaissance dans l’optique d’un projet précis et construit.
Fordern avait donc indiqué à Lucile, aussitôt, sans se référer à des ouvrages, directement, du tac-au-tac, l’ensemble des sources qui lui seraient nécessaires.
Impressionnée par le discours de Fordern, son érudition accessible et ses incidentes prospectives ou anecdotiques, épiçant son verbe, Lucile l’avait recruté !
« Vous m’intéressez vous ! » Quelle formule ! La jeune femme n’avait pas froid aux yeux, pensa-t-il ; il ne put esquiver un sourire, signe qu’il avait aussi été séduit et amusé par cette mi-remarque, mi-proposition, mi-injonction de type jeune dirigeant, et surtout par l’attitude de Lucile lors de son intervention : la tête légèrement baissée en avant, les mèches miel et paille de sa chevelure mi-longue couvrant en entier son œil droit, et son œil gauche dégagé et jade pointé, fixé sur Fordern.
Ils s’étaient revus et la confiance les avait gagnés.
Ils se revoyaient souvent, en général pour une promenade dans la nature. Cela les sortait de la vie urbaine et ils aimaient bien. Beaucoup de promenades courtes car Lucile vivait une fin d’études très prenante et ne pouvait se libérer qu’entre midi et deux. Destinations : environs proches de Mulhouse, les premières ondulations du Sundgau, le vignoble sur Thann ou Guebwiller, plus simplement la Hardt, voire les bords du Rhin.
Ils observaient les couleurs, les formes, les paysages, les petites plantes comme les troncs imposants des plus vieux arbres. Souvent, soudain, ils interrompaient leur marche pour, se sentant seuls en contact avec la nature, s’embrasser longuement, fougueusement ou tendrement, recherchant une vibration commune.
Pour leur première nuit, ils choisirent Montbéliard.
Outre les enfilades industrielles, y domine encore le château, comme dressé par orgueil au milieu de l’urbanisation. Mais la région proche était très belle, rythmée par les falaises claires et les lourds manteaux forestiers, allongés en ourlets sur les corniches et frangeant les vallées dont la fraîcheur vivace ourdissaient chez le visiteur quelque inquiétude : trop tranquille cette nature à l’unisson, trop calme pour ne pas être aussi magique ou maléfique.
Ils avaient recherché une chambre d’hôte blottie dans une petite vallée affluente, irriguée par des routes bien étroites mais plutôt accueillantes. Pendant le trajet, dans la voiture (une ancienne Volvo des années 60, caprice de Fordern qui aimait ce modèle), il avait entrepris d’expliquer, de déplier, en choisissant chaque mot, et avec toute la lenteur désirée, quel était, quel serait son attente sensuelle. Il ne souhaitait que s’occuper d’elle, refusant son propre plaisir pour cette fois, s’excluant plus ou moins de la relation pour exacerber son plaisir à elle, le rechercher dans toute sa complexité et sa différence.
Décomposer ce plaisir, enchaîner les sensations, les localiser, les exprimer, les faire ressentir dans leur propre originalité, les extraire et modeler leurs limites…
Lucile avait été quelque peu surprise, mais désormais habituée aux frasques littéraires et autres originalités comportementales de son compagnon, elle n’était en fait qu’à moitié étonnée.
La chambre était meublée d’un beau mobilier simple, rustique et solide en fil de chêne sombre, infiniment jurassien. Le lit était épais, lourd et rassurant.
Fordern commença par caresser les cheveux de Lucile, retrouvant ainsi ses premières sensations, s’y ré-abreuvant, y puisant toute la ténuité qu’il sentait nécessaire. Puis, écartant le bouton nacré du chemisier bleu sombre, il effleura de ses doigts le relief claviculaire, en en suivant sa ligne horizontale, le touchant à peine, et même par moment simulant le contact, le simple déplacement d’air exerçant la sensation. De l’autre main, il soulignait l’aréole du sein gauche qui transparaissait à la surface tissu bleu du bustier. Il tenait à ces attouchements contrastés et délocalisés, car la distance et la différence ainsi créées (entre la clavicule évoquant plutôt force et charpente et le sein…) attisaient une tension sensuelle qui, outre les liaisons corporelles qu’elle suscitait, procurait aussi la surprise, possible révélatrice de sensations inattendues.
Lucile n’était pas au bout de ses surprises. Il l’embrassa promptement sur les lèvres, là encore dans un contact léger, un peu fugace, accompagnant ce geste d’une étreinte douce, sans brusquerie aucune, sans masculinité déplacée, et il écourta le contact de leurs langues, refusant la fougue qu’il avait senti se déclencher en elle.
Il avait aussi ce faisant peu à peu découvert le buste, dégageant d’abord les épaules qu’il orientait dans la lumière de la lampe de chevet (pied de bois sombre surmonté d’un abat-jour écru, grossièrement cousu à la main, et délivrant des lueurs feuille morte). Avec toute la lenteur voulue, il dévoila les seins aux mamelons prune, les enveloppa de son œil de photographe, puis repris ses caresses infinitésimales et distancées. Nouvel effleurement de l’aréole avec un contact direct du bout des doigts, de façon circulaire, répétitive et tout en tendresse, et, caresse délicate de l’oreille opposée, pour éveiller le frêle duvet qui l’auréolait.
à suivre
Cristaux de mots : partie 1 (texte 1-1), partie 2 (texte 1-2 et 2), partie 3 (textes 3 et 4), partie 4 (textes 5 et 6), partie 5 (textes 7, 8 et 9), partie 6 (texte 10), partie 7 (texte 11), partie 8 (textes 12, 13, 14 et 15), partie 9 (texte 16), partie 10 (textes 17).