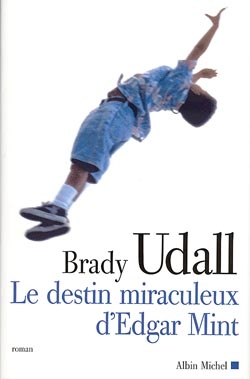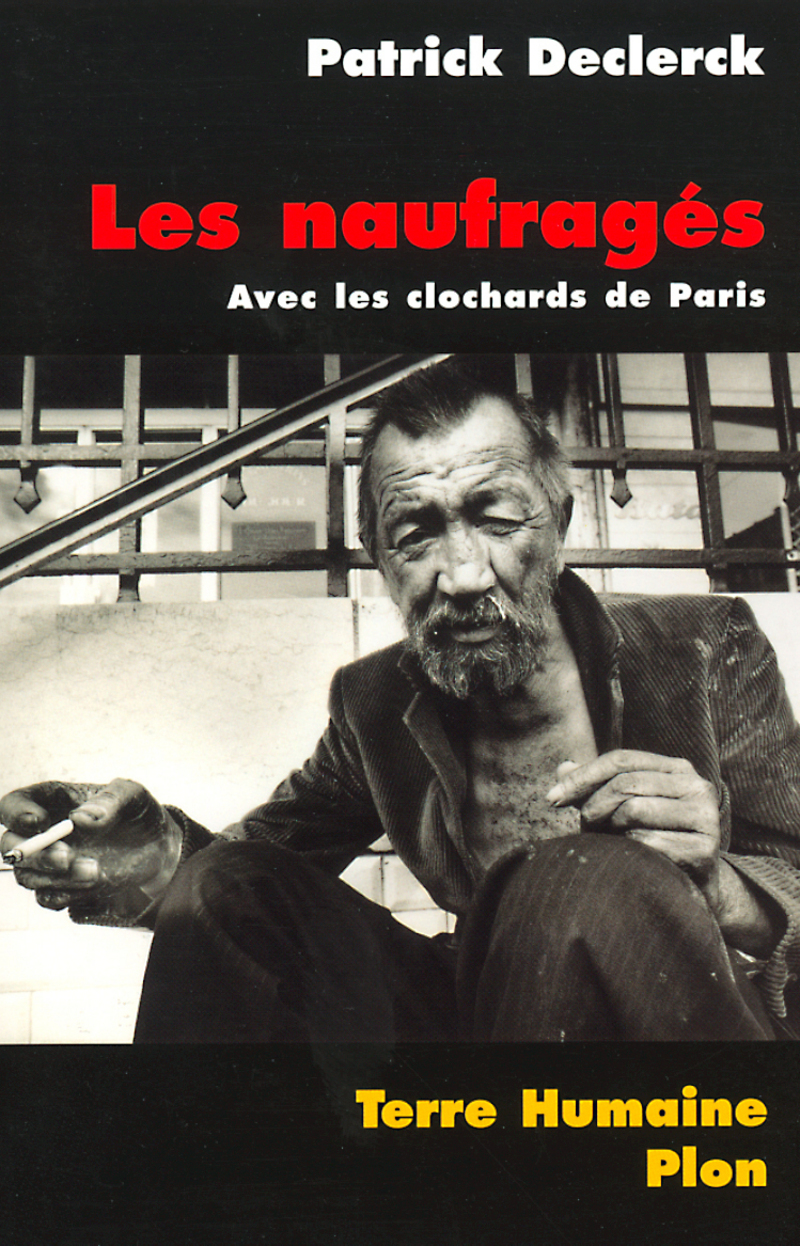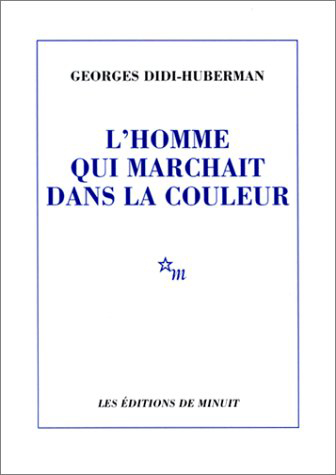Neuvième jour d’écriture
Il y a depuis quelques jours, au beau milieu du lac salé, une barque. Un homme est à bord, qui a laissé filer sa canne. Chacun sait ici, qu’il n’y pas de poisson. La plupart des villageois alentours rient, certains sourient, d’autres – chez qui la superstition n’est pas éteinte – veulent bien croire encore au miracle, que peut faire l’homme.
Mais celui-ci ne prend rien. Ni menu fretin.
De temps à autre, le pêcheur débarque pour quelques provisions. Un villageois l’autre jour a osé l’interroger. Il s’est entendu répondre, très calmement : « J’apprends la patience, l’infinie patience. ».
L’autre pensa : « Dieu, que l’homme est stupide avec sa nature ! »
Puis, l’homme retourne sur sa barque. Il reprend sa posture de pêcheur. Et jette son fil à l’eau. Ceux qui sont bons observateurs le voient de temps en temps écoper. Ils s’interrogent. Puis passent à autre chose.
Pour qui sait, l’homme pleure d’abondantes larmes dont il remplit le lac salé.
J’ai cherché à savoir. Et me suis rendu dans les villages voisins, où j’ai posé quelques questions. Là, dans ces paysages muets qui bordent le lac, les cœurs sont rudes, les yeux se détournent, les épaules se haussent, les pas sont trop pressés : on me dit ne pas connaître l’homme. Pourtant moi qui l’ai vu de près, je sais qu’il est leur semblable. Cependant me saute aux yeux, une probable différence : je ne sens pas, ici, de propension à un tel chagrin.
Car, c’est bien un chagrin qui habite cet homme.
Une légende est en train de s’écrire ; et à l’écriture de laquelle, je veux pouvoir contribuer.
Le chagrin n’est-il pas universel, qui voudrait que tous les hommes puissent en parler. Pour mieux le conjurer.
J’ai fait plusieurs fois le tour du Lac afin de l’intriguer. Comme si de son secret, je voulais m’imprégner.
Un jour enfin, je vis la barque sur la rive. L’homme était assis au pied d’une souche, et me regardait. Son regard n’était ni d’invite, ni hostile. Il commandait que je m’approche. Je me suis assis.
Voilà, ce qu’il m’a dit.
Ma femme était belle comme une émotion. Je l’aimais, comme on entre en dévotion.
Pour la réjouir, je lui disais tendrement et en m’amusant, vouloir me noyer dans son lac salé. Ce que je faisais bien volontiers avec la ferveur d’un amoureux de bénitier. « Tu m’aimes divinement » me disait-elle en riant. Et je me prenais pour un ange, car seuls les anges savent aimer divinement. Les dieux ne connaissent rien à ce jeu.
Elle en était encore plus belle qu’au présent et l’émotion que me produisait sa nouvelle beauté en était dédoublée, à tel point que je revenais toujours à l’abnégation.
Elle prenait quelques fois les choses au premier degré. C’était son côté « bonne du curé ».
Un jour, elle me dit : Moi aussi je veux goûter l’eau du lac salé. J’ai pris peur. Elle ne savait pas nager.
Et je me dis chaque jour, qu’elle s’est noyée dans notre amour, dont je croyais être le seul à avoir les clefs. J’ai au bout de ma canne, un petit morceau d’étoffe rouge.
Voilà, vous savez ma vérité.
Dixième jour d’écriture
Il y a depuis quelques jours, au beau milieu du lac salé, une barque. Un homme est à bord, qui a laissé filer sa canne. Chacun sait ici, qu’il n’y pas de poisson. La plupart des villageois alentours rient, certains sourient, d’autres – chez qui la superstition n’est pas éteinte – veulent bien croire encore au miracle, que peut faire l’homme.
Mais celui-ci ne prend rien. Ni menu fretin.
De temps à autre, le pêcheur débarque pour quelques provisions. Un villageois l’autre jour a osé l’interroger. Il s’est entendu répondre, très calmement : « J’apprends la patience, l’infinie patience. ».
L’autre pensa : « Dieu, que l’homme est stupide avec sa nature ! »
Puis, l’homme retourne sur sa barque. Il reprend sa posture de pêcheur. Et jette son fil à l’eau. Ceux qui sont bons observateurs le voient de temps en temps écoper. Ils s’interrogent. Puis passent à autre chose.
Pour qui sait, l’homme pleure d’abondantes larmes dont il remplit le lac salé.
J’ai cherché à savoir. Et me suis rendu dans les villages voisins, où j’ai posé quelques questions. Là, dans ces paysages muets qui bordent le lac, les cœurs sont rudes, les yeux se détournent, les épaules se haussent, les pas sont trop pressés : on me dit ne pas connaître l’homme. Pourtant moi qui l’ai vu de près, je sais qu’il est leur semblable. Cependant me saute aux yeux, une probable différence : je ne sens pas, ici, de propension à un tel chagrin.
Car, c’est bien un chagrin qui habite cet homme.
Une légende est en train de s’écrire ; et à l’écriture de laquelle, je veux pouvoir contribuer.
Le chagrin n’est-il pas universel, qui voudrait que tous les hommes puissent en parler. Pour mieux le conjurer.
J’ai fait plusieurs fois le tour du Lac afin de l’intriguer. Comme si de son secret, je voulais m’imprégner.
Un jour enfin, je vis la barque sur la rive. L’homme était assis au pied d’une souche, et me regardait. Son regard n’était ni d’invite, ni hostile. Il commandait que je m’approche. Je me suis assis.
Voilà, ce qu’il m’a dit.
Ma femme était belle comme une émotion. Je l’aimais, comme on entre en dévotion.
Pour la réjouir, je lui disais tendrement et en m’amusant, vouloir me noyer dans son lac salé. Ce que je faisais bien volontiers avec la ferveur d’un amoureux de bénitier. « Tu m’aimes divinement » me disait-elle en riant. Et je me prenais pour un ange, car seuls les anges savent aimer divinement. Les dieux ne connaissent rien à ce jeu.
Elle en était encore plus belle qu’au présent et l’émotion que me produisait sa nouvelle beauté en était dédoublée, à tel point que je revenais toujours à l’abnégation.
Elle prenait quelques fois les choses au premier degré. C’était son côté « bonne du curé ».
Un jour, elle me dit : Moi aussi je veux goûter l’eau du lac salé. J’ai pris peur. Elle ne savait pas nager.
Et je me dis chaque jour, qu’elle s’est noyée dans notre amour, dont je croyais être le seul à avoir les clefs. J’ai au bout de ma canne, un petit morceau d’étoffe rouge.
Voilà, vous savez ma vérité.
Cet homme-là sait mieux écrire les histoires que moi.
Onzième jour d’écriture
Il y a depuis quelques jours, au beau milieu du lac salé, une barque. Un homme est à bord, qui a laissé filer sa canne. Chacun sait ici, qu’il n’y pas de poisson. La plupart des villageois alentours rient, certains sourient, d’autres – chez qui la superstition n’est pas éteinte – veulent bien croire encore au miracle, que peut faire l’homme.
Mais celui-ci ne prend rien. Ni menu fretin.
De temps à autre, le pêcheur débarque pour quelques provisions. Un villageois l’autre jour a osé l’interroger. Il s’est entendu répondre, très calmement : « J’apprends la patience, l’infinie patience. ».
L’autre pensa : « Dieu, que l’homme est stupide avec sa nature ! »
Puis, l’homme retourne sur sa barque. Il reprend sa posture de pêcheur. Et jette son fil à l’eau. Ceux qui sont bons observateurs le voient de temps en temps écoper. Ils s’interrogent. Puis passent à autre chose.
Pour qui sait, l’homme pleure d’abondantes larmes dont il remplit le lac salé.
J’ai cherché à savoir. Et me suis rendu dans les villages voisins, où j’ai posé quelques questions. Là, dans ces paysages muets qui bordent le lac, les cœurs sont rudes, les yeux se détournent, les épaules se haussent, les pas sont trop pressés : on me dit ne pas connaître l’homme. Pourtant moi qui l’ai vu de près, je sais qu’il est leur semblable. Cependant me saute aux yeux, une probable différence : je ne sens pas, ici, de propension à un tel chagrin.
Car, c’est bien un chagrin qui habite cet homme.
Une légende est en train de s’écrire ; et à l’écriture de laquelle, je veux pouvoir contribuer.
Le chagrin n’est-il pas universel, qui voudrait que tous les hommes puissent en parler. Pour mieux le conjurer.
J’ai fait plusieurs fois le tour du Lac afin de l’intriguer. Comme si de son secret, je voulais m’imprégner.
Un jour enfin, je vis la barque sur la rive. L’homme était assis au pied d’une souche, et me regardait. Son regard n’était ni d’invite, ni hostile. Il commandait que je m’approche. Je me suis assis.
Voilà, ce qu’il m’a dit.
Ma femme était belle comme une émotion. Je l’aimais, comme on entre en dévotion.
Pour la réjouir, je lui disais tendrement et en m’amusant, vouloir me noyer dans son lac salé. Ce que je faisais bien volontiers avec la ferveur d’un amoureux de bénitier. « Tu m’aimes divinement » me disait-elle en riant. Et je me prenais pour un ange, car seuls les anges savent aimer divinement. Les dieux ne connaissent rien à ce jeu.
Elle en était encore plus belle qu’au présent et l’émotion que me produisait sa nouvelle beauté en était dédoublée, à tel point que je revenais toujours à l’abnégation.
Elle prenait quelques fois les choses au premier degré. C’était son côté « bonne du curé ».
Un jour, elle me dit : Moi aussi je veux gouter l’eau du lac salé. J’ai pris peur. Elle ne savait pas nager.
Et je me dis chaque jour, qu’elle s’est noyée dans notre amour, dont je croyais être le seul à avoir les clefs. J’ai au bout de ma canne, un petit morceau d’étoffe rouge.
Voilà, vous savez ma vérité.
Cet homme-là sait mieux écrire les histoires que moi.
Je me suis éloigné. Deux jours. Puis suis revenu au bord du Lac salé. La barque était vide du pécheur.
Douzième jour d’écriture
Il y a depuis quelques jours, au beau milieu du lac salé, une barque. Un homme est à bord, qui a laissé filer sa canne. Chacun sait ici, qu’il n’y pas de poisson. La plupart des villageois alentours rient, certains sourient, d’autres – chez qui la superstition n’est pas éteinte – veulent bien croire encore au miracle, que peut faire l’homme.
Mais celui-ci ne prend rien. Ni menu fretin.
De temps à autre, le pêcheur débarque pour quelques provisions. Un villageois l’autre jour a osé l’interroger. Il s’est entendu répondre, très calmement : « J’apprends la patience, l’infinie patience. ».
L’autre pensa : « Dieu, que l’homme est stupide avec sa nature ! »
Puis, l’homme retourne sur sa barque. Il reprend sa posture de pêcheur. Et jette son fil à l’eau. Ceux qui sont bons observateurs le voient de temps en temps écoper. Ils s’interrogent. Puis passent à autre chose.
Pour qui sait, l’homme pleure d’abondantes larmes dont il remplit le lac salé.
J’ai cherché à savoir. Et me suis rendu dans les villages voisins, où j’ai posé quelques questions. Là, dans ces paysages muets qui bordent le lac, les cœurs sont rudes, les yeux se détournent, les épaules se haussent, les pas sont trop pressés : on me dit ne pas connaître l’homme. Pourtant moi qui l’ai vu de près, je sais qu’il est leur semblable. Cependant me saute aux yeux, une probable différence : je ne sens pas, ici, de propension à un tel chagrin.
Car, c’est bien un chagrin qui habite cet homme.
Une légende est en train de s’écrire ; et à l’écriture de laquelle, je veux pouvoir contribuer.
Le chagrin n’est-il pas universel, qui voudrait que tous les hommes puissent en parler. Pour mieux le conjurer.
J’ai fait plusieurs fois le tour du Lac afin de l’intriguer. Comme si de son secret, je voulais m’imprégner.
Un jour enfin, je vis la barque sur la rive. L’homme était assis au pied d’une souche, et me regardait. Son regard n’était ni d’invite, ni hostile. Il commandait que je m’approche. Je me suis assis.
Voilà, ce qu’il m’a dit.
Ma femme était belle comme une émotion. Je l’aimais, comme on entre en dévotion.
Pour la réjouir, je lui disais tendrement et en m’amusant, vouloir me noyer dans son lac salé. Ce que je faisais bien volontiers avec la ferveur d’un amoureux de bénitier. « Tu m’aimes divinement » me disait-elle en riant. Et je me prenais pour un ange, car seuls les anges savent aimer divinement. Les dieux ne connaissent rien à ce jeu.
Elle en était encore plus belle qu’au présent et l’émotion que me produisait sa nouvelle beauté en était dédoublée, à tel point que je revenais toujours à l’abnégation.
Elle prenait quelques fois les choses au premier degré. C’était son côté « bonne du curé ».
Un jour, elle me dit : Moi aussi je veux goûter l’eau du lac salé. J’ai pris peur. Elle ne savait pas nager.
Et je me dis chaque jour, qu’elle s’est noyée dans notre amour, dont je croyais être le seul à avoir les clefs. J’ai au bout de ma canne, un petit morceau d’étoffe rouge.
Voilà, vous savez ma vérité.
Cet homme-là sait mieux écrire les histoires que moi.
Je me suis éloigné. Deux jours. Puis suis revenu au bord du Lac salé. La barque était vide du pécheur.
Cependant, un couple d’oiseaux, qui tournoyait et voletait, semblait vouloir prendre possession de l’embarcation.
Treizième jour d’écriture
Il s’agit d’un vendredi treize : je me confonds de superstition.
A suivre : (1) • (2) • (3)

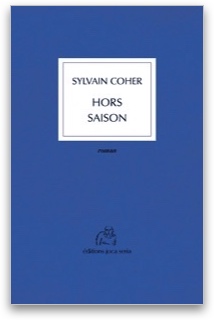
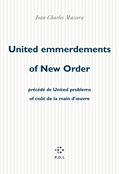



 ), Incendies, Léméac/Actes Sud | lien éditeur [nouvelle éditions 2009]
), Incendies, Léméac/Actes Sud | lien éditeur [nouvelle éditions 2009]



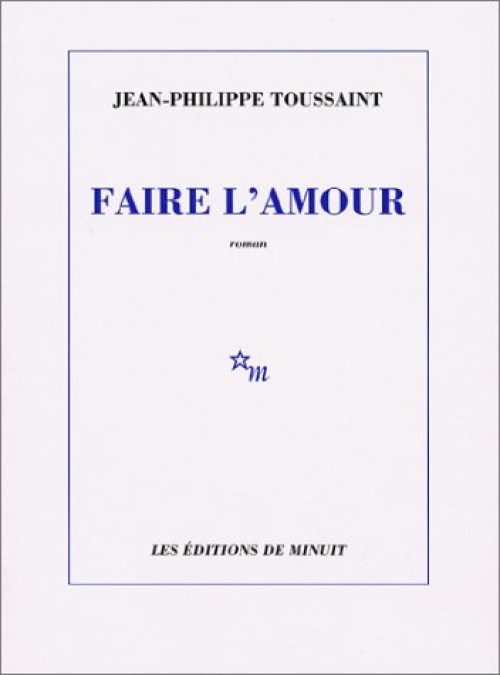


 ), Anvers, Christian Bourgois | lien éditeur
), Anvers, Christian Bourgois | lien éditeur
 ), La maison des feuilles, traduit par Claro, Denoël | lien éditeur | lien auteur
), La maison des feuilles, traduit par Claro, Denoël | lien éditeur | lien auteur![]()
 ), La vie devant les yeux, traduit par Anne Wicke, Christian Bourgois | lien éditeur
), La vie devant les yeux, traduit par Anne Wicke, Christian Bourgois | lien éditeur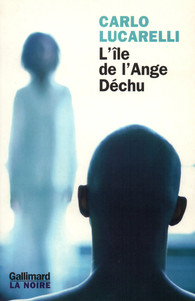
 ), L’île de l’ange déchu [1999], Gallimard | lien éditeur | lien auteur
), L’île de l’ange déchu [1999], Gallimard | lien éditeur | lien auteur

 ), Nous revenons comme des ombres, traduit par René Solis, Payot/Rivages | lien éditeur | lien auteur
), Nous revenons comme des ombres, traduit par René Solis, Payot/Rivages | lien éditeur | lien auteur
 ), Bartleby et cie, traduit par Éric Beaumatin, Christian Bourgois | lien éditeur | lien auteur
), Bartleby et cie, traduit par Éric Beaumatin, Christian Bourgois | lien éditeur | lien auteur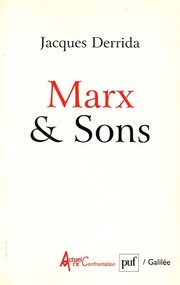
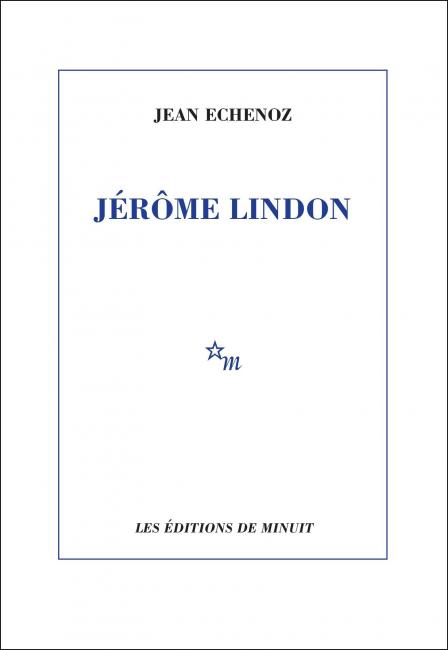

 ), L’obsolescence de l’homme, I [1950], traduit par Christophe David, L’Encyclopédie des Nuisances†/Ivréa | lien éditeur
), L’obsolescence de l’homme, I [1950], traduit par Christophe David, L’Encyclopédie des Nuisances†/Ivréa | lien éditeur

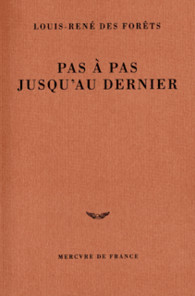




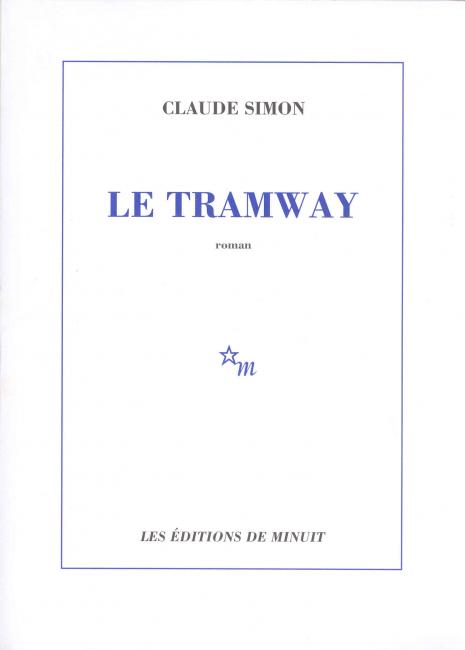
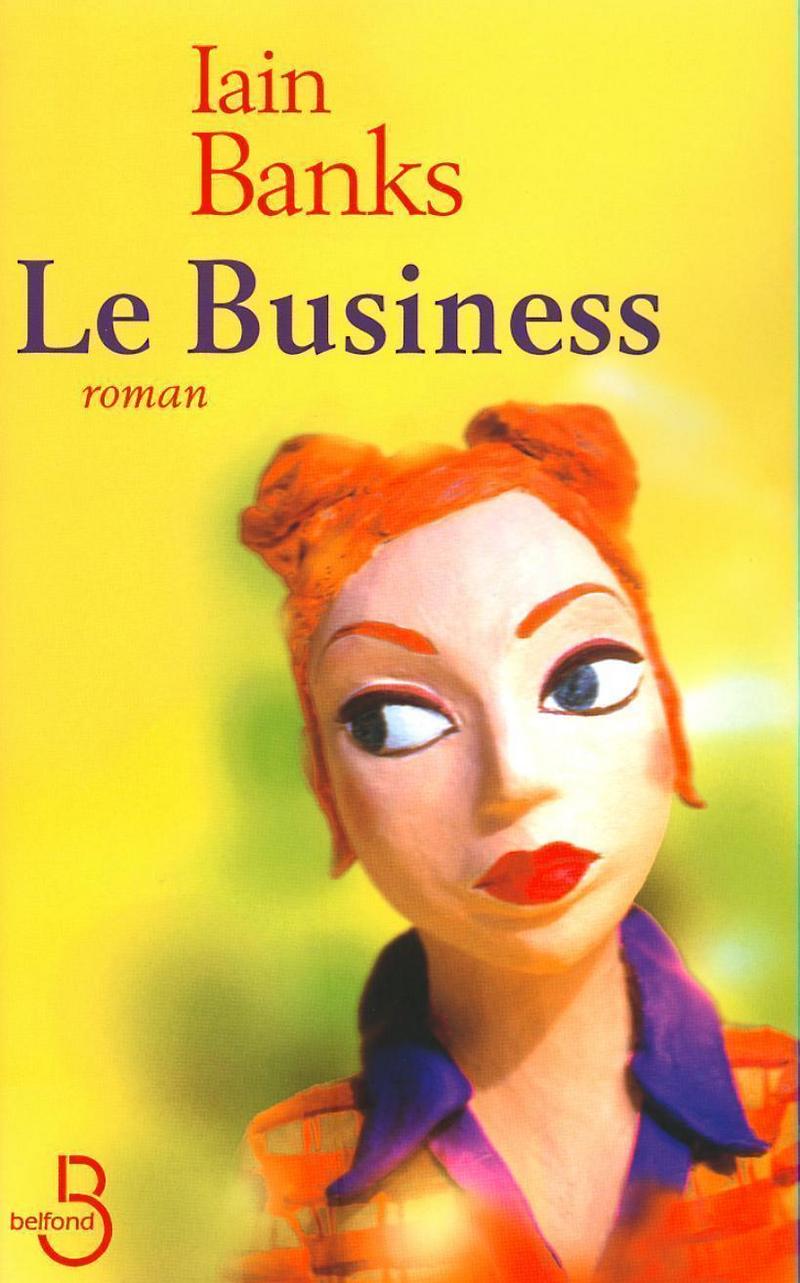
 ), Le business, traduit par Christiane et David Ellis, Belfond |
), Le business, traduit par Christiane et David Ellis, Belfond | 

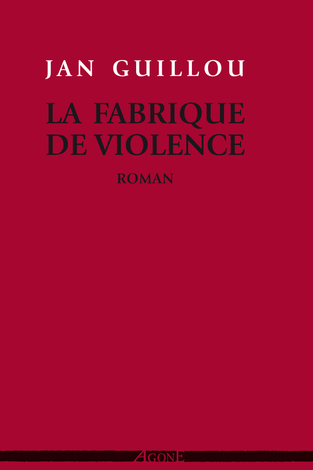
 ), La fabrique de violence, traduit par Philippe Bouquet, Agone |
), La fabrique de violence, traduit par Philippe Bouquet, Agone | 
 ), Vertiges, traduit par Patrick Charbonneau, Actes Sud |
), Vertiges, traduit par Patrick Charbonneau, Actes Sud |