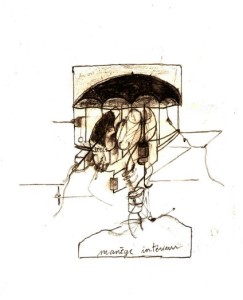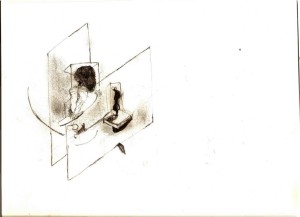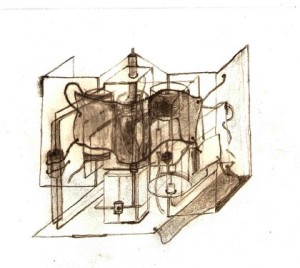Nous publions un texte d’Augustin Berque, que nous remercions ici, qui explicite la notion de “chôra” apparue chez Platon et que la modernité a toujours reléguée ou réfutée ; ce concept anomal pourrait pourtant permettre de nourrir la réflexion autour d’une ontologie que les enjeux politiques, écologiques et éthiques du moment appellent urgemment. Une version de ce texte a paru dans Thierry Paquot et Chris Younès, dir., Espace et lieu dans la pensée occidentale de Platon à Nietzsche, Paris, La Découverte, 2012, p. 13-27. Nous remercions également ces auteurs et l’éditeur.
Nota le texte est divisé en trois parts : 2 • 3
6. La chôra, milieu nourricier de l’existant
Ce « tous trois triplement », tria trichê, n’est pas sans poser problème. Trichê, cela veut dire « en trois, en trois parties, de trois manières différentes ». Pourquoi ce redoublement avec tria, le neutre de treis, qui pour sa part veut simplement dire « trois » ? Pas question, évidemment, d’y chercher quelque anticipation de la sainte Trinité ; car si l’on pourrait, à la rigueur, voir dans l’incarnation historique du Père dans le Fils quelque analogie avec la projection de l’idea dans la genesis, la chôra quant à elle n’a rien à voir avec le Paraclet. Bien trop charnelle ! La « nourrice », cette tithênê à laquelle Platon la compare, c’est un mot de même racine que le français têter ou que l’anglais tit. La chôra, c’est clair, donne le sein à ce nouveau-né qu’est la genesis, mot dont le sens premier veut dire « naissance ». Du reste, en 50 d 2, le texte du Timée compare l’être absolu à un père, le milieu à une mère, et le devenir à leur enfant. Cet enfant, il faut bien le nourrir !
Nous avons donc là deux pistes de recherche. L’une sera d’éclaircir cette idée de maternité que connote la chôra. La deuxième, d’approfondir ce thème de la trinité de l’être, du milieu et du devenir.
Quant au premier thème, outre les images que contient le texte de Platon lui-même (la mère, la nourrice…), il nous faut revenir au sens le plus général et le plus concret que pouvait avoir la chôra dans la cité grecque. Pour les citoyens de la polis, la chôra, c’était la campagne nourricière dont tous les jours ils voyaient, au delà des remparts de l’astu, les collines couvertes de blé, de vigne et d’oliviers. De là, quotidiennement, leur venaient ces nourritures terrestres qui leur permettaient de vivre. Dans ce monde-là, pas d’astu sans chôra !
Or astu – le centre urbain de la polis –, c’est un mot dont la racine indo-européenne WES veut dire « séjour, séjourner ». Cette racine se retrouve dans le sanscrit vasati (il séjourne) ou vastu (emplacement). En allemand, elle a donné Wesen (être, nature, essence), war et gewesen (formes de sein, être) ; en anglais, was et were (formes de to be). L’astu, en somme, et dans la mesure où il s’agit d’un Hellène comme Platon, c’est par essence le séjour de l’être (on dirait en castillan : l’estancia du ser) ; cependant, ce dernier ne peut concrètement exister sans ce milieu nourricier : la chôra qui entoure l’astu.
Ce rapport concret – ce croître-ensemble (en latin cum-crescere, d’où concretus) – n’a nulle part été mieux éclairé que par l’archéologie russe en Crimée, terre dont l’histoire a permis que les structures de la chôra propre à la cité grecque de l’Antiquité (la Chersonèse Taurique, en l’occurrence) subsistent clairement dans le paysage ; et corrélativement, la dalle de marbre blanc du « Serment de Chersonèse », qui date à peu de chose près du temps de Platon, nous révèle que chaque citoyen engageait sa vie pour la défense de ce territoire : « Je jure par Zeus, Gê, Hélios, la Vierge (la Parthénos), les dieux et déesses de l’Olympe et les héros qui possèdent la polis, la chôra et les postes fortifiés1 […] ».
7. Le « troisième genre » de la chôra
Quant à lui, le thème de la trinité où intervient la chôra se redouble, en ce qui la concerne, de ce qu’elle n’est ni l’être absolu (l’ontôs on), ni l’être relatif (la genesis). Ni ceci, ni cela, mais quelque chose qui, nous dit Platon, est d’un « troisième et autre genre » (triton allo genos, 48 e 3). Autre que quoi ? Autre que les deux eidê dont Timée vient de parler, i.e. l’on et la genesis. Eidê, c’est le duel d’eidos, espèce (du latin species, vue, regard, aspect), forme dans l’esprit, que l’on voit en idée ; le mot est parent du latin videre, voir, et du sanscrit véda, je sais, védah, aspect. Tous ces mots viennent de la racine indo-européenne WEID, indiquant la vision qui sert à la connaissance. Dans l’absolu, pour Platon (et c’est pour cela que l’on parle de son « idéalisme »), l’eidos ou idea, c’est l’être véritable ; mais on voit ici que la genesis peut aussi, à l’occasion, être comptée comme eidos. En somme, comme être ; ce qui ne change rien au fait qu’il y a pour Platon deux ordres ontologiques : le premier, c’est « l’espèce du Modèle, qui est intelligible et toujours identique à elle-même » (paradeigmatos eidos […] noêton kai aei kata tauta on, 48 e 4), l’autre, « l’espèce seconde, copie du Modèle, qui naît et que l’on voit » (mimêma de paradeigmatos deuteron, genesin echon kai horaton, 49 a 1).
La troisième espèce, cela va être la chôra, qui certes, comme les deux précédentes, est elle aussi « présence » (paron, 50 c 7) ; mais comme espèce, en revanche, est « difficile et indécise » (chalepon kai amudron eidos, 49 a 3). Peut-on, du reste, en dire vraiment que c’est un eidos ? Voire. Elle ne se laisse approcher que par des métaphores, dont nous avons déjà vu quelques unes, et dont en fin de compte ne ressort aucune définition ; il faudra se contenter de savoir que la chôra est « une espèce invisible (anoraton eidos [ce qui est un oxymore, puisque l’eidos est un aspect qui suppose une vue]) et sans forme (amorphon [second oxymore, puisque l’eidos est une forme]), qui reçoit tout (pandeches) et participe de l’intelligible de quelque manière fort aporétique (metalambanon de aporôtata pê tou noêtou, 51 b 1 ) ».
Ainsi donc, le « troisième genre » de la chôra demeure une aporie : un obstacle infranchissable à l’intellection. Celle-ci, devant ce troisième genre, se trouve « sans ressources » (aporei). Pourquoi donc ? La question a bien entendu rapport avec la capacité de l’intellection elle-même, c’est-à-dire en somme avec la logique. Il faudra certes attendre Aristote pour que celle-ci se construise en tant que telle, mais nous en avons là en puissance les trois actants principaux, du moins dans le cadre de la pensée européenne : le principe d’identité (A : le Modèle, qui est toujours identique à soi-même), le principe de contradiction (non-A : la copie, qui n’est pas le Modèle), et le principe du tiers exclu ; car la chôra, qui n’est ni le Modèle ni sa copie, est d’un « troisième genre », ni A ni non-A, lequel reste en fin de compte inintelligible, exclu par la raison.
C’est effectivement là que s’en tient le Timée. L’on peut ainsi juger qu’avec la chôra, que Luc Brisson2 traduit par « milieu spatial » et interprète comme « le milieu où se produit le devenir3 », aurait pu se déployer un domaine de la pensée que Platon a forclos. En effet, comme l’a écrit Alain Boutot, « en transformant, dans et par son idéalisme, la chôra primitive en milieu amorphe qui reçoit tous les corps, Platon occulte de manière décisive la dimension originaire de la spatialité comme contrée (Gegend) qui était perceptible au premier matin de la pensée4 ».
Or pourquoi l’idéalisme du Timée ne peut-il pas, ne peut-il plus saisir la contréité5, p. 35) ; c’est-à-dire le couplage dynamique des deux « moitiés » (en latin medietates, d’où médiance) constitutives de l’être humain : son « corps animal » individuel et son « corps médial » collectif (i.e. le milieu éco-techno-symbolique indispensable à ce néotène qu’est Homo sapiens)] (la Gegendheit) de la chôra ? Pourquoi ce « troisième genre » est-il aporétique ? Parce que, dans le cadre de la pensée qui se met en ordre (se cosmise) avec Platon, et s’institue en République, on en a fini avec le mythe. Autrement dit, avec la symbolicité ; du moins, idéalement. Désormais, l’on ne devra qu’être ou ne pas être, to be or not to be ; mais pas les deux à la fois, comme le sont les symboles, où A est toujours aussi non-A. C’est effectivement pour cela que les poètes, gens du symbole, sont bannis de la République platonicienne ; car « la raison nous en faisait un devoir » (ho gar logos hêmas hêrei, République I, VIII, 609 b 3).
C’est cette même raison qui devait faire devoir à la pensée européenne d’oublier la chôra, cette empreinte-matrice coupable de tiers inclus, car participant de l’être sans toutefois être vraiment ; devoir, donc, de se contenter du topos aristotélicien, lequel pour sa part va si bien avec la logique disjonctive, et non moins aristotélicienne, du tiers exclu : « vase immobile » (aggeion ametakinêton, selon la Physique, IV, 212 a 15), ne reste-il pas lui-même alors que la chose qui l’occupait peut se transporter en n’importe quel autre topos tout en gardant sa propre identité par devers soi ? Or c’est cette disjonction des identités – cette dé-concrescence – qui justement n’a pas lieu dans la chôra, cette empreinte-matrice où l’être et son milieu participent l’un de l’autre… Chose impossible, inacceptable pour la raison ! Désormais donc, la pensée européenne s’est fait devoir de ne poser que la question : « où sont les choses ? », sans plus s’interroger, jusqu’à Heidegger, sur cet où qui tient de l’être, sans l’être tout en l’étant…
Cette aporie de la chôra, elle n’est pourtant rien que le fait du logos – le fait de son exclusion du tiers. C’est une affaire européenne. Les logiciens indiens, eux, ont dès le IIIe siècle élaboré les tétralemmes qui permettent, au contraire, d’inclure le tiers ; soit, schématiquement, les quatre lemmes : 1. A (affirmation) ; 2. non-A (négation) ; 3. ni A ni non-A (ni affirmation ni négation) ; 4. à la fois A et non-A (à la fois affirmation et négation6).
Or le symbole n’est autre que ce qui, dans les milieux humains – c’est-à-dire dans la chôra –, réalise le quatrième lemme du tétralemme. Il est à la fois A et non-A, le même et l’autre. C’est bien pourquoi le mécanicisme moderne, dont l’idéal est l’itération du même (la répétition de A), n’a de cesse d’éradiquer la symbolicité du monde ; autrement dit de le déshumaniser, puisque les systèmes symboliques sont inhérents à l’existence humaine7. Effectivement, dans un monde mécanique, soumis au règne de l’identité, la chôra n’a pas sa place. Le dualisme en particulier, qui confronte directement le sujet (A) à l’objet (non-A), est incapable de prendre en compte la réalité des milieux humains, cette chôra où croissent ensemble, en un « troisième et autre genre », A et non-A, le même et l’autre, l’être et le devenir. Mais à force de forclore cette médiance des milieux humains, c’est la possibilité même de notre existence que la République des machines est en train de bannir[Cf. Augustin Berque, Médiance, de milieux en paysages, Paris, Belin, 1990, 2000 ; Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 2000, 2009 ; Milieu et identité humaine. Notes pour un dépassement de la modernité, Paris, Donner lieu, 2010.].
To be continued ou pas : 2 • 3</font>