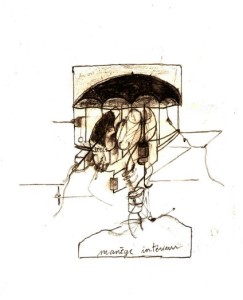Francesco Pittau est l’auteur et le concepteur d’une centaine de livres pour la jeunesse (Seuil, Gallimard, Les Grandes Personnes, Albin Michel). Quatre recueils de poèmes, deux destinés à la jeunesse (Des noms d’oiseaux, au Seuil et Un dragon dans la tête chez Gallimard) et deux recueils adultes (Un crabe sur l’épaule, au Seuil et Une maison vide dans l’estomac aux Carnets du Dessert de Lune) ; il est en outre l’auteur d’un recueil d’aphorismes Une pluie d’écureuils paru aux Carnets du dessert de lune.
Marianne avait toujours prétendu ne pas savoir nager, et là, il la voyait pousser sa brasse (sans allure, il est vrai) dans l’eau transparente et verdâtre par endroits à cause de la végétation qui couvrait le fond près du rivage. La plage était étroite, constituée de petits galets et d’un gros sable gris ; on y accédait par un sentier en pente, large comme un pas, qui sinuait entre des pierres et des touffes d’herbes solides et minérales— d’énormes rochers lisses étaient fichés un peu partout, comme après une explosion.
José s’était laissé convaincre. Marianne aimait la chaleur, les longues heures baignées par l’air poisseux, les siestes interminables et les silences ; vers dix heures du matin, ils avaient quitté l’hôtel situé à deux kilomètres de la côte— un panier bourré de petites bouteilles d’eau, de tranches de pain, de tomates allongées comme des courgettes, de fromage de chèvre et de quelques pêches, posé sur le siège arrière de la voiture.
Tout cela avait été préparé par la patronne de l’hôtel, qui leur avait dit dans un mauvais français qu’ils ne seraient pas déçus par la plage, même si elle n’était pas de sable fin. En plus, elle était toute proche de l’hôtel. Ils auraient vite fait de rentrer lorsqu’ils en auraient assez. Ils avaient choisi cet hôtel pour ces raisons : son isolement dans les collines, et sa proximité avec la mer— afin que Marianne puisse profiter à l’occasion de la plage. Les premiers jours, José avait réussi à tenir un programme serré de visites diverses : petites églises à moitié effondrées, chicots de temples gréco-romains et même une fromagerie artisanale tenue par un vieil homme qui sentait la sueur et la crasse. La région était pauvre en lieux à prospecter : on y rencontrait surtout des combes désertes, des roches basaltiques et des terres rouges qui faisaient mal aux yeux quand le soleil était à son zénith. Marianne avait feint de s’intéresser aux visites de José, mais il n’avait pas été dupe. Surtout qu’elle ne cessait de répéter qu’il faisait une chaleur à se foutre à l’eau tout habillée. Pour toute réponse, José lui souriait doucement, comme il aurait souri à une fillette ; elle lui souriait en retour, secouant sa chevelure rousse coupée au carré.
Après avoir épuisé son réservoir de visites, José ne voulut plus sortir de l’hôtel pendant deux jours, prétextant que la canicule le terrassait, et il passa ces deux jours à lire quelques pages d’un livre sans intérêt, et à sommeiller dans la cour de l’hôtel, sous un parasol vert et blanc. Marianne avait grogné que l’inactivité à l’hôtel lui pesait. “Si c’est pour rester allongée à ne rien faire, j’aime autant le faire au bord de l’eau.” José avait dit qu’il la comprenait mais il n’avait pas réagi avant le lendemain.
« Je vais demander qu’on nous prépare un panier-repas… et on ira à la plage toute la journée… »
Il sentait le soleil sur ses épaules nues ; il avait ôté sa chemise à manches courtes— gardant ses pantalons beiges et ses espadrilles bleu foncé. Assis sur un rocher plat, il se laissait ensommeiller par la touffeur et le remuement régulier de la mer ; de temps en temps, quelques vagues brisaient le rythme, accouraient depuis l’horizon, s’enroulaient puis venaient se déployer et s’éparpiller sur le gros sable gris ; de rares oiseaux glissaient dans le ciel vide de tout nuage ; très haut, un point scintillant était passé et une sorte de vibration était parvenue jusqu’aux oreilles de José, quand le point scintillant avait déjà disparu.
« Jo ! »
Marianne, de l’eau jusqu’aux lèvres, agitait un bras dans sa direction tandis que de l’autre elle se maintenait maladroitement à flots. Il agita une main en réponse. “On dirait un veau marin…” pensa-t-il. Il n’avait aucune idée de ce qu’était un veau marin mais ça lui était venu d’un coup à l’esprit. Il regarda Marianne qui s’était remise à patauger, à grands battements de pieds, comme si elle voulait faire écumer toute l’eau de la mer.
Il ferma les yeux. La chaleur était raide. Le panier-repas attirait quelques mouches bleues qu’il éloigna de la main, visant au hasard. L’air était figé.
« Joooo ! »
Marianne s’était éloignée du rivage d’une dizaine de mètres ; comme tout à l’heure, elle s’était tournée vers José et lui faisait un signe de la main. Il répondit cette fois par un mouvement de la tête et un sourire qu’elle ne dut pas voir. Elle était trop loin. De toute façon, elle s’était de nouveau tournée dans la direction du large et s’était remise à nager.
Exaspéré par la chaleur, José plongea la main droite dans le panier-repas et en tira une pêche dans laquelle aussitôt il mordit à pleine bouche, sans l’avoir pelée. La chair fondait, il la déglutissait, puis recrachait la peau velue qui se coinçait entre ses dents. Deux ou trois guêpes s’ajoutèrent aux mouches. Elles dérivèrent lentement autour des fragments de peau de pêche, se posèrent dessus brièvement puis repartirent, alertées par un invisible danger, avant de revenir se poser.
José les contemplait, de plus en plus envahi par une torpeur irrésistible. Il était en sueur ; les guêpes et les mouches grouillaient sur la peau de pêche. De très loin, il entendit qu’on l’appelait. Il releva la tête. Marianne n’était plus qu’un point roussâtre sur l’eau, un point perdu parmi les paillettes qui palpitaient comme de minuscules volets. Le bras de Marianne devait probablement se balancer de gauche à droite, pour le saluer, mais il n’en perçut qu’un trait clair et fugace.
A l’aide de sa chemise roulée en boule, il se tamponna sous les aisselles, puis il s’épongea le visage, et sa propre odeur lui sauta au nez avec la violence d’un coup de poing.