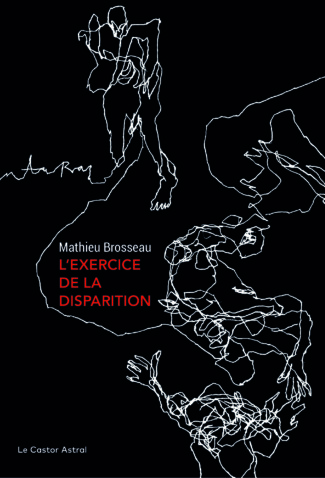Nous ouvrons l’année avec Clémence Dumper.
, que nous retrouvons. Née à Nîmes en 1978, formation de Lettres Classiques, enseignement, et écriture quotidienne. Après avoir vécu à Porto, Milan et Nîmes, elle vit désormais à Budapest, en Hongrie, où elle se consacre essentiellement à l’écriture. Après des débuts littéraires dans des revues comme Rouge Déclic ou des festivals comme celui de Mouans-Sartoux ; elle a publié son premier roman, Débandade, aux éditions Philippe Rey, en 2014.
Antigone défie la Loi et choisit l’honneur.
Elle creuse avec ses mains. Si elle le pouvait, elle creuserait avec tout son corps, avec ses dents, avec sa rage entière qui fait d’elle l’ultime combattante. Préférer l’honneur à la mort.
La terre est sale, humide. Ses ongles sont des lambeaux et ses mains saignent déjà mais cette souffrance là, physique, n’est rien comparé à l’immense précipice qu’elle sent au fond d’elle. En
creusant de la sorte, c’est sa propre solitude qu’elle troue, qu’elle bêche, pour y planter sa haine, pour y planter l’injustice.
Il se remet à pleuvoir et les gouttes accompagnent timidement ses larmes. Le jour promet d’arriver, il faut qu’elle s’active. Elle entend au loin quelques corbeaux qui s’éveillent et leurs croassements se mêlent au bruit lourd des avions et des hélicoptères.
Le pays est en guerre. La terre est en guerre et elle, au milieu de rien, elle se retrouve seule avec le corps mort de son frère qu’elle a peiné à porter jusqu’ici.
Elle ne le regarde pas. Pas le temps: il faut creuser. Bien mouillée désormais, la terre se fait plus souple – elle remercierait presque le ciel de lui offrir cette averse, si elle n’avait l’esprit entier occupé par la colère. Elle ne le regarde pas. Il est mort et bien mort, il n’attend qu’une chose: une sépulture digne. L’odeur caractéristique de cette terre humide la rassure. Un parfum d’éternité, un parfum de nature humaine.
Elle sait qu’elle risque gros: ce à quoi elle s’adonne demeure complètement illégal. Elle sait qu’on la cherche, et qu’on va la trouver.
Ses longs cheveux fangeux coulent sur son visage. Sa bouche est sèche et son maigre corps épuisé. Mais il faut que le trou soit suffisamment profond, profond comme sa peine.
Ses mains sont trop petites; elle compense ce défaut par son acharnement. Le sang qui coule de ses doigts écorchés se mêle à l’humus – comme ça, se dit-elle, c’est bien un peu de moi que
j’enterre avec lui.
Les combats font rage, même la nuit. Le cri lointain des sirènes vient percer l’aube à venir. Elle sait qu’à cet instant, en entendant ces stridences, des familles entières, apeurées, vont sortir de leur maison, vont l’abandonner définitivement pour se réfugier dans un abri de fortune qui ne les protègera peut-être pas. Elle sait qu’il y a des enfants, réveillés par la peur, qui courent en donnant la main à leur mère, confiants malgré tout, une peluche ridicule dans leur autre
main. Elle sait tout cela, s’en moque éperdument. Une seule chose compte. Creuser.
Elle jette un œil rapide sur le tas de terre qui s’amoncelle au bord du trou, petite montagne bientôt disparue, futur mausolée du frère chéri.
C’est bien. Ça avance.
Laborieuse, la voilà désormais elle-même dans le trou. Seule sa tête dépasse, de temps à autres, entre deux poignées de terre, la faisant ressembler à une taupe curieuse.
Elle n’a pas de lumière mais elle a de la chance: les nuages orange fournissent une lueur qui suffit largement à déjouer les ombres.
Elle n’a pas peur. Elle n’aura plus jamais peur, de ces fous qui gouvernent, de cet État maudit qui refuse qu’elle soit libre, qui refuse d’honorer le cadavre d’un combattant. A la fosse commune! Voilà ce qu’ils lui ont répondu. Bande de salopards. C’est ainsi que vous remerciez ce frère qui a perdu la vie pour sauver le régime! Bande de raclures! Elle n’est que dégoût – et amour sororal.
Elle a volé le corps, si froid et si rigide. Elle l’a transporté, seule, dans une carriole, recouvert de purin pour que personne ne fouille. Son frère sent la merde. Son frère sent la mort. Elle espère que la pluie, violente maintenant, lavera le défunt.
La voilà au fond du trou, épuisée. Elle s’y allonge, totalement insouciante de la saleté et, à l’horizontale, elle tend les bras – son frère est plus grand qu’elle. C’est bon. Il rentrera. Sans être plié.
Décent, droit, allongé, en repos. Elle ouvre un peu la bouche et boit la pluie qui tombe.
Agile, elle remonte sur le bord. Le plus dur reste à faire et le jour n’attend pas. Ce n’est plus de la terre mais bien de la boue maintenant, dont l’odeur la remplit de forces vives. Elle le prend par
les pieds quand, déjà!, la lueur du ciel est en train de changer. Le monde est quelque part entre la nuit et l’aurore.
Il est lourd. Tellement lourd. Pas humain d’être si lourd. Pas humain, non, juste mort. Son dos est douloureux, ses bras n’en peuvent plus mais elle n’est plus humaine. Elle est une sœur en deuil. A bout de forces, elle ne sent plus rien. Un néant l’envahit.
Les lueurs du petit matin, malgré le mauvais temps et bien malgré la guerre, conservent leur détestable douceur.
Le voilà dans le trou. Le corps a fait un bruit. Sourd. Chute. Elle le regarde une dernière fois. Elle trouve même l’audace morbide de s’allonger quelques minutes sur lui. Mouillés tous les deux. Morts tous les deux. Terre et boue tous les deux. L’ultime étreinte. Il n’est même pas froid. Il fait déjà partie des éléments. Déjà terre, déjà vers.
Vidée, elle remonte et entame la dernière phase de l’œuvre. Toute la terre sortie, elle la jette avec l’ardeur du désespoir, en pleurant. Au moins tu seras bien. Au moins tu seras recouvert d’un drap de sable.
Tu n’auras pas trop froid.
Elle fait vite, le résultat la satisfait. On dirait qu’il ne s’est rien passé.
Elle saisit une pierre grosse comme la lune absente cette nuit, et la pose délicatement à l’endroit de la tête, pour marquer l’accomplissement de son devoir de sœur.
Comme plus rien ne compte (ni l’arrivée de l’aube, ni celle, aussi probable, de la milice qui viendra l’arrêter) elle s’allonge, sereine, sur la tombe de fortune. La pluie s’est arrêtée. Elle ne pleure plus.
Antigone se repose.