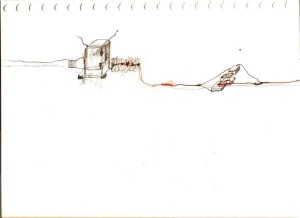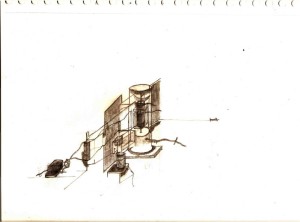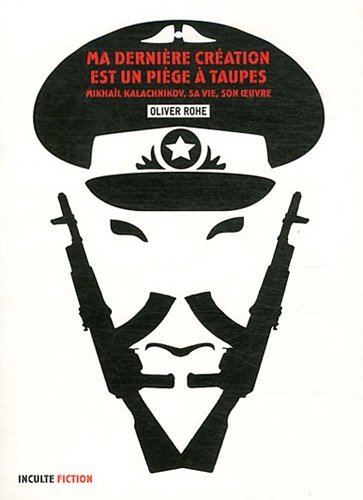Giacometti, « Un aveugle avance la main dans le vide (dans le noir ? dans la nuit) »[1]
« Du linge étendu, linge de corps et linge de maison, retenu par des pinces, pendait à une corde. » René Char[2]
« Ce matin en me réveillant je vis ma serviette pour la première fois, une serviette sans poids dans une immobilité jamais aperçue et comme en suspens dans un effroyable silence. » Alberto Giacometti[3]
L’un des objectifs du metteur en scène lors de la conception d’un spectacle est de trouver, d’inventer le mot, l’expression, qui concentrera l’hétérogénéité de son accès à une œuvre. Trouver le motif indiquant la direction, la tension principale qui orientera l’approche avec les acteurs, qui déterminera l’espace, le décor et la lumière.
Le motif de la suspension nous est apparu comme le mouvement qui anime souterrainement notre spectacle sur Giacometti. Cette suspension, nous l’entendons essentiellement comme interruption, césure, syncope. Comme un arrêt, une coupe dans le temps et l’espace. La suspension est une trêve, une pause, un ajournement, un différé. Suspendre son jugement, son savoir, son vouloir, interrompre momentanément le cours des choses, c’est :
1/ s’interroger sur ce qui nous semble être une des conditions que requiert tout geste créateur, à savoir la touche, qui, nous dit Didier Anzieu serait la première phase de l’acte créateur. Acte quasi hallucinatoire qui est « ouverture d’un chaos, d’un état de saisissement, de l’émoi, du risque et du vertige »[4].
2/ se donner la possibilité de s’interroger sur les modalités de sa propre approche. Comment ce qui se présente vient à nous, comment cela arrive. C’est observer le mouvement de l’apparaître et tenter de le porter à la compréhension de ses propres possibilités.
La suspension a un lieu : celui du milieu, de l’intervalle, de l’interstice, de l’entredeux. Ce n’est pas un lieu de repos mais un lieu de tension, un « centre de suspension vibratoire » écrit Mallarmé. L’être en suspend est celui qui est en attente, en réserve, en souffrance, c’est un être non-encore achevé, un être en devenir. Il est celui qui n’est pas assuré de la fermeté d’un sol et/ou d’une langue. Le temps de la suspension est celui du non encore éclos, du non encore accompli, d’un événement qui n’est pas assuré de son avoir-lieu. L’être en suspend est celui qui est sur le seuil. Ni dehors ni dedans. Entre la vie et la mort. Animé/inanimé. C’est un survivant. Être suspendu, c’est être accroché, exposé. Une suspension, c’est aussi l’amortisseur, le rebond, la souplesse.
Lors d’un entretien, le peintre Djamel Tatah déclare : « La suspension, c’est ce que je veux peindre. C’est ce rapport au temps que je veux induire dans le tableau. […] Il y a une idée intemporelle dans la suspension. Le temps circule. C’est de la présence. Un tableau, c’est la suspension silencieuse d’un événement […] c’est l’attente d’une transformation, d’un événement ».[5]
*
Après le spectacle sur Georges Bataille[6] qui était une méditation sur l’image et son dérobement, méditation qui avait tourné essentiellement autour du point, « cet objet sans vérité objective », que Bataille assimile « au sourire de l’être aimé », nous avions le désir de creuser plus encore ce qu’il en était de l‘exposition de l’acteur sur un plateau ; d’affiner notre questionnement et sa mise en œuvre sur les transformations, mutations, défigurations et métamorphoses d’un corps exposé aux regards. De préciser cette suspension de l’acteur qui s’approche et se retire dans son étrangeté de par l’insistance d’un regard qui se dépose sur lui ; comment s’opère le glissement d’un être vivant à une image, comment il navigue de l’absence à la présence ; comment enfin une figure apparaît depuis le champ de sa disparition.
A l’occasion d’une communication, nous écrivions[7] : « Voir un corps. Un corps qui devient image ; une présence qui se métamorphose. Un vivant devient objet pour un regard. Non que la forme se défasse, mais une autre enveloppe apparaît. Un autre corps s’extrait du premier. Pas tout à fait un autre. Pas tout à fait le même. Un autre qui n’est pas une simple duplication. Qui lui ressemble cependant, qui a un air de famille. Et qui se trouve à côté lui ? Non, plutôt sorti de lui, maintenant le rapport : ils sont issus du même tronc commun. Cet autre ne se détache pas vraiment du premier. Il se marque dans mon œil tel un calque, une réplique, une épreuve. Il s’affiche très légèrement en avant de lui, comme s’il se précédait. Un écart infime les sépare. Un mince décalage. (un éventail, un feuilleté, un escalier, un pli.) Ils sont si proches. L’image vacille. Elle tremble, se dissocie, se disjoint. L’image vibre. Processus de double vue ? Une double vue qui s’opposerait à la claire voyance de mon premier coup d’œil ? En tout cas l’original semble maintenant accompagné d’une doublure immatérielle, fantomatique.
Le plus frappant lors ce glissement serait ce sentiment que ce qui est devant nous se retire, s’éloigne et, dans le même temps, vient à nous, ou plus précisément revient vers nous, poussé vers l’avant, traversé par une force qui ne vient pas seulement de lui mais d’une puissance qui le dépasse. Je le vois maintenant très nettement. Presque trop nettement. Je suis impressionné par la sûreté de la découpe, la précision incroyable des contours, la clarté anormale de la silhouette qui se détache. Cette netteté bouleverse. Celui qui se prépare à lire m’apparaît telle une image découpée dans du papier, un être de surface, d’une planitude sans profondeur. La vision est d’une précision déformante. Réalisme magique. Apparition hyperréaliste. Ce que je vois n’est plus ce que je voyais il y a un instant. Ma perception s’hallucine. Je suis frappé maintenant par l’indétermination de cette découpe : la limite se fait poreuse entre le corps et l’espace, cette limite n’est plus si assurée, les contours se brouillent ; il n’y a plus de démarcation nette entre le monde extérieur et le corps. Les bords se font bordure. L’homme semble fait de la même substance que ce qui l’entoure. Le sentiment qu’il s’évanouit, qu’il se dissipe, qu’il va disparaître. C’est un adieu. Il transparaît, semble s’enfoncer, se défaire dans l’espace. Et lorsqu’il revient à nous, renaissent des points d’ombre, des courbures, des plans, des reliefs : le volume réapparaît. Voir ce corps. Du coup d’œil au regard. Mon regard n’est plus tranquillement posé sur un objet sûr, constant, à disposition. Ce n’est plus le regard qui s’y connaît, à qui on ne la fait pas, qui reconnaît sans voir. Désormais il est atteint, bousculé par l’équivoque de cette présence qui n’appartient à aucun présent, détruit même le présent où elle semble se produire.[8]
Cette instabilité, cette plasticité des corps et des visages, cette suspension du temps et de l’espace sont au cœur de l’expérience que nous transmet Giacometti dans son œuvre silencieuse aussi bien que dans ses Écrits. Cette œuvre nous invite à une attention plus aiguë à l’espace, aux corps, à la présence, composants essentiels du théâtre. Ces Écrits se présentent avant tout comme le témoignage d’un regard à la poursuite du réel. Nous avons convié les spectateurs à faire une expérience d’un regard qui soit semblable à celle du peintre. Il s’agissait de mettre en place un dispositif qui produirait sur le plateau une image inquiète, tremblée, vacillante et une présence humaine fragile et rayonnante, forte de sa fragilité même.
*
« On sait ce qu’est une tête ! » On se souvient de ces mots que Breton lance à Giacometti lors de la rupture de ce dernier avec le surréalisme. Ce sont en effet les têtes qui animent Giacometti et plus encore, c’est le regard : « Un jour, alors que je voulais dessiner une jeune fille, quelque chose m’a frappé, c’est-à-dire que, tout d’un coup, j’ai vu que la seule chose qui restait vivante, c’était le regard. Le reste, la tête qui se transformait en crâne, devenait à peu près l’équivalent du crâne du mort. Ce qui faisait la différence entre le mort et la personne c’était son regard. Alors je me suis demandé – et j’y ai pensé depuis – si, au fond, il n’y aurait pas intérêt à sculpter un crâne de mort.[9] On a la volonté de sculpter un vivant, mais dans le vivant il n’y a pas de doute, ce qui le fait vivant, c’est son regard. »[10]
A propos des portraits qu’il réalise, Antonin Artaud parle, lui, d’une quête éperdue du visage : « Les traits du visage, écrit-il, n’ont pas encore trouvé la forme qu’ils indiquent et désignent, et ne font qu’esquisser […] Ce qui veut dire que le visage n’a pas encore trouvé sa face […] c’est au peintre de la lui donner. »[11] Ou encore : « Depuis mille et mille ans en effet que le visage humain parle et respire, on a encore comme l’impression qu’il n’a pas encore commencé à dire ce qu’il est et ce qu’il sait. »[12]
Ce sera donc cette quête éperdue, cette interrogation assidue du visage humain que poursuivra Giacometti après sa rupture avec Breton. S’il n’arrive pas à retenir ce qu’il voit, c’est que, dit-il : « Les têtes des personnages ne sont que mouvement perpétuel du dedans, du dehors, elles se refond sans arrêt, leur côté transparent. […] Elles sont une masse en mouvement, allure, forme changeante et jamais tout à fait saisissable ».[13] Certes, comme le note Didi-Huberman, Giacometti dans ses propos « rejoue, comme trop souvent, ce topos de la littérature artistique en quoi nous reconnaissons les « quêtes passionnées », les « échecs sublimes » et les « miracles » dont tant d’artistes, réels ou mythiques, furent crédités, depuis le Grec Apelle jusqu’au Frenhofer de Balzac, depuis Léonard jusqu’à Cézanne, de qui Giacometti voulait clairement prolonger, réincarner, la légendaire inquiétude ».[14] Il n’empêche : « L’apparition parfois, je crois que je vais l’attraper, et puis, je la reperds, et il faut recommencer ».[15] Giacometti sent que ce qu’il réalise le trahit, n’égale pas sa vision. Mais ne serait-ce pas tant l’incapacité du peintre à réaliser ce qu’il voit, (ce qu’il déclare jusqu’à exaspérer ses proches), mais, plus précisément, parce que « le propre du corps est de pouvoir être autre que ce qu’on voit » comme l’écrit Artaud ?[16] Ce ne serait donc pas tant une incompétence qu’une impossible saisie de l’être. C’est que le visage se dérobe à l’absolue transparence du perçu. Le tourment de Giacometti est cet effort qui se heurte à l’invisibilité qui se loge au cœur même du visible, qui lui est coalescente. À cette présence qui s’offre en se retirant. C’est cette difficulté même de la présentation à laquelle il s’affronte, et qui le meut. : « Au cœur, au plus intime du fait même de présenter, écrit Philippe Lacoue-Labarthe, dans une manière (cela relève en effet du style) de faire paraître l’inapparaissant qui sous-tend, ou plus exactement qui se retire et se referme dans la présentation même.».[17] Ce que nous voyons n’épuise pas la présence. Elle se donne en son retrait, de sorte qu’elle doit être retracée sans fin. Cette impossible capture de l’être, son dérobement exaspère le désir. « Ce qui arrive est l’insatiable désir de ce qui n’arrive pas » écrit Bataille.[18] Ce dérobement est la condition de l’œuvre, son épreuve, la longue marche dit Giacometti.
« Ce que Giacometti sculpte, c’est la Distance ».[19]
La mise place du modèle pour le portrait chez Giacometti obéit à une ordonnance extrêmement précise. Il s’agit de trouver la juste distance, la bonne orientation. C’est ce que rapporte James Lord : « En fin de compte, il mit son chevalet en place et posa auprès un petit tabouret dont il ajusta soigneusement les pieds de devant à deux marques rouges peintes sur le ciment de l’atelier. Il y avait des marques semblables destinées aux pieds de devant de la chaise du modèle, qu’il m’invita à mettre en place avec une égale précision. […] Il était assis de telle sorte que sa tête se trouvait à un mètre vingt-cinq ou un mètre cinquante de la mienne et me regardait à quarante-cinq degrés par rapport à la toile placée juste devant lui. Il ne m’indiqua aucune pose à prendre, mais il me demanda de le regarder en face, la tête droite, les yeux dans les yeux »[20] La distance permet de contrôler les dimensions du modèle. Il faut que celui-ci ne soit ni trop proche, car alors la forme se perdrait au profit du détail, dans des micro-perceptions et le corps deviendrait un paysage chaotique, ni trop loin car alors n’apparaîtrait qu’une silhouette. [21]
Dans la mise en place du modèle, il importe que le corps se détache d’un fond qui maintienne la distance de la reconnaissance. On ne retrouve pas chez Giacometti les grands aplats chers à Bacon. La figure chez Giacometti semble surgir d’un fond immémorial, originaire. Elle en provient, elle s’en extirpe. Elle lui reste liée, profondément ancrée. Ce fond d’ailleurs transparaît sur le corps translucide du modèle, sauf bien entendu sur le visage qui retient, concentre toute la tension du portrait. Comme si une partie du corps était négligée au profit exclusif du regard, ce qui, par ailleurs, s’inscrit dans toute la tradition du portrait. Dans les portraits de Giacometti, surtout ceux de la dernière période, le fond est « à peine esquissé, écrit Dupin, ou tracé avec la plus grande insouciance. L’indifférenciation des fonds souligne l’isolement du sujet et manifeste cette présence du vide autour des êtres et des choses. […] Le fond est savamment abandonné à lui-même ; gris et informe, à la fois sale et lumineux. »[22] Ces fonds recueillent la mémoire de la venue du tableau. On y pressent en effet les premiers essais, les recouvrements des premières figures, les repentirs. Une déchirure du fond, une sorte de halo d’un gris plus clair borde le haut du corps, à hauteur des épaules. Ces auréoles qui entourent la tête sont comme la trace d’un effacement d’une autre version du portrait. Elles rappellent également les icônes byzantines. Ce sont les rapports du fond et de la figure qui génèrent le sentiment de la profondeur. « Moi je pense que Cézanne a cherché la profondeur toute sa vie » déclare Giacometti. Il suivra le même chemin. Cette profondeur, cette ouverture de l’espace que Giacometti associe à un silence est essentielle : « J’avais tout d’un coup conscience de la profondeur dans laquelle nous baignons tous, et qu’on ne remarque pas parce qu’on y est habitué. La profondeur métamorphosait les gens, les arbres, les objets. Il y avait un silence extraordinaire, presque angoissant. Car le sentiment de la profondeur engendre le silence, noie les objets dans le silence.»[23]
La distance, ou plutôt le sentiment de la distance, qui distribue les dimensions est affectée chez Giacometti. Lui, il veut peindre ce qu’il voit, tout simplement. Et voila que les êtres et les objets se rétrécissent vertigineusement sur sa toile. C’est ce qu’il rapporte d’une séance de travail avec son père : « Et moi j’ai dessiné une fois dans son atelier – j’avais 18-19 ans – des poires qui étaient sur une table – la distance normale d’une nature morte. Et les poires devenaient toujours minuscules. Je recommençais, elles redevenaient toujours exactement à la même taille. Mon père agacé, a dit : « Mais commence à les faire comme elles sont, comme tu les vois ! » Et il les a corrigées. J’ai essayé de les faire comme ça et puis, malgré moi j’ai gommé, j’ai gommé et elles redevenues une demie-heure après, exactement au millimètre, de la même taille que les premières. »[24] Il rapporte également qu’à une période de sa vie, l’ensemble de ses sculptures tenait dans une boîte d’allumette ! Ces figurines, il les a sculptées tout simplement comme il les a vues, c’est-à-dire:infiniment distantes, environnées de vide.
Dans le geste de peindre, dans le temps même de l’exécution, la distance se modifie en permanence et le peintre s’affronte au chaos, au déferlement. Il se bat avec un grouillement de couleurs, de traits, de taches. Il se retrouve bientôt face à une muraille de peinture. Il se noie dans cette confusion. Giacometti s’enfonce dans le visage du modèle. Il semble trop proche de la matérialité de la peinture, trop proche du jeté. Il semble s’égarer hors de la composition et perdre la structure.[25] Et pourtant, écrit Deleuze, « ce sont ces petites perceptions obscures, confuses, qui composent nos macroperceptions, nos aperceptions conscientes, claires et distinctes : jamais une perception consciente n’arriverait si elle n’intégrait un ensemble infini de petites perceptions qui déséquilibrent la macroperception précédente et préparent la suivante. »[26] Ainsi, lorsque le spectateur s’éloigne suffisamment de la toile, lorsqu’il prend le recul nécessaire, trouve la juste distance, alors la composition apparaît avec une force incomparable. C’est ce que rapporte Genet à propos de son propre portrait qu’est en train d’exécuter Giacometti : « Le portrait m’apparaît d’abord comme un enchevêtrement de lignes courbes, virgules, cercles fermés traversés d’une sécante, plutôt roses, gris ou noirs – un étrange vert s’y mêle aussi enchevêtrement très délicat qu’il était en train de faire, où sans doute il se perdait. Mais j’ai l’idée de sortir le tableau dans la cour : le résultat est effrayant. À mesure que je m’éloigne (j’irai jusqu’à ouvrir la porte de la cour, sortir dans la rue, reculant à vingt ou vingt-cinq mètres) le visage, avec tout son modelé m’apparaît, s’impose – selon ce phénomène déjà décrit et propre aux figures de Giacometti – vient à ma rencontre, fond sur moi et se re-précipite dans la toile d’où il partait, devient d’une présence, d’une réalité et d’un relief terribles. »[27]
La mise en place de la pose est une mise en scène qui définit une aire de jeu pour un regard halluciné. C’est que le regard porté aux êtres par Giacometti rend compte d’un double mouvement : un va et vient du réel vers l’œuvre et de l’œuvre vers le réel. « C’est que pour compléter la perception, note Merleau-Ponty, les souvenirs ont besoin d’être rendu possibles par la physionomie des données. Avant tout apport de mémoire, ce qui est vu doit présentement s’organiser de manière à m’offrir un tableau où je puisse reconnaître mes expériences antérieures ».[28] Cela signifie que l’expérience valide, vérifie la vision attendue, souhaitée. La vision cherche et trouve sa confirmation. Giacometti retrouve ainsi dans chacun de ses portraits une émotion initiale qui informe son regard. (Est-ce pour cela que les portraits se ressemblent ? « Plus c’est vous, plus vous devenez n’importe qui », déclare-t-il.[29]) Sa réalité, ce qu’il perçoit, est transfigurée. Dès lors l’œuvre se présente comme le rappel, la commémoration d’un événement. Giacometti se lance à la poursuite d’un objet perdu, à la recherche d’un lieu, d’une aire de jeu pour cet événement. Comme l’enfant, il joue et rejoue avec la dimension de l’absence. Ce jeu est fragile, incertain, risqué, mais aussi source de mise en mouvement, source de toute transformation et de jouissance. Le jeu crée la « fête de la mort, écrit Pierre Fédida, […], le jeu éclaire le deuil : il en effectue le sens caché. »[30] À propos du jeu de l’enfant, Winnicott note que cette « précarité du jeu vient de ce qu’il se situe toujours sur une ligne théorique entre le subjectif et l’objectivement perçu » et que « cette aire de jeu où l’on joue n’est pas la réalité psychique interne. Elle est en dehors de l’individu, mais elle n’appartient pas non plus au monde extérieur »[31]. Cette aire se situe dans l’entredeux, en suspens. Une émotion celée dans le passé serait donc le point aveugle que Giacometti ressasse, déploie à l’infini dans son œuvre ; une émotion « originaire » qu’il réactualiserait sans cesse, dont l’origine ne serait pas historique mais hors du temps. « L’origine, écrit Didi-Huberman, n’est pas seulement ce qui a lieu une fois et n’aura plus jamais lieu. C’est tout aussi bien – et même plus exactement – comme ce qui au présent nous revient comme de très loin, nous touche au plus intime, et tel un travail insistant du retour, mais imprévisible, qui viendrait délivrer son signe et son symptôme ».[32]
L’œuvre est ainsi l’aire de jeu où Giacometti renoue et rejoue avec l’absence. Ce jeu est risqué écrit Winnicott, car « il faut admettre que le jeu est toujours à même de se muer en quelque chose d’effrayant. Et l’on peut tenir les jeux (game) avec ce qu’ils comportent d’organisé, comme une tentative de tenir à distance l’aspect effrayant du jeu (play) » (La langue anglaise possède deux mots pour dire le jeu : game est le jeu qui obéit à des règles déterminées, précises, qui donc définissent un cadre, des limites, à l’opposé de play qui est le jeu qui se déploie librement, qui s’ouvre à l’aventure.)
Giacometti hallucine le visage qu’il perçoit. On notera que le mot allemand Gesicht signifie à la fois visage et vision. La commotion revient, se représente. Ce choc, Giacometti le rappelle avec insistance dans de multiples variantes, dont celle-ci : « Quand pour la première fois j’aperçus clairement la tête que je regardais se figer, s’immobiliser dans l’instant, définitivement. Je tremblai de terreur comme jamais encore dans ma vie une sueur froide courut dans mon dos. Ce n’était plus une tête vivante, mais un objet que je regardais comme n’importe quel autre objet, mais non, autrement, non pas comme n’importe quel objet, mais comme quelque chose de vif et mort simultanément. Je poussai un cri de terreur comme si je venais de franchir un seuil, comme si j’entrais dans un inonde encore jamais vu. »[33]
Ce n’est donc pas une distance mesurable que sculpte Giacometti, mais une distance émotionnelle, une distance éprouvée. Cette distance est celle qu’instaure la présence même du modèle. « Cette distance, écrit Maurice Blanchot, n’est en rien distincte de la présence à laquelle elle appartient, de même qu’elle appartient à cet absolu distant qu’est autrui, au point que l’on pourrait dire que ce que Giacometti sculpte, c’est la Distance, nous la livrant et nous livrant à elle, distance mouvante et rigide, menaçante et accueillante, tolérante-intolérante, et telle qu’elle nous est donnée chaque fois pour toujours et chaque fois s’abîme en un instant: distance qui est la profondeur même de la présence, laquelle, étant toute manifeste, réduite à sa surface, semble sans intériorité, pourtant inviolable, parce ce que identique à l’infini du Dehors. »[34] Distance infiniment fluctuante, jamais assurée. Le modèle apparaît comme proche et distant à la fois, distant dans sa proximité même, immergé dans une réalité sans mesure.
Cette présence apparaît à Giacometti dans une suspension du mouvement, comme un surgissement de réel. L’être vu est isolé, séparé, absolument. Il lui est donné comme une suite de d’instants, un enchaînement saccadé d’images, comme le défilement syncopé d’un diaporama plus que dans la continuité rythmique d’un film. « Tous les vivants étaient morts, et cette vision se répéta souvent dans le métro, dans la rue, clans le restaurant, devant mes amis. Ce garçon de chez Lipp qui s’immobilisait, penché sur moi, la bouche ouverte, sans aucun rapport avec le moment précédent, avec le moment suivant, la bouche ouverte, les yeux figés dans une immobilité absolue. »[35]
Les portraits de Caroline
Freud rappelle que « l’impression optique reste le chemin par lequel l’excitation libidinale est le plus fréquemment éveillée » Le regard est désir, il est semblable à la caresse dont parle Levinas, caresse, écrit-il « qui consiste à ne se saisir de rien, à solliciter ce qui s’échappe sans cesse de sa forme vers un avenir – jamais assez avenir – à solliciter ce qui se dérobe comme s’il n’était pas encore. Elle cherche, elle fouille. Ce n’est pas une intentionnalité de dévoilement, mais de recherche : marche à l’invisible. »[36]
Dans la dernière partie de son œuvre Giacometti ne s’occupera pratiquement plus que de trois modèles : ses proches, à savoir sa femme Annette, son frère Diego et enfin Caroline, jeune femme rencontrée dans les bars de Montparnasse.[37] Avec cette dernière, la pulsion scopique sera portée à son comble. C’est toute une érotique du regard qui va se jouer entre eux. « Regarder, c’est exhiber son regard. » (Tertullien) Ainsi chacun va tour à tour voir et être vu. Si modèle et le peintre tendent à fonder une entité unique, voire une fusion, remarquaient Lord et Genet, cette fusion trouvera en Caroline son point d’excès. Plus de cinq ans au total de fascination réciproque, écrit Bonnefoy. Cette passion évoque la passion bataillienne. La passion de ce narrateur absorbé par une intrigue de terreur, de mort et de désir pour Madame Edwarda, « avide de son secret, écrit Bataille, sans douter un instant que la mort régnât en elle. »[38] Comment ne pas citer ces mots : « Elle me vit : de son regard, à ce moment-là, je sus qu’il revenait de l’impossible et je vis, au fond d’elle, une fixité vertigineuse […] L’amour, dans ses yeux était mort, un froid d’aurore en émanait, une transparence où je lisais la mort.»[39] Caroline déclara un jour « J’étais sa démesure. »[40] Avec elle, Giacometti va traverser l’épreuve de l’excès de la présence et de l’excès d’absence. Épreuve de passage de « l’ultramatérialité » d’un corps, d’une « présence exorbitante »[41], à une dématérialisation de ce corps qui s’éloigne, qui se retire jusqu’à devenir une figure du sacré. Sacré dont Jean-Luc Nancy parle précisément en termes d’éloignement : « Ce « divin » ou ce « sacré » n’est autre chose que l’éloignement et le creusement à travers lequel se fait le contact avec l’intime : à travers lequel se déclare la passion de son in/extériorité infinie – passion de souffrance et passion de désir. C’est l’écartement nécessaire à la communication de soi. En ce sens tout portrait est « sacré » (autant dire d’ailleurs « secret ».)[42] C’est que la relation de désir nous place dans un face à face avec quelqu’un qui tout à la fois est une personne et une non personne.
Les premiers portraits de Caroline sont semblables à ceux que Giacometti réalise de sa femme et de son frère. Ils se dépersonnalisent, tendent vers l’anonymat. Le regard se lance, il se jette en avant de « cette face qu’on dirait porteuse d’yeux. »[43] Ce regard semble surgir de très loin, du fond d’une boîte noire. Sur ces premiers portraits, nous discernons les yeux de Caroline. Ils sont d’une fixité cadavérique, comme vitrifiés. Ils touchent, atteignent, percent le regardeur avec la violence inouïe d’une flèche, d’une pointe (punctum). C’est un regard impersonnel, un regard pétrifié qui pétrifie à son tour celui qui le croise. C’est le regard de la Méduse, de cette Méduse qui est à la jouissance par le regard ce que les Sirènes sont à la jouissance par la voix. « Le regard, s’il insiste est virtuellement fou, écrit Roland Barthes dans La chambre claire, il est à la fois effet de vérité et effet de folie. »[44] Le peintre est celui qui méduse le modèle, le paralyse, le fige, l’immobilise sur la toile, mais qui est saisi, médusé à son tour. « Tout tableau est une tête de Méduse, dit Le Caravage. On peut vaincre la terreur par l’image de la terreur. Tout peintre est Persée ». Au fur et à mesure des portraits, les yeux de Caroline disparaissaient pour faire place à un trou noir. Plus de lueur, plus de reflet d’une lumière du monde extérieur dans la pupille, plus d’éclat, plus d’émail du regard. (Barthes) L’iris des yeux s’estompe, les couleurs disparaissent. Reste un point d’intensité. Un point qui serait situé derrière les yeux, comme un regard derrière le regard et qui l’animerait. Un « point intérieur qui nous regarde à travers les yeux » écrit Giacometti.[45] Le noir de la pupille a envahi tout son champ de vision.[46] Ce regard est semblable au trou noir des physiciens, cette région de l’espace qui est dotée d’un champ gravitationnel si intense qu’aucun rayonnement ne peut s’en échapper, où la densité, infiniment compressée en un point, où tous les objets célestes proches, inexorablement attirés, s’y engouffrent et ne peuvent jamais en ressortir. Le regard de Giacometti est aspiré, englouti, défait par la densité ce noir. Les yeux de Caroline se sont retirés pour faire place à une absence de regard. Non, pas tout à fait une absence de regard, ni le regard d’une absente, mais le regard même de l’absence.[47] C’est ce regard de l’absence que Giacometti soutient de toutes ses forces, au risque de défaillir. Le visage est devenu un « conte de terreur. » (Deleuze) Une tête, un crâne. Le visage tout entier est devenu regard. Désormais Giacometti se heurte au « gouffre insondable de la face. » (Artaud) Il fait face à l’anonyme, à ce qu’il y a inhumain dans l’homme, à son visage–bunker, dévisagéifié.[48] « Le visage humain porte en effet une espèce de mort perpétuelle sur son visage » écrit Artaud, « la face humaine telle qu’elle est se cherche encore avec deux yeux, un nez, une bouche et les deux cavités auriculaires qui répondent aux trous des orbites comme les quatre ouvertures du caveau de la prochaine mort. »[49] Rappelons-nous la mouche du récit Le rêve, le Sphinx et la mort de T. : « A ce moment-là, une mouche s’approcha du trou noir de la bouche et lentement y disparut. »[50] Cette mouche est comme un appel du dedans, une invitation à pénétrer à l’intérieur du crâne, à l’intérieur de la caverne qu’est le crâne. Le regard désire l’intérieur du corps, désire pénétrer « dans le lieu du secret, dans la crypte, dans le creuset » écrit Derrida à propos des dessins d’Artaud.[51] Un regard pénétrant donc, par la bouche, par les orbites et qui explorerait les creux, les cavités, qui parcourrait la cave d’un corps devenu caveau. Giacometti, tel Artaud creusant l’énigme du visage humain, cherche alors son lieu dans une cavité. Comme lui, insistant sur les trous du visage, il rencontre « le vide de l’orifice, le chaos, le khaein, la béance abyssale du visage en l’ouverture de tous ses trous, de sa bouche de vérité, de ses yeux creusés.»[52] (Derrida) Dans cette cavité, il vient se lover, il vient y perdre les limites de son corps, vient s’y fondre et s’y confondre. Dans Hier, sables mouvants, Giacometti nous rapporte sous la forme d’un récit vraisemblable, la découverte enfantine d’une grotte près d’un « monolithe d’une couleur dorée, s’ouvrant à la base sur une caverne : tout le dessous était creux, l’eau avait fait ce travail […] Là, j’essayais de creuser un trou juste assez grand pour y pénétrer […] Une fois là, je m’imaginais cet endroit très chaud et noir ; je croyais devoir éprouver une grande joie. »[53] Il construit donc un vide pour venir l’habiter. Un creux où vient séjourner le corps. Pour y jouer et jouir. Il rejoint ainsi la matrice originaire à laquelle il s’identifie. Comme s’il avait retrouvé un lieu de vérité. S’y perdant, s’y abandonnant, il devient l’espace environnant, il devient le vide même.
L’une des oeuvres les plus frappantes de cette identification de Giacometti avec le vide est certainement L’objet invisible (Mains tenant le vide) qui date de 1934. Statue au corps de femme, dotée d’un visage animal et dont les longues mains presque jointes, enclosent et maintiennent une place vacante. Bonnefoy établit un rapprochement avec La Madone entourée d’anges, tempera sur panneau de Cimabue que Giacometti appréciait tout particulièrement. Cette Madone présente de même des doigts très minces, effilés qui enserrent l’enfant Jésus. Avec prudence, devant cette oeuvre « si clairement oedipienne », Bonnefoy avance : « Postuler l’enfant dans ces mains, le percevoir comme le fils absent et présent qui donnerait sens au fantasme, est moins une rêverie, à mon sens, qu’approcher la vérité de l’œuvre. »[54] « Je rappelle, poursuit-il, que La femme cuillère, de quelques années antérieures, nous était paru gravide, mais d’un enfant qui lui aussi était un “vide”, un néant tout autant qu’une présence ».
Ce que voit Giacometti en Caroline le consume. Son désir exacerbé est semblable à celui du chasseur Actéon. Actéon désire Diane, la « chasseresse court vêtu ». Posté dans les fourrés, il surprend nue la déesse prenant son bain, entourée de ses suivantes. Diane l’aperçoit. Alors, « elle puisa de l’eau et inonda le visage du jeune homme […] et elle ajouta « Et maintenant, libre à toi d’aller raconter, si tu le peux, que tu m’as vu sans le voile ! »[55] Le voyeur est percé par l’objet de son regard. L’excès du voir et du savoir (Oedipe, Tirésias) est condamné par les grecs qui y voient là démesure. La prétention de saisir la vérité nue, sans voile, mène à l’éblouissement, à la folie, à la mort par mise en pièces du corps, démembrement, dispersion ou dévoration.
La « Pointe à l’œil » (1931), est une œuvre tout à fait exemplaire de cette intrication de jeu, de désir et de violence. Elle est l’image même du regard acéré, aiguisé, pénétrant de Giacometti. Cette oeuvre a la dimension d’un jeu de société. Un socle de bois rectangulaire est creusé en son pourtour d’une rigole qui dessine un circuit. À l’une des extrémités de ce socle, une tête de très petite dimension figée par un clou et, lui faisant face, un stylet – une longue lame effilée – fixée également sur une courte tige d’acier. Cette pointe, frôle les yeux du visage, elle est sur le point de s’enfoncer dans l’œil, de crever les yeux. Une suite de photographies en noir et blanc de Man Ray qui se joue de l’ombre portée du stylet, renforce cette impression de culte froid et glacé de mise à mort. Il y a chez Giacometti une cruauté à l’œuvre.[56] Ce que rappelle Jacques Dupin : « Il y a, il y avait surtout, chez Giacometti, un instinct de cruauté, un besoin de destruction qui conditionnent étroitement son activité créatrice. […]. Le spectacle de la violence le fascine et le terrifie. Naguère, avec des personnes de rencontres ou des amis, surtout des femmes, il ne pouvait s’empêcher d’imaginer comment les tuer »[57]. Ce qui nous dit clairement La Pointe à l’œil, c’est que, d’une part, le regard est désir et profanation et, d’autre part, que regarder intensément mène à l’aveuglement. Par son excès, le peintre perd son modèle et il se perd lui-même. Il fera désormais l’expérience de la nuit. Une fois encore, Giacometti nous semble proche de L’expérience intérieure de Bataille qui écrit « Ce qui se trouve alors dans l’obscurité profonde est un âpre désir de voir quand, devant ce désir, tout se dérobe. »[58] Ces mots pourraient concentrer l’expérience de Giacometti avec Caroline. Se perdre et perdre l’œuvre. Et si l’aveuglement était une des conditions qu’exigeait l’œuvre ? Rappelons ces mots de Didier Anzieu : « Devenir créateur, c’est laisser se produire, au moment opportun d’une crise intérieure (mais ce moment, toujours risqué, ne sera reconnu opportun qu’après coup), une dissociation ou une régression du Moi, partielles, brusques et profondes : c’est l’état de saisissement. »[59]
*
« C’est une suspension, c’est Elle. »
« En face d’une suspension, il dit : « C’est une suspension, c’est Elle. » Et rien de plus. Et cette constatation soudaine illumine le peintre. La suspension. Sur le papier elle sera, dans sa plus naïve nudité. » Jean Genet[60]
Mais la comédienne n’est pas le modèle du peintre, elle n’est pas figée sur une toile inanimée. Elle parle ! Et de même que le regard, la parole scrute et fouille le visible. La parole dirige la vue, elle fait voir, fait arriver, fait apparaître. Avec précision, les mots de Giacometti vont sculpter ce visage de la comédienne exposé aux regards. Le spectateur est suspendu aux lèvres de l’actrice. Ce qu’il contemple (car il s’agit bien d’instaurer une contemplation, une contemplation visuelle et auditive) est tracé par les mots qu’elle prononce. Sa perception est guidée, sa vision modelée par la parole. Les mots de Giacometti évoquent, suggèrent, rappellent, font entrevoir. Ils dirigent l’attention du spectateur, la focalise. S’il n’y avait pas de mots, juste une présence muette sur le devant de la scène, la tension se dissiperait rapidement et rien se manifesterait. Le visible est ainsi fictionnalisé par le discours. Les mots que profère la comédienne orientent les regards portés sur son corps, ce sont des caresses ou des coups dont elle perçoit la touche. Le spectateur entre ainsi en travail. Ce qu’il perçoit oscille dans l’entre-deux du voir et de l’entendre. « Écouter quelqu’un, entendre sa voix, exige de la part de celui qui écoute, une attention ouverte à l’entre-deux du corps et du discours et qui ne se crispe ni sur l’impression de la voix [ou du corps] ni sur l’expression du discours. » (Denis Vasse)[61] La voix féminine qui emprunte le “je” de Giacometti renforce cette oscillation. Le choix d’une femme pour interpréter ces Écrits est essentiel. Il crée un écart entre ce que le spectateur voit et ce qu’il entend. Cette inadéquation met son écoute et sa vision en éveil, en alerte. Si un homme disait, jouait les mots de Giacometti peut-être qu’à la limite, on ne le verrait même pas. Nous verrions quelqu’un qui joue (à) Giacometti, c’est-à-dire qu’il apparaîtrait comme signe – mime d’un personnage – quand bien même s’il s’en distancierait. Ce n’est pas notre propos. Ce que nous cherchons, ce n’est pas la production d’une image, reconnaissable, identifiable, mais plus exactement l’exposition d’une présence qui échapperait de justesse au signe.
Le déploiement de la parole opère également un ralentissement, une élongation du temps. Ce déploiement ouvre le temps de l’attention. Il crée un temps suspendu, celui de la contemplation. Le temps affecte le regard. Cette contemplation n’est pas passivité, mais réception active : la chose vue n’est pas donnée une fois pour toute, elle est labile, malléable. Une image faisant signe, indiquerait une direction, qui désignerait mais dont le sens resterait à produire. Une image qui montrerait, qui ne démontrerait pas. Cette contemplation serait analogue à l’écoute flottante de Freud. Contemplation flottante donc, qui n’établirait pas une hiérarchisation des données, qui ne trancherait pas immédiatement, ne conclurait pas de suite. Cette contemplation crée un regard actif. Le spectateur est invité à devenir co-créateur de ce qu’il voit. Il ne s’agit pas de comprendre mais de recevoir, d’accueillir et d’élaborer. Le visage de la comédienne ne se présente pas en effet comme un signe à interpréter, il ne supporte pas une signification. Il n’est le pas le support d’une idée, d’une intelligibilité. Il est cet « essentiellement caché [qui] se jette vers la lumière, sans devenir signification. »[62] L’apparition de l’autre n’est pas un événement de la connaissance, mais un événement du sentiment. Il ne signifie pas autre chose que ce qu’il est. « Le messager est le message » dit Levinas. L’autre n’annonce aucun sens, il est l’annonce, c’est-à-dire le non-sens, « le visage d’autrui est sa manière de signifier. »[63]
Donc la comédienne est assise à l’avant scène sur une chaise, très proche du public. Le regard du spectateur s’immobilise sur son visage dans un long plan fixe. Pas d’action, si ce n’est le déploiement de la parole. Dans ce plan fixe, le corps vu est à la fois objet et sujet, « vif et mort à la fois » (Giacometti). Dans le portrait du peintre, c’est la figure inanimée qui nous regarde comme un être vivant. Quant au modèle et à la comédienne, l’opération est inversée : pris dans l’image, c’est le vivant qui est vu comme une chose. Dès lors, elle est une présence en suspend, prise dans un entrelacs d’animé et d’inanimé. Dans les deux cas, il s’agit d’un échange, de la rencontre avec un regard. Que cet échange soit effectif (la touche directe) ou seulement pressenti (le regard adressé, tourné vers), c’est le sentiment de se sentir regardé qui nous retient. Et ce sentiment, c’est précisément l’expérience de l’aura dont parle Walter Benjamin : « Car il n’est point de regard qui n’attende une réponse de l’être auquel il s’adresse. Que cette attente soit comblée (par une pensée, par un effort volontaire d’attention, tout aussi bien que par un regard au sens étroit du terme), l’expérience de l’aura connaît alors sa plénitude. [Elle] repose donc sur le transfert, au niveau des rapports entre l’inanimé – ou la nature – et l’homme, d’une forme de réaction courante dans la société humaine. Dès qu’on est – ou qu’on se croit – regardé, on lève les yeux. Sentir l’aura d’une chose, c’est lui conférer le pouvoir de lever les yeux. »[64] Interpellé, celui qui se croyait en sécurité dans la pénombre de la salle est contacté, saisit, pris dans un face à face. Face à face qui est un toucher à distance. Celui qui est là, devant moi, mon semblable, celui qui est vu soudain me regarde. « Apparition incertaine » dit Giacometti. « Apparition interrogative » écrira Sartre.
Le spectateur se fait alors voyeur, voyant. L’inconnu, c’est ce qui est jeté là devant lui, ici et maintenant, en pleine lumière. Présence troublante, que rien ne cache, qui s’offre à nous et qui ne peut être saisi. Tout est ici à découvert, il n’y a rien derrière et cela nous reste opaque. Cette exposition est sans mystère, sans dramatisation, sans pathos, d’une simplicité sans mesure. Ce n’est pas un corps mystérique : ce corps est l’évident, le manifeste secret de l’être, le mystère de sa clarté même.
Giacometti n’ajoute pas, il retire de la matière à ses sculptures, il abstrait de la terre jusqu’à l’instant critique où la statue est proche de l’effondrement, jusqu’à que cela ne tienne qu’à un fil. Cette tension vers l’épure est excès. Excès de simplicité et de nudité. Excès que nous devons transposer sur la scène. Que l’extrême simplicité recherchée ne devienne pas synonyme d’austérité. Si la comédienne bouge peu – et la pose en effet est infiniment sobre – elle ne se fige pas. C’est dire que « son immobile est un actif agissant. » (Artaud) Elle est en arrêt, ce qui ne veut pas dire en repos. « La puissance du combat s’accomplit dans le silence de toute action. » (Bataille)[65] Elle est en arrêt, comme l’animal est aux aguets. Son immobilité est un mouvement sur place, sans déplacement, qui agit par vibration et rayonnement, irradiation. Elle est en vigilance. Son calme provient de son écoute attentive de la profondeur silencieuse de l’espace. La difficulté consiste à préserver la vitalité, la force affirmative et la légèreté de l’esquisse au sein même de l’épure. On se souvient que Giacometti disait envier la grâce aérienne de Miro.
Dans Le rêve, le Sphinx et la mort de T., texte souvent cité ici, Giacometti nous révèle l’expérience – le choc, la commotion –, « une trouée dans la vie » écrit-il,[66] qu’il a éprouvé en assistant à la mort d’un proche. Expérience capitale a bouleversé de fond en comble sa manière d’appréhender le monde. Une révélation que cette mort de l’autre et aussi, peut-être, une chance. Oui, tout a changé, une porte s’est ouverte brusquement sur un monde inconnu jusqu’alors. « Ce jour-là, la réalité s’est revalorisée pour moi du tout au tout »[67] dit-il. Le texte part à la dérive, il fonctionne par sauts d’affects, par associations ; il passe allégrement du présent au passé, accumulant les retours en arrière, les reprises et les ressassements. Giacometti semble prendre un malin plaisir à brouiller les pistes, à s’égarer et à égarer son lecteur. Ce que nous retiendrons : l’expérience de cette mort en directe nous est rapportée avec distance. L’expérience est si grave, elle l’engage si profondément qu’elle ne peut être restituée que dans un éloignement de soi, avec légèreté, une légèreté essentielle. Si la mort est toujours présente, c’est avec « le sourire aux lèvres », selon l’heureuse expression de Meyerhold que la comédienne interprétera ce texte.[68] C’est en souriant, rappelle Deleuze, que Cézanne prononçait ces mots : « C’est effrayant la vie ! » D’autre part, autre forme d’éloignement : ce récit prend un tour fictif. Son statut est de fait indécidable. Est-ce du biographique ?, est-ce de la fiction ? Vérité des faits ou vérité de l’émotion ? Cet indécidable, cette suspension, est le moteur cette écriture, ce qui l’anime, il en est le ressort. (Cet indécidable consisterait à ce que l’événement qu’est la mort d’autrui nous met hors de nous-même, que retenons-nous ?, qu’arrive-t-il, exactement ? ) Retenons cet éloignement de soi, il est capital. Il oriente en effet de manière décisive l’interprétation de l’actrice. Il détermine sa tension affective. Cet éloignement est un rapport de non-identification avec le dire du texte et le pathos qu’il véhicule. La comédienne ne mimera donc pas les affects, ne les redoublera pas lors de son interprétation. Elle maintiendra une distance. Non pas la distance de celle qui sait, ou une distance impassible, car, bien entendu elle est traversée par les émotions, le texte résonne en elle, dans son intimité, mais bien parce que la distance est inscrite dans le procès même de l’émotion, comme dessaisissement de soi. Celui qui est touché, saisi, affecté ne s’appartient plus. C’est précisément cela faire une expérience. Rappelons la définition que propose Martin Heidegger : « Faire une expérience avec quoi que ce soit, une chose, un être humain, un dieu, cela veut dire : le laisser venir sur nous, qu’il nous atteigne, nous tombe dessus, nous renverse et nous rende autre. Dans cette expression, « faire » ne signifie justement pas que nous sommes les opérateurs de l’expérience; faire veut dire ici, comme dans la locution « faire une maladie », passer è travers, souffrir de bout en bout, endurer, accueillir ce qui nous atteint en nous soumettant à lui. Cela se fait, cela marche, cela convient, cela s’arrange. » [69]
La comédienne active ce dessaisissement[70], elle joue avec sa propre déstabilisation, avec sa propre fragilité. C’est un art du suspens. C’est l’art du danger, c’est le risque de l’acteur.[71] Nous sommes toujours dans ce jeu de variations infinies de la distance, dans ces jeux du proche et du lointain.[72] À propos de Kafka, Maurice Blanchot fait cette remarque qui vaudra pour le jeu de la comédienne : « Tout se passe comme si, plus il s’éloignait de lui-même, écrit-il, plus il devenait présent. Le récit de fiction met, à l’intérieur de celui qui écrit, une distance, un intervalle (fictif lui-même), sans lequel il ne pourrait s’exprimer. Cette distance doit d’autant plus s’approfondir que l’écrivain participe d’avantage à son récit. Il se met en cause, dans les deux sens ambigus du terme : c’est de lui qu’il est question et c’est lui qui est en question – à la limite supprimé. »[73]
Parfois la comédienne ne s’adresse pas directement au public. A qui parle-t-elle ? Elle est sous contrôle, sous la garde d’un regard impersonnel et omniprésent : celui de l’espace dans lequel elle est immergée. Elle se sent comme une chose, une minuscule présence isolée au milieu d’un immense espace. S’exposant à exister dans le visible, elle s’expose à un regard invisible et vide. Les mots qu’elle envoie se diffusent puis se dissipent dans l’étendue indéfinie du plateau. Ils sont destinés aux vivants bien sûr, aux spectateurs dans la salle, mais également aux absents, « au peuple des morts »[74] écrit Genet.
« C’est une suspension, c’est Elle ». Le spectateur ne sera donc pas en face d’images immédiatement identifiables, mais d’images inachevées, en mouvement, inductrices de rêveries, d’émotions et de pensées. Nous emprunterons le terme de défiguration, défiguration créatrice, à Évelyne Grossman: « La défiguration, écrit-elle, est à la fois dé-création et re-création permanente des formes provisoires et fragiles de soi et de l’autre. »[75] L’image première, celle du premier coup d’œil, de la première reconnaissance s’effrite, se défait, perd de sa stabilité, de son assurance, de sa sûreté. L’image est plastique, c’est-à-dire qu’elle possède une capacité à se transformer, à transformer ses propres limites, à se déplacer, à devenir autre.[76] Le vocable modèle indique précisément la plasticité, le modelage, le pétrir, la transformation.
Dans une lettre à André de Rénéville (1933) Artaud écrit : « Il serait vain de considérer les corps comme des organismes imperméables et fixés, Il n’y a pas de matière, il n’y a que des stratifications provisoires d’état de vie. »[77]
Revue Théâtre/Public N° 180, mars 2006
[1] Alberto Giacometti, Écrits, Édition Hermann, Paris, 1992 p. 64.
[2] René Char, « Alberto. Giacometti », Recherche de la base et du sommet, Pauvreté et privilège, 1954
[4] Didier Anzieu, Le corps de l’œuvre, Essais psychanalytiques sur le travail créateur, Gallimard, 1981, p. 93.
[5] Djamel Tatah, Barbara Stehlé-Akhtar et Christophe Bident, Paris Musées, Actes Sud, 2003, p. 107.
[6] La passion selon Georges Bataille. Spectacle réalisé à partir des textes Mme Edwarda et L’expérience intérieure. Mise en en scène de Pierre Antoine Villemaine, avec Gisèle Renard et Yves-Robert Viala. Lumière de Philippe Lacombe. Création au Théâtre de l’Atalante, Paris, 1991.
[7] Une lecture instable, Actes du Colloque Maurice Blanchot, direction Christophe Bident, Pierre Vilar, Éditions Farrago, Automne 2003. Texte repris en 2005 dans la Revue “Littérature”, “Théâtre, un retour au texte ?” Éditions Larousse.
[8] Maurice Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, 1959, pp. 18-19.
[9] Ce crâne sera l’œuvre qu’il réalisera en 1933-34, intitulée Le Cube. Œuvre, par d’ailleurs, que Giacometti ne revendique pas comme étant de la sculpture. Voir à ce propos Georges Didi-Huberman, Le cube et le visage, Autour d’une sculpture de Giacometti, Macula, 1993 ?
[11] Antonin Artaud, dessins, Paris, Centre Georges Pompidou, 1987, p. 48.
[14] Georges Didi-Huberman, Le cube et le visage, op. cit., p. 13.
[15] Entretien avec Pierre Schneider. Écrits, p. 268.
[16] Antonin Artaud, Œuvres complètes, XXII, p.106
[17] Philippe Lacoue-Labarthe, La poésie comme expérience, Christian Bourgois, 1986, p.128
[18] Georges Bataille, Œuvres Complètes XII, p.316
[19] Maurice Blanchot, « Traces » In L’Amitié, Gallimard, 1971, p. 246
[20] James Lord, Un portrait par Giacometti, Collection Art et Artiste, Gallimard, 1991, p.17.
[21] Voir Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Édition Tel Gallimard, Paris, 1993, p.349.
[22] Jacques Dupin, Alberto Giacometti, Textes pour une approche, Fourbis,1991, p.75
[24] Yves Bonnefoy, op. cit., p.65
[25] « Mais la difficulté pour exprimer réellement ce “détail” est la même que pour traduire, pour comprendre l’ensemble. Si je vous regarde en face, j’oublie le profil. Si je regarde le profil, j’oublie la face. Tout devient discontinu. Le fait est là. Je n’arrive plus jamais à saisir l’ensemble. Trop d’étages Trop de niveaux L’être humain se complexifie. Et dans cette mesure, je n’arrive plus à l’appréhender. » Entretien avec André Parinaud, Écrits, p. 270.
[26] Sur les micro et macro perceptions ainsi que sur l’hallucination, voir Gilles Deleuze, « La perception dans les plis », In Le pli, Leibniz et le baroque, Les Éditions de Minuit, 1988, pp. 114-120.
[27] Jean Genet, L’atelier d’Alberto Giacometti, Édition L’Arbalète, Paris, 1958, p.31
[28] Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p.27
[29] Entretien avec Pierre Schneider, Écrits, p.263. Ou encore : « La ressemblance ? Je ne reconnais plus les gens à force de les voir », entretien avec Pierre Dumayet, p. 285
[30] Pierre Fédida, L’absence, Éditions Gallimard, Paris, 1977, p.138
[31] D. W.Winnicott, Jeu et réalité, Folio/Essais, Gallimard,1975, p.103
[32] Georges Didi-Huberman, Devant l’image, Éditions de Minuit, Paris, 1991, p.107. Didi-Huberman renvoie au texte de Pierre Fédida, Passé anachronique et présent réminiscent.
[33] « Le rêve, le Sphinx et la mort de T », texte paru dans la Revue Labyrinthe en 1946, Écrits, p.30
[34] Maurice Blanchot, « Traces » In L’Amitié, Gallimard, 1971, p. 246
[35] « Le Rêve, le Sphinx et la mort de T », p.30. Voir également, l’entretien avec Parinaud, p.265
[36] Emmanuel Levinas, Totalité et infini, essai sur l’extériorité, Martinus Nijhoff Publishers, Quatrième édition, 1971, 235
[37] Yves Bonnefoy, op. cit., p.460. Et, p.452 : « Un intérêt véhément, hors de proportion avec son objet, parut-il à tous ses proches. Un intérêt qui fut cause entre l’un et l’autre de rapports aussi suivis et aussi intenses qu’étranges, et qui durèrent jusqu’à la mort d’Alberto ».
[38] Georges Bataille, Mme Edwarda, Œuvres Complètes III, Gallimard, 1971, p.29
[40] Voir Jean Genet, L’atelier, op. cit., p.40 : « Il regrette les bordels disparus. Je crois qu’ils ont tenu – et leur souvenir tient encore – trop de place dans sa vie, pour qu’on n’en parle pas. Il me semble qu’il y entrait presqu’en adorateur. Il y venait pour s’y voir à genoux en face d’une divinité implacable et lointaine. »
[41] Voir Emmanuel Levinas, Totalité et infini, op. cit. , p. 223.
[42] Jean-Luc Nancy, Le regard du portrait, Galilée, 2000, p. 57.
[43] Yves Bonnefoy, op. cit., p. 309
[44] Roland Barthes, Œuvres complètes (éd. É. Marty), Paris, Le Seuil, t. V, 1995, p. 880.
[46] Giacometti déclare à André Parinaud : « Oui, tout l’art consiste peut-être à arriver à situer la pupille… Le regard est fait par l’entourage de l’œil. L’œil a toujours l’air froid et distant. C’est le contenant qui détermine l’œil. » Écrits, p.270
[47] « C’est ainsi que le portrait immortalise : il rend immortel dans la mort. Mais plus exactement peut-être : le portrait immortalise moins une personne qu’il ne présente la mort (immortelle) en (une) personne ». Jean-Luc Nancy, Le regard…, op. cit., p.54
[48] Voir Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille Plateaux, Éditions de Minuit, Paris, 1980, pp. 208-230
[49] Antonin Artaud, dessins, Paris, Centre Georges Pompidou, 1987
[50] « Le rêve, le Sphinx et la mort de T. », Écrits, p. 29.
[51] Voir Jacques Derrida, Artaud le Moma, Galilée, 2002, p.60 et suivantes. Par ailleurs, Derrida fait remarquer que le mot « creuset » est quasi l’anagramme de « secret ».
[54] Voir Yves Bonnefoy, pp. 224-235
[55] Ovide, Métamorphoses III, Flammarion, 1966, p.94
[56] Voir Jacques Hassoun, La cruauté mélancolique, Aubier/Psychanalyse, 1995
[57] Jacques Dupin, Alberto Giacometti, op. cit., p.17
[58] Georges Bataille, L’expérience Intérieure, Oeuvres Complètes I, Édition Gallimard, Paris, pp.144-145
[59] Didier Anzieu, Essais psychanalytiques sur le travail créateur… , op . cit. p. 93
[60] Jean Genet, L’atelier d’Alberto Giacometti, op. cit., p.56
[61] Cité par Roland Barthes, Œuvres complètes (éd. É. Marty), Paris, Le Seuil, t. V, 1995, p.350
[62] Emmanuel Levinas, Totalité et infini, op. cit., p.234
[63] Emmanuel Levinas, Altérité et transcendance, Montpellier, Fata Morgana, 1995, p.172.
[64] Walter Benjamin, « Sur quelques thèmes baudelairiens », trad. M. de J. Lacoste, in Charles Baudelaire, un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, Ed. Payot, 1982, p. 200
[65] Georges Bataille, La pratique de joie devant la mort, Œuvres Complètes I, p. 555
[68] Vsevolod Meyerhold, Écrits sur le théâtre, 1977, p. 115.
[69] Martin Heidegger, Acheminement vers la parole, Tel Gallimard, 1976, p. 143.
[70] Ce que Didier Anzieu repère comme le second moment de l’acte créateur : « La partie du Moi restée consciente (sinon c’est la folie) rapporte de cet état un matériel inconscient, réprimé, ou refoulé, ou même jamais encore mobilisé, sur lequel la pensée préconsciente, jusque-là court-circuitée, reprend ses droits. » op. cit., p. 93.
[71] « Risquer (wagen) écrit Heidegger, signifie : faire entrer dans le mouvement du jeu, mettre sur la balance, lâcher dans le péril » Martin Heidegger, « Pourquoi des poètes ? », Les chemins qui ne mènent nul part, Tel Gallimard, p. 338.
[72] Ce jeu avec la distance est l’une des définitions qu’attribue Walter Benjamin à l’aura : « Unique apparition d’un lointain, si proche qu’elle puisse être » In L’œuvre d’art à l’ère de la reproduction technique (1936) trad. Maurice de Gandillac, Paris, 1971, (éd. 1974), p. 145.
[73] Maurice Blanchot, La part du feu, Gallimard, 1979, p.29.
[74] Jean Genet, op. cit., p.13.
[75] Évelyne Grossman, La défiguration, Artaud, Beckett, Michaux, Les Éditions de Minuit, 2004, p. 9.
[76] Voir Catherine Malabou, La plasticité au soir de l’écriture, Dialectique, destruction, déconstruction, Collections Variation, Éditions Léo Scheer, 2005. Elle écrit notamment, p.108 : « Le régime privilégié du changement est l’implosion continue de la forme, par où elle se remanie et se reforme continuellement. »
[77] Antonin Artaud, Œuvres Complètes, tome V, Gallimard, p. 148.