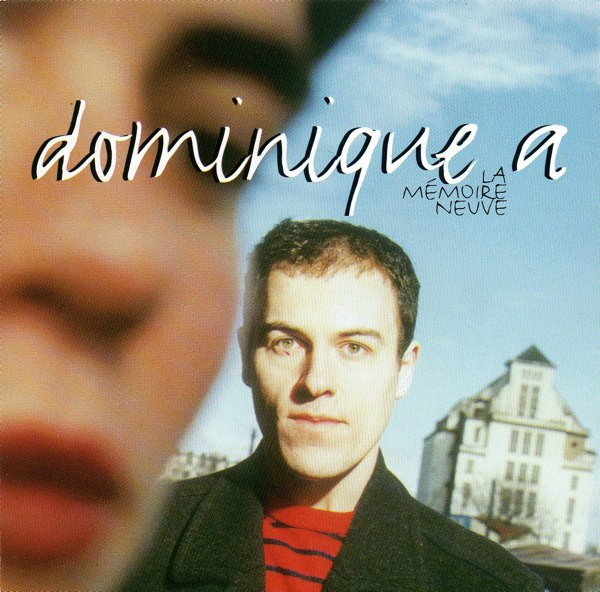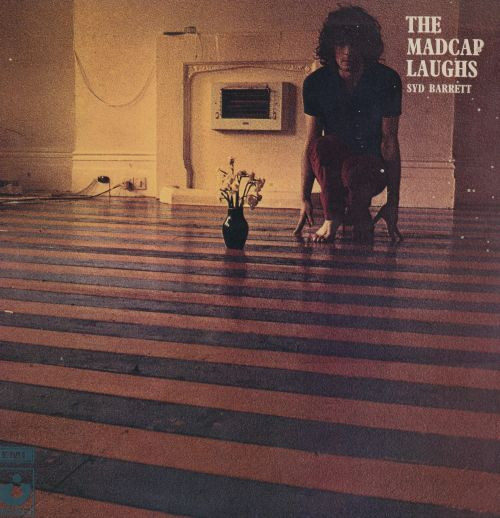Ce coquin de Malcom McLarren, vers lequel s’étaient retournés les membres de Adma and the Ants pour muscler leurs ventes qui avoisinaient l’infinie asymptote, les prenant donc sous son aile, fomente une mutinerie contre leur chef, nommément Adam Ant, et les autres membres le foutent dehors, et fondent les Bow Wow Wow. N’imp.
Ils avaient pourtant réalisé leur troisième et super album, Prince charming (#521), muni de deux singles notables. N’imp.
Devant cet état de fait n’imp, Adam Ant fonde son propre groupe en solo, sobrement intitulé Adam Ant, et Friend of foe est son premier essai. Puisqu’on n’en est pas à une étrangeté près, on y mettra une reprise des Doors (Hello I love you) et une section de cuivres très présente. On oscillera entre rock’n’roll basique et excursions plus new wave, mais dans l’ensemble, on garde l’esprit punk, c’est à dire, en l’espèce, « desperate and not serious ». Et ça marche.
Adam Ant ira, lui aussi pionnier qui n’a pas froid aux yeux, vers le hip-hop blanc (?), et vers d’autres territoires, toujours avec Marco Pirroni (Sinead O’Connor, The SLits) tout en voyant sa réputation décliner petit à petit, jusqu’à la dépression et un modeste retour ces temps-ci après vingt ans d’absence. Ce premier album reste sans doute, avec le dernier d’Adam and the Ants, son effort le plus notable.