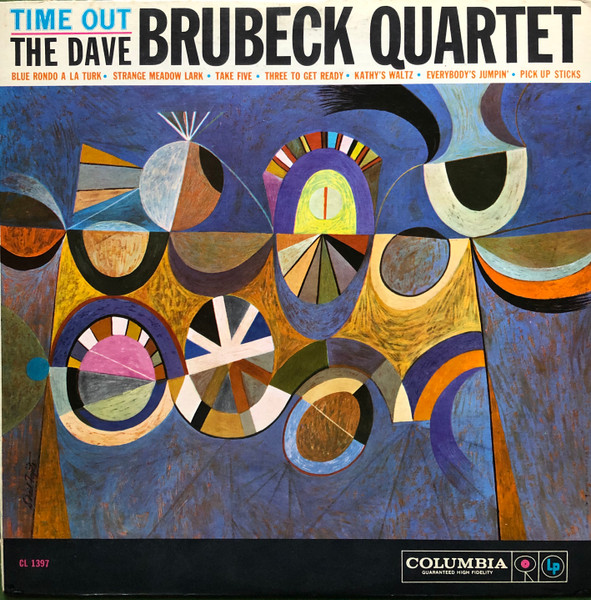Démarrage en fanfare, enfin une fanfare bringuebalante, hachée, de zombies, Paralyzed en effet, cet album est une réussite qui permet d’allier en quelque sorte énergie punk et fantaisie funk (mais sans les paillettes). Gang of Four, politiquement conscient, mais sans moraline, a produit de beaux albums, dont Entertainment!, son premier classé dans la Souche 18e, c’est-à-dire… 3e si lo’n compte les ex-æquo.
Comme on l’a déjà dit, la meilleure guitare rythmique du monde de feu Andy Gill, vient taillader des textes déjà carrément acérés — sur cet étrange rythme funky (If I could keep it for myself). Ce n’est pas exactement dansant, mais c’est exactement ce qu’on attendrait d’un samizdat musical. Quelques titres rappellent le premier opus, et sont du même acabit, tant du point de vue du son (Ouside the trains don’t run on time) que des paroles (Cheeseburger).
Un disque énergique, une virée dans les subtilités du soft power occidental, sans doute un peu moins parfait (comme si ça existait) que le précédent, mais certainement tout aussi plaisant et surtout actuel.