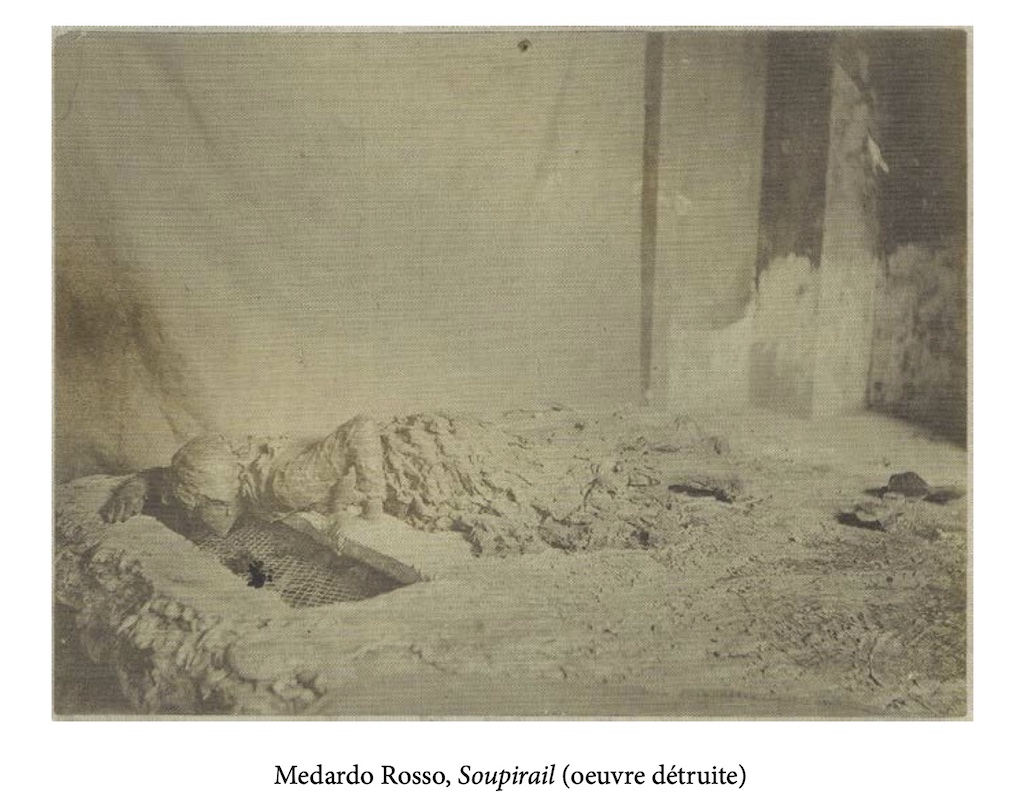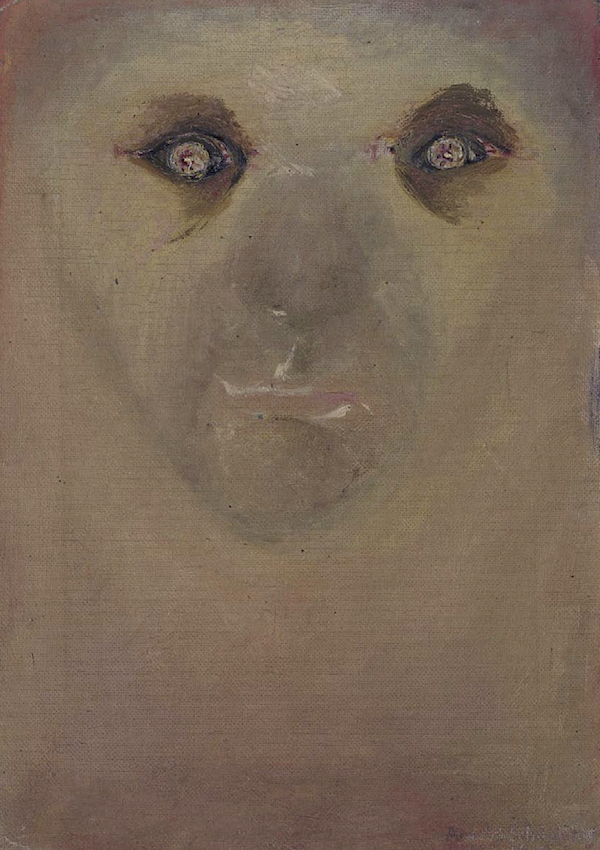Nous accueillons Lucie Desaubliaux pour un feuilleton inédit qui nous mènera de Samain à Imbolc. On est très heureux de recevoir l’auteure de La nuit sera belle (Actes Sud, 2017).
Lucie Desaubliaux écrit, pour les adultes et pour les enfants. Elle réalise aussi des performances et des installations. Elle code des sites internets, des bases de données, des jeux vidéos et des outils de cartographie ou de collaboration. Elle micro-édite des livres et des expériences numériques. Elle s’intéresse à l’agencement des formes de pensées, aux notions de travail et d’oisiveté et à la différence entre ce que est perçu et la réalité invisible du monde, en se nourrissant de différents domaines scientifiques qu’elle ne comprend pas trop et réinterprète beaucoup. Elle vit et travaille en Bretagne, seule ou en collectif : elle fait notamment partie de La Guerrière, du Vivarium et de WMAN.
LA FOUDRE
La foudre tombe quelque part en plein milieu de la mesa.
Le vieux dit : elle est pas tombée loin. Nash ne dit rien. La foudre a tiré un trait courbe du ciel à la terre, en plein milieu du paysage de Nash et du vieux. Elle est partie du plein milieu de leur ciel jusqu’au plein milieu de leur mesa. Elle a coupé en deux le monde de Nash et du vieux, qui sont assis sur des transats en toile de nylon en plein milieu de rien et de quelques bouteilles vides.
Le vieux porte un slip de bain rouge. Il crache sur le sol pour conjurer la foudre et il répète : elle est pas tombée loin. Nash crache sur le sol pour conjurer le vieux et les histoires de foudre qu’il raconte à chaque orage et c’est la saison en ce moment. Les crachats sont immédiatement absorbés par l’argile sèche, il ne reste que deux auréoles sombres et un filament de rôti de porc.
Le vieux pense qu’il est maudit, la foudre ne tombe jamais loin et elle lui est tombée trois fois sur le corps. Avec le slip de bain rouge, on voit bien les grumeaux en haut de sa cuisse gauche, l’anémone blanche sur la peau noire au-dessus de son pied, le gauche aussi, et le côté droit de sa bouche qui descend un peu plus bas sur son menton. Ce sont les trois marques de la foudre les trois fois où elle n’est vraiment pas tombée loin.
Le vieux raconte la foudre en montrant avec son index son corps autour du slip de bain. Pendant qu’il raconte il y a encore des éclairs et du tonnerre qui avalent beaucoup de ses mots. Chaque fois le vieux hausse les sourcils et hoche la tête : c’était encore vraiment pas loin. Il répète ce que Nash n’a pas pu entendre et Nash n’entend pas, il ne dit rien. Il ne regarde pas le corps du vieux, il regarde la petite fumée là où la foudre est tombée en plein milieu de sa mesa. La petite fumée est vraiment très petite, il faut regarder un peu à côté pour se rendre compte qu’elle existe, à l’Ouest de Dead Horse Canyon.
Le ciel violet craque enfin au milieu d’un coup de tonnerre et tire des fils de pluie jusqu’au sol devant la petite fumée. Le vent est Nord-Nord-Est, la pluie progresse vite vers Nash et le vieux. Ils l’entendent avancer sur l’argile qui change de couleur, la boue trempée devient rouge. Le vieux ne parle plus maintenant, il y a trop de bruit. Il bascule le dossier de son transat un peu plus en arrière, il étend de chaque côté ses bras et ses jambes. Ses bras pendent dans le vide et ses jambes reposent sur ses talons, la pluie arrive sur son corps et lave la poussière et la sueur et mouille le slip de bain qui devient rouge foncé. Nash est rentré dans la cabane en bois derrière, les bouteilles vides se remplissent ou se renversent sur le sol.
Si Nash était encore dehors il verrait que la petite fumée à l’Ouest de Dead Horse Canyon s’est éteinte
mais :
la foudre n’est pas tombée loin.
Elle est tombée sur un genévrier millénaire qui s’est embrasé. Le genévrier s’est consumé lentement et ses racines ont transmis le feu à la couche de tourbe souterraine. La tourbe a entamé une combustion lente et inextinguible qui pourrait durer des dizaines voire des centaines d’années.
La marche d’un feu de tourbe est inexorable
à l’Ouest de Dead Horse Canyon,
la température va monter à 345°C sous 95 centimètres d’argile
le feu va progresser d’un à deux mètres par semaine vers le Sud
il va longer Posey Creek
dans dix-huit mois il passera invisible entre les deux transats en toile de nylon
jusqu’à la cabane en bois dont il enflammera les fondations en pin
la cabane disparaîtra dans la nuit personne ne la verra brûler
le vieux et Nash seront repartis après leur saison de rangers
et le lendemain matin
un chien jaune
viendra renifler le carré de sol noir qui a poussé pendant la nuit
en plein milieu de sa mesa.