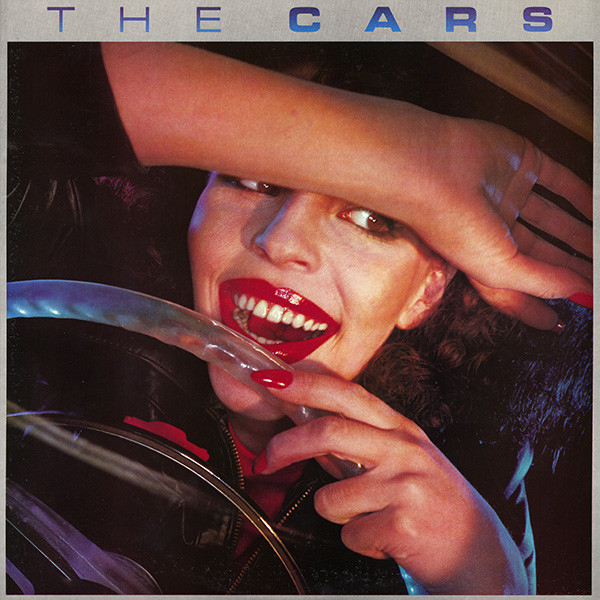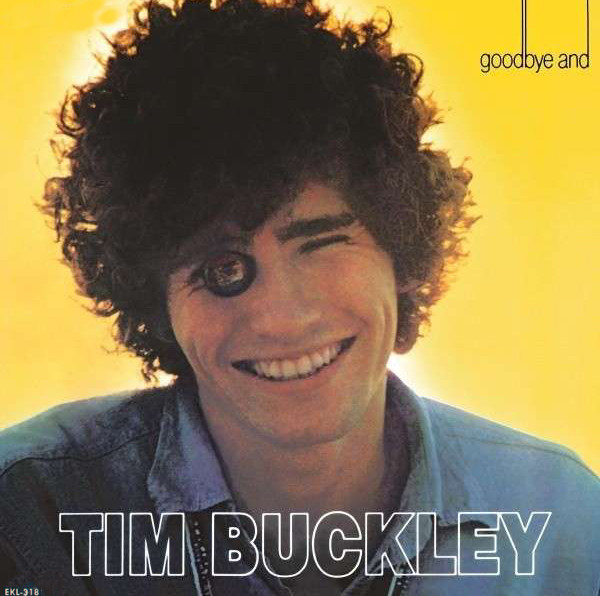Ah quel plaisir, Freedom ! Album acheté en cassette à sa sortie dans un feu Rond-Point.
C’était donc le creux de la vague rock, et on n’espérait pas mieux. C’étaient les grands festivals humanitaires, c’était assez dur, en réalité. Et voilà que sur la scène du festival pour la libération de Nelson Mandela, entre Neneh Cherry, Simple Minds, Jackson Browne ou Lou Reed, déboule un Neil Young dégingandé mais régénéré, seul, seulement guitare acoustique, harmonica, et voix, jeans troués.
Ce fut pour moi un choc. L’album était sorti à peine six mois auparavant et marquait le retour du solitaire canadien. Ce fut un choc de voir ce petit bonhomme sur cette immense scène, qui semblait vouloir dire à la face du monde que le rock des stades était dépassé, que rien ne valait une guitare sèche.
L’album est surpuissant avec un bonne demi-douzaine de classiques — ça aussi c’était un choc pour un album des années 80. Simple, bruyant, efficace. Crime in the city, Too far gone, une bienvenue reprise de On broadway (avec des accords distordus non moins bienvenus) et la charmante Eldorado. C’est je crois le premier disque de Young dont je parle ici, c’est également le premier que j’ai entendu, et le lien avec Zuma (1975, #357), Tonight’s the night (1975, #51) ou Rust never sleeps (1979, #272) me parut évident.
Il l’avait fait : alors qu’allait paraître Harvest moon (#601), Neil Young avait ouvert la porte au grunge et au renouveau rock ou punk de ces années, couronnées par le long compagnonnage de Pearl Jam.