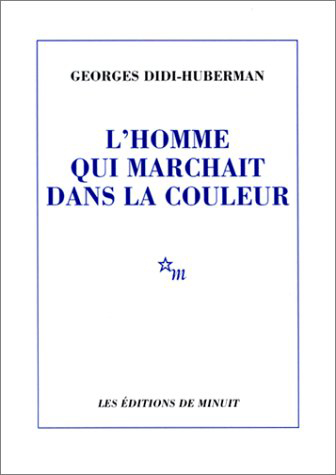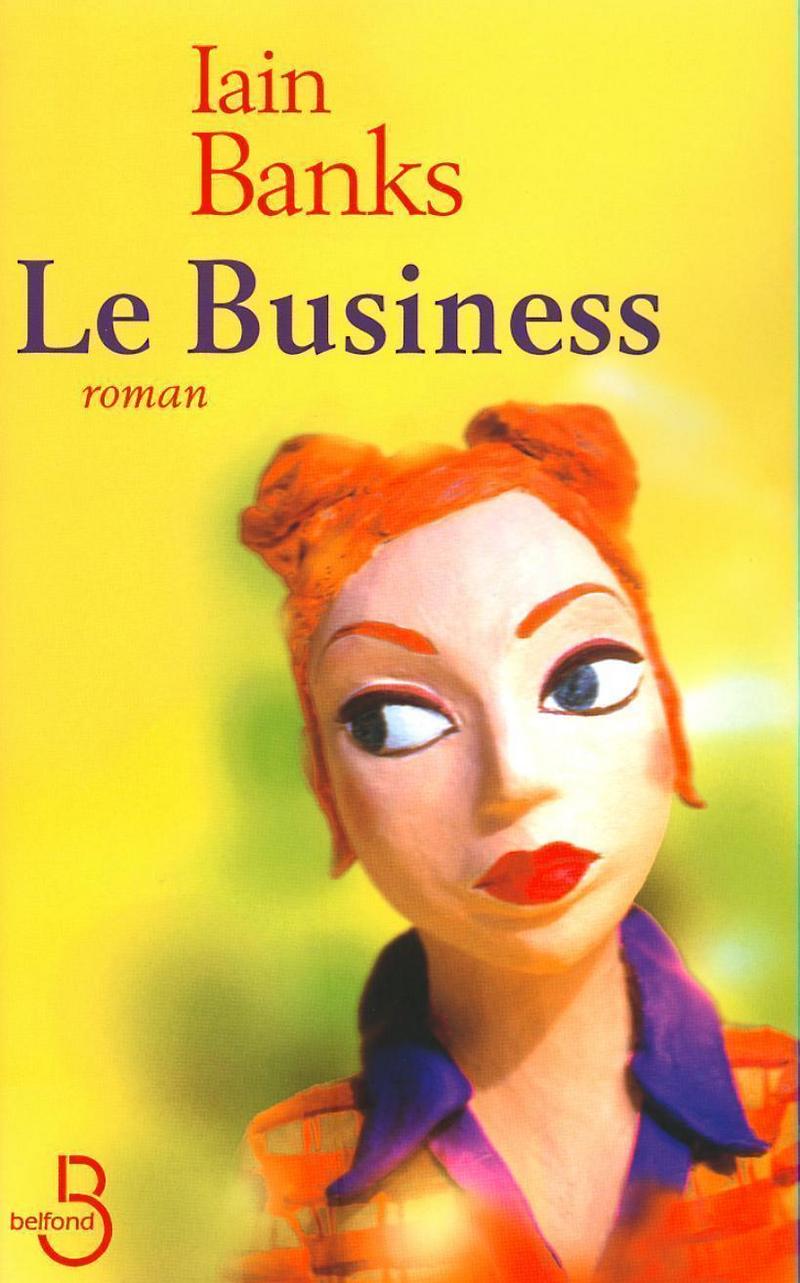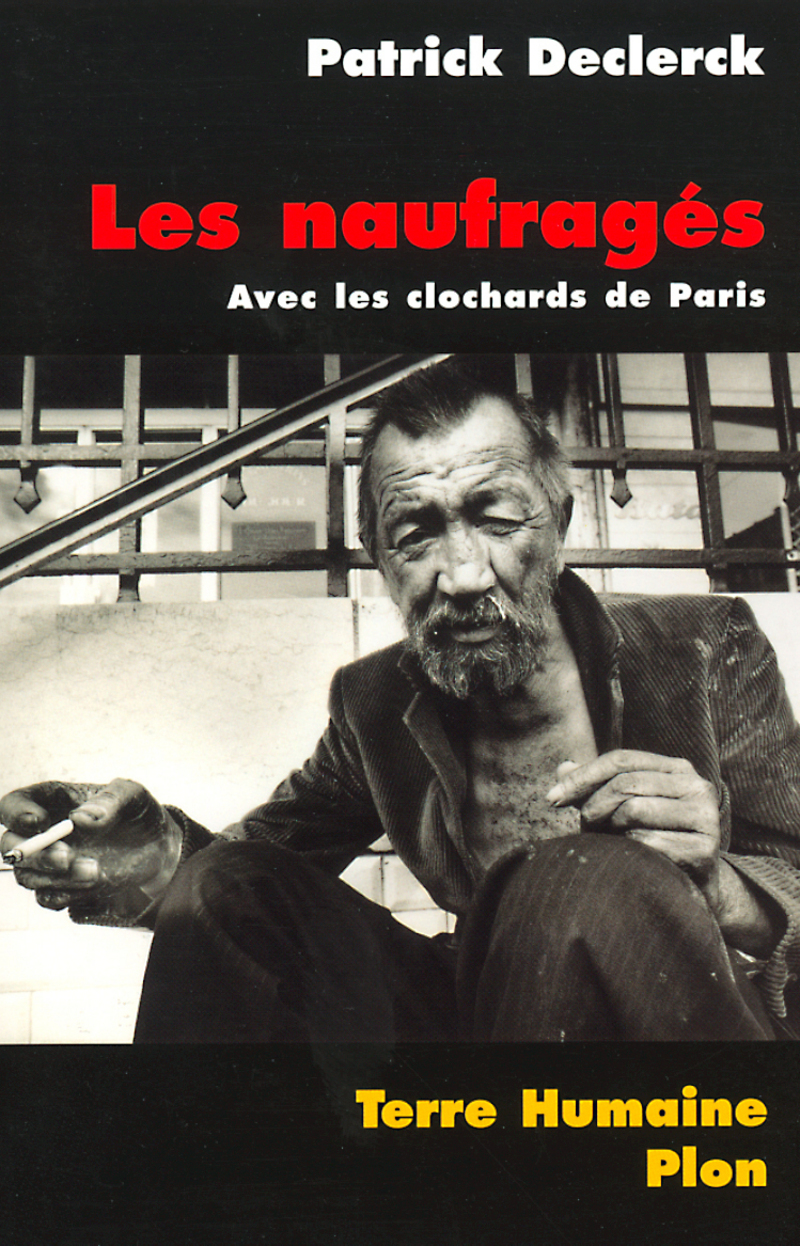Hors-Sol publie une série de nouvelles de Luc Garraud, botaniste et écrivain. Ce sont des vignettes qui attrapent où il faut, sensibles et revêches, et la langue singulière accompagne là où ça brille d’intelligence. Nous sommes heureux de l’accueillir, chaque mois, dans ce premier feuilleton de 2013.
Les photos sont du même.

Le col ferme chaque année, le 15 novembre, c’est marqué sur un panneau en bas au début de la route, un peu effacé. Je viens du sud, je vais vers le nord. Je vois dans mon rétroviseur la barrière s’abaisser dans mon dos, les employés des routes tout de jaune fluo m’ont salué au passage.
J’arrive au premier lacet, la pente est douce. Je suis le dernier voyageur, seul sur la route.
Le col est encore loin, il passe comme tous les cols au point le plus bas entre deux montagnes. Il est à plus de deux mille cinq cent mètres d’altitude. Ce n’est pas le plus haut que je connaisse, mais il est unique par son passage très étroit. Il est taillé dans la roche dans le vertige.
La route est tracée depuis plus d’un siècle. Elle s’éternise en lacets de chaque cotés des versants. L’adret monte en pente douce, c’est presque plat par endroits, chaque courbe patiente.
Au sommet, on débouche par un entonnoir serré entre deux parois ocre et bleutées. On passe dans l’ombre un moment.
Le vent froid souffle comme au sortir d’un tube, je passe à l’ubac.
De l’autre coté, le fond de la vallée est sombre, les forêts de sapins et d’épicéas s’étalent en nappes.
La pente est forte d’un coup, elle serpente dans les grandes casses d’éboulis mouvants.
L’automne fait son givre, entre les pierres au bord de la route, tout se cristallise.
Le temps est blanc, il neige, c’est un début d’hiver timide avec de gros flocons légers qui tombent, virevoltent.
J’écoute la météo à la radio, elle dit vrai. Il fait parait-il beau à Paris.
C’est une idée tenace qui fait une part au temps considérable. Il est beau quand le soleil se montre et mauvais quand il pleut.
Quand il neige, c’est de l’or qui tombe.
Je suis en voiture et la descente du col se poudre doucement.
La pluie vient du sud, gonflée de la mer, elle s’engouffre dans les vallées et le froid transforme tout en neige, en coton.
Tout l’hiver, la route est laissée seule, aux éboulements, aux avalanches. La montagne reprend le dessus un temps. Elle s’étale, saupoudre ses blocs. Elle ne laisse plus un seul morceau visible d’asphalte, elle recouvre tout.
C’est un jeu d’hiver, elle bouge la montagne.
Ce sont les derniers jours praticables, tout au long de l’été, la chaussée est propre, nettoyée d’heure en heure, elle est sans danger. Il faut assurer le passage, c’est un énorme effort quotidien. Il faut faire avec les petits mouvements de la montagne, faire avec les chutes.
Et puis à l’approche de l’hiver, on lâche l’affaire, épuisé, on en peut plus, la route est livrée aux pierres.
Dans le bas tout s’aplatit, c’est encaissé, c’est plat comme le lit d’une rivière
Il y a un bloc sur la route, gros comme ma voiture, plus gros même, il barre tout. Je m’arrête au bord du vide.
Une avalanche barre la route, avec des coulées de boues mêlées à la neige, des coulées poivre et sel. Un bloc est tombé ; en s’approchant de lui, il est de la taille d’une maison à l’envers, volets ouverts, un cube compact. Il attendait sur la vire, au-dessus, il attendait de partir, d’aller plus bas.
Pour les pierres, c’est une forme de promotion, d’attente inespérée, partir enfin de la paroi, se désolidariser, prendre le chemin du chaos, briser son rêve, faire du bruit, rentrer en poussière.
Les pierres lavées, diluées par les eaux fortes, réduites pour passer sous les ponts en petits graviers colorés, roulées en grain de sable jusqu’à la mer. S’étaler dans l’estuaire, devenir liquide, libre.
La neige tombe en couche, de plus belle.
Il y a de l’autre coté du torrent une baraque bardée, une toute petite maison aux murs de ces pierres roulées. Le toit est très en pente, presque pointu, pour ne pas retenir la neige. C’est une maison forestière, ouverte de temps en temps pour les promeneurs perdus, c’est mon cas.
Il va falloir l’atteindre, par une passerelle suspendue au-dessus des eaux furieuses.
Avec l’épaule je pousse la porte lourde qui coince au sol, il n’y a pas de clé, c’est sobre à l’intérieur. Il a des buches de bois bien rangées sous la neige.
Passer la nuit ici, dans mon sac à dos plein de nourriture, il y a du pain, du fromage. J’ai de quoi. Tout aura fondu demain, les neiges d’automne fondent aussi vite quelles tombent, le sol est encore chaud.
Je rentrerais à pied, demain.
Le feu dans le poêle de fortune en fonte à du mal à prendre, le bois est humide. Je trouve deux casseroles cabossées de suie pour faire chauffer un peu de neige.
L’eau bouillante remplie la pièce d’une buée qui se plaque aux carreaux, le repas est un mélange de choses froides et chaudes.
La nuit est noire dedans et blanche dehors. Je mange dans l’encre à la lueur d’une étoile éteinte.
Je me limite à un espace seul, qui devient de plus en plus restreint. Je suis entre deux chaises, accroché à une table à trois pieds posée dans un angle. J’écris dans le coin sans voir les mots sur mon carnet.
Sur les lignes tordues, j’écris dans le noir jusqu’au matin, endormi sur la table.
Le sommeil est cabossé. Sur un matelas usé je fais craquer mes os. Le matin est à peine clair. Je remets le poêle en route, toute la nuit à plein régime, il s’est éteint fatigué.
Le thé sans arômes laisse au matin, au bord du verre, un tanin brunâtre. Il refroidit à vue d’œil.
Par la fenêtre, il y a plus d’un mètre de neige uniforme, tout est figé.
Une avalanche à emporté le gros bloc. Je ne vois plus ma voiture, elle est dans le torrent plus bas. Elle ressemble à une compression de César.
Je marche au bord du ravin sans pouvoir m’approcher. Je fais quelques pas sur la piste qui monte sur le coté dans la forêt, pour voir de plus haut. Je descends par le sentier, tout est bloqué. Je suis perché là sans pouvoir bouger, j’ai de quoi tenir quelques jours.
Je n’ai qu’un feuillet de journal local à lire.
La météo du 17 juillet n’est pas celle d’aujourd’hui ; un résultat sportif raconte la victoire sur le fil de l’équipe locale bien que réduite à neuf en seconde mi-temps.
Il y a un grand bandeau allongé dans lequel un roman interminable s’étale par épisodes, c’est une littérature adaptée pour l’été. Trois mois sans suspens, ni rebondissements pour toujours le même dénouement, tout se terminera à Venise, chaque été c’est pareil, il faut que cela se termine.
Il y a aussi une promotion pour une marque de coton révolutionnaire à mettre dans les oreilles pour ne plus rien entendre. Je m’arrête un moment sur la recette de cuisine du jour, mais je n’ai absolument rien pour la faire.
L’horoscope c’est le même dans le monde entier.
Aux petites annonces, une famille recherche quelques mètres carrés pour faire un potager, il faut écrire au journal.
J’ai un carnet à spirales, en petit format de 180 pages blanches à petits carreaux. J’ai deux crayons, j’ai de quoi écrire pour combien de temps ?
Un jour, deux jours ou trois, je ne sais pas combien de temps, je vais rester seul ici comme une fève dans sa gousse, j’attends l’écho sagement.
J’ai pensé souvent m’isoler pour écrire un peu dans le calme.
Un temps ne rien faire, venir tout seul en montagne, se laisser aller à ne plus faire un geste, rester immobile, flâner dedans, aller nulle part, regarder ce qui se passe.
J’ai encore du sel plein les mains d’un précédent voyage, j’ai de quoi raconter.
Je suis un écrivain contraint par la neige. J’écris parce qu’il neige, j’attends la fonte de la page blanche.
Un jour, on pourra ne rien faire du tout, s’allonger doucement, faire un pas, pas trop loin, hors du vacarme, ne plus revenir, s’éteindre un peu, un peu seulement, ne rien faire longtemps, s’habituer au moindre d’effort, être sans fabrique, sans cheval, au bout du bout, se dissoudre, mettre la fin au début, se mettre de coté pour écrire.
Sur ma page, je n’écris plus, je n’écris plus rien. Je parle petit à petit en dedans, par petites bribes, c’est peu à chaque fois.
Je me perds seul, je suis là depuis trois jours, à regarder dehors, à tourner dans l’espace, je prends le vent d’autant pour un courant d’air, le vent dans un couloir.
Je suis autiste de haut niveau, je fais avec l’altitude une chose par jour. Une masse énorme m’habite, une grappe, un flux ininterrompu. Quelquefois je prends mon personnage, devant la glace, je me parle.
J’ai sorti deux verres car nous seront deux tout à l’heure.
Je ne veux rien laisser ici, je suis contraint de tout oublier, de me faire oublier. Je lèche le fond du verre, plus une trace, tout doucement éteindre la mèche, la mouiller, la serrer entre les doigts humides.
Je pisse à coté, j’ai perdu petit a petit du pouvoir, de la force, je m’en sers de moins en moins. Je ride ma peau comme une flaque qui s’assèche, je craquelle. Je me laisse, je cours plus lentement sur la lande. Je détruis ma trace, il ne me reste que des restes.
J’ai des questions sur les consignes.
Je fais avant les choses, pour changer, je suis né particulier, je n’ai rien lu sur mes mains, j’ai vu des mots dans ma tête qui ne veulent rien dire.
Je mange debout, je suis debout pour manger.
Je suis fermé ici pour plusieurs jours de neige.
Tout prend de la place sur un mètre carré, on à la place de faire des tas de trucs.
Je regarde dans l’autre sens, je m’invente une langue plus râpeuse, comme celle de l’escargot du fossé gavé d’ortie, au bord du mur, le franchir tout seul, de pierres en pierres.
Je décris les mouvements de ma tête. Je lis et transcris les images enfouies qui arrivent automatiques, elles prennent leur sens à la lecture, au bord du bassin, c’est une feuille qui s’éloigne, une main sèche, coupée de son poignet.
Je fais mon usine sur un m², une vigie, un phare. Je prends mon repas à l’envers, derrière les carreaux bleutés de la baie. Je vois dans le noir des yeux.
Je suis debout sur la chaise. Je vois par-dessus de la haie : la terre du voisin, au loin le froid, la brume opaque, la faible lueur. Je surveille ceux qui dorment, comme l’eau qui bout. Je suis les ruisseaux se perdre dans les galets. Je fuis sur la pointe des pieds.
Je cherche une petite ampoule pour éclairer l’autre face du monde, celle qui dort.
J’évite d’écrire des phrases mal finies, mal ficelées de peur quelles restent longtemps, quelles s’éternisent.
J’efface tout, je jette à la rue, je retourne à la nature, je mange comme une bête, un ours, un rongeur de graines.
Je ne pars plus, je reste, je bloque, je fais tout d’ici. Je sais ce qu’il se passe, j’ai suffisamment pour raconter, tout se répète, ce ne sont que des choses accumulées depuis des millénaires, ici, je vis sur un m², je longe les façades.
C’est ma vigne, je tourne en rond dans le carré, je fais de l’ombre à mon raisin, je fais mon verjus d’herbe, c’est acide, un sacré carré de sacrifice.
Je m’accumule sur l’espace, je veux mon espace portable, comme une cour, comme le sommet d’une tour, je m’évade souvent pour revenir, avec ma valise.
C’est dans la nature même des choses d’insister un peu, de résister toujours, de se le faire à soi son mètre carré, à sa mesure. Je le déplace, je suis un sursitaire, sur l’eau, la barque est courte, je vogue sur une épaisse couche de pluie.
Je dors et je m’allonge sur le pré carré, je démarre la tondeuse. Je tonds la précarité.
A deux on peut avoir deux mètres carrés mais ça ne fait toujours qu’un mètre carré chacun.
J’empile des fenêtres ouvertes, des toiles de maîtres, je suis dans le cadre de la photo un moment.
Je veux m’en faire un pliable de mètre carré, le faire vertical, dans l’espace. Je reviens toujours à mes évasions.
Je participe au transport, je me précipite dans la neige sur le chemin feutré, un cheval sur les talons.
Je remets tout en jeu, je trace au sol pour chacun de mes invités, des carrés que la mer efface à chaque vague. Une vie bien carrée, anguleuse, un rectangle long, fait de briques rongées et usées.
C’est un carré de terre, un carré de mer, un mur carré voilant l’horizon, pour un château jamais construit, je le vois d’où je suis.
Je vais sur un petit carré d’herbes blanches comme la nuit, un paysage oublié, un jardin rayé de la carte, je me limite au lieu.
Je suis sans bouger vraiment, sans bouger réellement, d’ici. Je raconte des histoires, c’est suffisant pour dormir debout.
Le plus long voyage du monde, c’est où ?
Je me refuse à prendre les chemins au dehors. Je reste, j’arrête la machine à faire. J’écris des mètres carrés, des lignes longues, des traces fauves, des rainures à suivre. Je vais à jamais. Je me perds de forges en forges. J’ai des mains pour rattraper tout cela, j’avance le long des bordures.
*
Je suis retourné en ville, à pied, j’ai enjambé des tonnes de pierres, j’ai marché longtemps.
Le marché est grand, il est très étiré, il est animé par des vendeurs de pain, de légumes et de fromages, la production est locale. Ça sent la terre, la ville est en effervescence, aux premiers rayons froids de l’automne. Le bois est rentré, ça fume blanc, par bouffées étouffées.
Je me suis précipité dans le premier tabac-journaux, j’ai acheté le journal local du jour.
C’est en première page, en très grosses lettres : UNE VOITURE REPECHEE SANS PASSAGER
Il y a une photo toute en hauteur, la photo d’une immense grue de levage, elle balance au bout d’un câble une boule informe d’acier, c’est ma voiture méconnaissable, tirée des eaux, roulée dans le torrent en furie jusqu’aux portes du village.
Le feuillet d’un journal recto-verso c’est un mètre carré, c’est une histoire sans fin, des pages imprimées pour toujours, qui répètent des choses toujours nouvelles et que l’on a déjà entendues cent fois, comme un roulis, la vie du monde d’ici ou d’ailleurs c’est pareil. Tu ouvres le journal n’importe où, à n’importe quelle heure, n’importe quel mois, dans dix ans, dans deux siècles.
Ce sera toujours le même rituel désuet et complet, sans rien demander on a tout. On sait, alors que l’on y pensait plus, que les amants de l’été sont enfin arrivés à Venise, comme tous les ans, c’est écrit en bas de la page pour toujours, en bas de la page du journal d’un mètre carré.

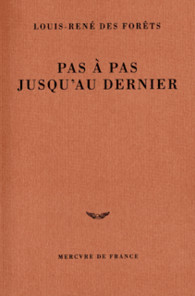




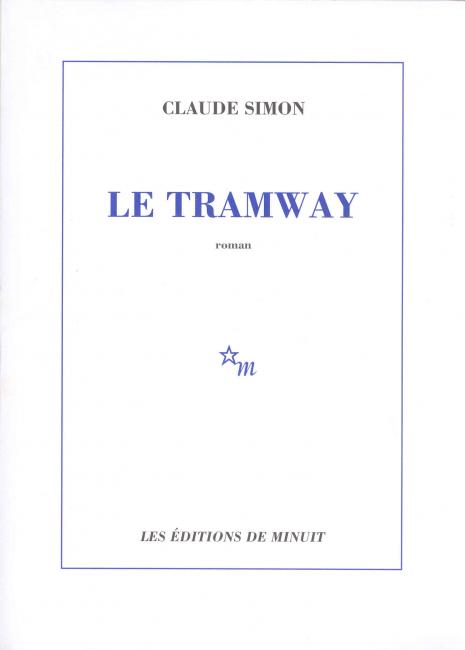
 ), Le business, traduit par Christiane et David Ellis, Belfond | Lien éditeur
), Le business, traduit par Christiane et David Ellis, Belfond | Lien éditeur
 ), L’œil de Carafa, traduit par Nathalie Bauer, Le Seuil | lien éditeur | lien auteur
), L’œil de Carafa, traduit par Nathalie Bauer, Le Seuil | lien éditeur | lien auteur
 ), Body art, traduit par Philippe Bouquet, Actes Sud | lien éditeur
), Body art, traduit par Philippe Bouquet, Actes Sud | lien éditeur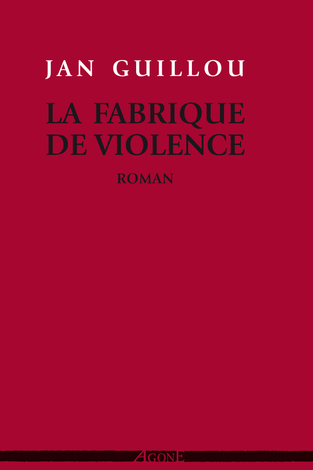
 ), La fabrique de violence, traduit par Philippe Bouquet, Agone | lien éditeur
), La fabrique de violence, traduit par Philippe Bouquet, Agone | lien éditeur
 ), Vertiges, traduit par Patrick Charbonneau, Actes Sud | lien éditeur
), Vertiges, traduit par Patrick Charbonneau, Actes Sud | lien éditeur
 ), Les danseuses mortes, traduit par Jean-Pierre Ricard, Albin Michel |
), Les danseuses mortes, traduit par Jean-Pierre Ricard, Albin Michel |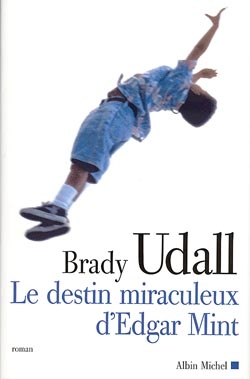
 ), Le destin miraculeux d’Edgar Mint, traduit par Michel Lederer, Albin Michel | lien éditeur
), Le destin miraculeux d’Edgar Mint, traduit par Michel Lederer, Albin Michel | lien éditeur