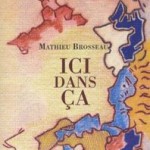Un texte jadis publié sur Strass de la philosophie.
Aurélien Barrau est astrophysicien, spécialisé dans la physique des astroparticules, des trous noirs et en cosmologie, et enseignant chercheur au Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS à Grenoble. Il ne dédaigne pas la philosophie, au contraire.
Ménagerie. Vieux gorille. Débile. Détruit. Posé.
Hilarités humaines. Grimaces. Hilarités. Canettes de bières, cigarettes, chewing-gums jetés au « gros macaque ». Hilarités. Attente de la bourde. Hilarités. Espoirs d’une chute, d’un raté, d’un heurt. Hilarités. Postures triomphales ou provocantes, pour la photo, devant la bête. Hilarités.
Déception : apathie simiesque, vivant mourant, avachi, indolent, déglingué. Chemins passés. Hilares, quand même, parce que là pour ça. Plus loin, les fauves à moquer. Ridicules, forcément.
Le regard du gorille, pourtant, n’était pas absolument éteint. On observait – eux, les voyeurs-jouisseurs – ses poils, ses narines, son sexe. Evidemment. Pourtant : regard figé, fixé, rivé. Moins happé ou subjugué que suspendu. Vissé à cette minuscule tuile manquante sur le toit sombre. Attaché à un atomos de ciel. Sans désir ? Déjà mort mais pas encore absent.
Dans ce regard, il y a le palimpseste crasseux de l’humanisme. La face pourrie de l’homme-dieu. La folie machinique de Descartes, la hargne froide de Malebranche. La catastrophe christique. Il y a la tendresse étonnée des anciens, sacrificielle, peut-être, mais adressée. Le végétarisme militant de Pythagore, l’égalitarisme ontique si légèrement saupoudré par Plotin. Le temps où les dieux, les hommes et les bêtes se pouvaient penser dans une continuité communielle. Il y a la stupidité lancinante de l’inévitable reproche « anthropomorphique » à ceux qui compatissent. L’interdite empathie. Insupportable ritournelle. Il y la stridence ornithique improbablement apprivoisée par Messiaen. Les hybridations chimériques de Chagall. Il y a le sidérant cynisme kantien – amendé ou déployé par Fichte – qui ne récuse les tourments infligés aux animaux qu’au titre de l’atteinte que ces violences porteraient à… l’humanité ! La vacuité que Hegel décèle dans les voies animales. La privation de Dasein martelée – évidemment – par Heidegger. Déréliction. Il y a l’étrange tendresse de Schopenhauer, surgit miraculeusement d’un déluge d’invectives. Il y a ce pouvoir de les nommer que Yahvé accorda à Adam après l’avoir exhorté à les dominer. Il y a la raillerie bégayée – parade préventive – contre l’estime des bêtes qui nuirait à celle des hommes. L’inchoatif de compassion écrasé avant d’éclore. Il y a le vieux Levy-Strauss et cette proximité animale qui ne pouvait pas ne pas se dessiner aux linéaments de la structure. Il y a le terrier de Kafka, l’animal humain de Bacon, les cadavres de Soutine. Il y a les mondes de von Uexküll où la tique démiurgique crée son univers propre. Umwelt goodmanien. Il y a la comparaison interdite de Primo Levi que seul ou presque, et pour cause !, il pouvait s’autoriser. Qu’il ne faut pas faire pourtant : parce que rien n’est jamais comme. Parce que comme est toujours une insulte. Il y a la connivence entre capitalisme et violence aux vivants, Döblin et sa monstration du lien organique entre omnipuissance du marché et réification. Il y a le nominalisme foucaldien et l’évanescence du visage-de-l’homme juste esquissé sur le sable. Il y a cette peur récurrente, obsessionnelle, inextinguible, de leur reconnaître le pouvoir de souffrir, le pouvoir de pouvoir souffrir. Déni de douleur et déni du déni de douleur. Il y a les devenirs animaux de Deleuze et Guattari. Le sortir du mimétisme, la meute, la multiplicité. Il y a l’éthologie, Franz de Waal, les primates, leur histoire, leurs histoires, leurs affects, leurs percepts, leurs symboles, leurs outils, leurs imaginaires, leurs désirs, leurs angoisses, leurs érotiques. Les nôtres donc. Il a le cynisme narquois de Wolf. Ce petit rire moqueur, ce petit rictus mesquin, qui évite de faire face à la barbarie. Il y a la fourmi de Nietzsche, la perfection relative des vivants et l’illusion téléologique. Il a l’ambiguïté de Spinoza, son axiomatique délicieusement subversive, même si… Il y a l’apologétique augustinienne qui assure, qui assène, qui assomme : peu importe qu’ils souffrent ou non. Peu importe. La question est erreur. La faute est la question. Il y a le courage de Derrida : les animaux, les animots, au pluriel (plus d’un…), forcément. Il y a cette interrogation éructée à la face de Levinas : et ce visage là ? La primauté éthique, l’exigence de sainteté… qu’en faites vous avec ce visage là ? Il a la brutalité de l’indifférence à la différance. Il y a l’intensité rilkienne, l’élégie magique où le regard animal, seul, bien sur, accède à l’ouvert. Il y a la saisissante conscience de Hogarth, sa mise en toile d’une cruauté qui n’est pas qu’annonciatrice. Il y a l’intelligence pointue d’Elisabeth de Fontenay, résonance raisonnée d’un contact philosophant avec les « bêtes au bois dormant ».
Il y a surtout beaucoup moins que ce magma confus. Un moins-dit, un moins-loin, un moins-fait. Non pas une inscription ou une excription : une acription. Un autre part des mots qui ne s’atteint pas par un sortir. Très exactement : une singularité. Événement qui déchire l’ordre du plérome. Un immiscé. Un en deçà évanescent. Une défondation séminale. Singulière – aconceptuelle – émergence. Une éradication judicative. Plus un singe-ancêtre, ni un singe-cousin, ni un homme-singe, ni un singe-homme. Une expérience duale. Un dyadisme premier et indivis. Quelque non-chose qui s’apparenterait à ce que Badiou nomme amour : l’à-partir-de d’une altérité. Porosité définitoire. Entrelacs d’avant le lien. Déprojection. Désujétion.
Il ne s’agit pas de faire un monde avec un singe. Tout peut faire monde. Mondes immondes. On peut – on doit – les faire proliférer. Ils pullulent. Multivers. L’authentique singularité c’est ici, justement, son universalité. Penser cet insupportable, cette souffrance inouïe, ce silence assourdissant, cette absence abjecte, dans tous les mondes. Choisir de ne pas s’y soustraire. Entendre l’anaphore obsédante du non-dit. Introduire une viscosité, presque une rugosité, dans le flux nauséeux.
Ce n’est pas primitivement une honte. Ça n’a rien d’une honte principielle. Honte de pouvoir dire, comme les hilares. Honte d’être un parlant muet. Honte mêlée, comprimée, implosée : des abattoirs, des surnuméraires jetés dans les labos, des testés, gavés, fardés à en crever pour nos décors, des mutilés, écorchés, émasculés, brûlés, troués, saignés, démembrés, arrachés, étouffés, pour égayer les repas, des transportés, piétinés, blessés, ravagés, nés-massacrés, des juste comptés. Bien sûr. Il y a ça. Il y a ça et toutes les variations possibles – avec fioritures ! – sur le thème toujours plus actuel de la jouissance absolument libre et légère de la totalité des plaisirs possiblement procurés par l’usage strictement inconditionné et illimité de la bête-objet. Animal objectal. Objecté. Objectif. Mais ce n’est pas essentiellement ça.
Singularité de ce pénitencier sans pénitent. Vacuité propagée. Asile désempli. Cages s’éventrant. Flots turbulents. Souffles emmêlés. Devenirs exhalés.
Se faire aire, se faire âme, a̋nemos, anĭma, animal.
Il n’y a plus de regard du singe (qui ne me regarde pas (qui a cessé de regarder (qui s’est tu de l’œil))). Il y a ma cécité rassasiée. Mon voir-singe aveuglé. Une suspension étrange, étrangère. Un silence carnassier. Une éblouissante absence qu’on voudrait voir détruire la ménagerie. On ne voit plus rien d’ailleurs. On vit avec. Ou pas.