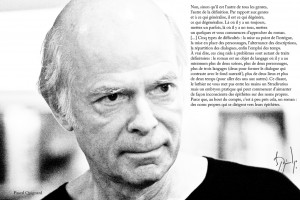Hors-Sol publie une série de nouvelles de Luc Garraud, botaniste et écrivain. Ce sont des vignettes qui attrapent où il faut, sensibles et revêches, et la langue singulière accompagne là où ça brille d’intelligence. Nous sommes heureux de l’accueillir, chaque mois, dans ce premier feuilleton de 2013.Les photos sont du même.
J’étais jardinier à la cour des miracles, au sein d’une équipe animée par des rituels désuets et ridicules dès le matin. Ratisser les feuilles et tondre les pelouses apportait du mouvement à ce petit peuple, soumis à des règles d’un petit monde.
Un seul espoir, attendre la fin du jour, que la nuit passe. La main sur le pantalon, laver les camionnettes, passer plus de temps à ranger qu’à faire, cirer les pneus, tout faire propre et regarder les passantes, boire et reboire ou bien le contraire. Se faire chier à longueur de journées sur la suite à prendre.
C’était rassurant quand on avait trouvé une chose à faire, tout le monde était d’accord, engourdis qu’on était. Je crois ne jamais avoir vu une pareille fanfare depuis. Ma première procession avait commencé comme ça, arrivant de nulle part. J’ai cru longtemps que c’était ça le travail en équipe.
J’allais leur chercher des bouteilles de rouge. Le blanc se buvait au bar, plusieurs petits à la suite, accumulés comme ça, petit à petit ça faisait un grand blanc à la fin. J’allais à l’épicerie avec des consignes, des litres à étoiles : « T’en prendras quatre », c’était le minimum. En général dès que le vin avait un bouchon de n’importe où qu’il vienne il était bon. Ce n’était pas vraiment des gourmets, ni des esthètes, mais ils aimaient manger et boire. Les discutions étaient souvent limitées à ça, même si le flot intarissable sur les déboires de l’impuissance prenait aussi du temps sur la journée.
J’ai fait ça pour aider pendant des semaines sans vraiment me rendre compte dans quel bazar terrible je trempais, je ne buvais que de l’eau.
La troupe ça ressemblait à une grande caravane diversifiée. Un gros gars fort et bedonnant d’une soixantaine d’année, avait chaque matin sur la peau un bleu de chauffe bien propre et repassé par sa femme. La ceinture en cuir par-dessus était ajustée au minimum autour de son ventre, lustrée, on voyait bien les trous marqués des années plus maigres. Je ne l’ai vue qu’au dernier cran me tirer la langue. Ça retenait son autorité de chef, un embonpoint qui se voyait. Il était coiffé au Pétrole Hahn et frotté au sent-bon à la lavande, parfum déjà perdu à sept heures trente dans son odeur d’ours. Il suait à grosses gouttes au moindre effort, sans en faire un seul. Il suçait des pastilles à la menthe, tout le temps. Il était, je crois, plus bon que bête, mais mis en boite par la bande à railler qu’il dirigeait tant bien que mal, ça ne se voyait pas vraiment. Il rentrait le soir imbibé comme une éponge avec mille excuses. Il avait dû aider dans d’autres moments difficiles, des gens au-dessus de lui, des besognes ingrates pour ceux qui ne voulaient pas les faire, on se souvenait de ça, on l’avait mis là, il aurait pu parler. Il devenait très rouge certaines fois, émacié naturellement qu’il était déjà par le vin.
Condescendent et toujours à se montrer, Jean, un vieil aigri, lui, était tiré à quatre épingles. Il était en fin de cycle. Il venait en vélo et à cet âge ça me semblait bien courageux, quand on vient en vélo c’est qu’on ne marche plus, c’est trop loin les pieds, la marche est haute. Un jour, j’ai vu au détour d’un immeuble qu’il habitait à moins de cent mètres de là, sortir son vélo le matin, le rentrer le soir, un sacré rituel.
Nous nous retrouvions le matin à sept heures précises, c’était la règle, commencer à l’heure. On n’avait pas intérêt à arriver en retard, sinon on nous en parlait toute la journée, des cinq minutes à rattraper. Cinq minutes gagnées à courir, se lever lentement, rester coincé dans le lit, regarder se déployer doucement les feuilles de platanes le long des quais du Rhône, ou bien encore le bus de ville qui s’évertue ce matin-là à s’arrêter à tous les feux rouges.
Après sept heures l’horaire n’avait plus d’importance, seul le moment de partir réveillait un peu les consciences, un peu avant.
Jean, son seul atout à lui était de nous prendre pour des cons, car il savait tenir un marteau. Il avait appris en installant les voies à la SNCF. Il avait aussi une tête à les avoir fait sauter, ou du moins il avait dû essayer mais il n’en parlait pas. Alors évidement, nous qui ne savions pas planter un clou, ça en jetait la SNCF. Il avait un avis sur tout dès qu’on disait quelque chose. Nous n’étions pour lui que des jeunes blancs-becs à qui on ne parle pas, tous des bons à rien. Il n’avait vraiment que son cul de vieux à contenter. Il parlait de sa fille, ça il nous en parlait et chaque matin, nous avions droit à ses exploits, comparés aux nôtres. Elle avait réussi à partir pour faire je ne sais quoi, douée pour les études, très douée pour le commerce, le rêve. Lui il avait fait jardinier pour finir.
Une troupe bancale, dans laquelle il y avait Monsieur Aimé monté sur ses lunettes fumées. Il était assez bonhomme, bien que raide et réac comme un fouet. Sa « bonne femme » nous aurait tous remis dans le droit chemin à coup de pompes dans l’cul. Une autorité naturelle dont il était fier, il en souffrait sans nous le dire. Elle était concierge, son dévouement pour distribuer le courrier dans les étages et sa dextérité mielleuse pour récupérer les étrennes début janvier l’impressionnait chaque année, vu que ça payait les deux bouteilles de pommard du réveillon. C’est lui qui sortait les poubelles le matin à six heures pile, qui lavait les sols le soir à vingt heures, qui tondait la pelouse le samedi et taillait les deux-cent soixante-quinze mètres de haies de troènes deux fois par an, sa femme, elle, elle était concierge.
Il était du genre « il vous faudrait une bonne guerre ». Comment on a pu laisser passer ça, s’en prendre plein la gueule. Ils n’avaient que nous, en première ligne, des chiens à battre. L’alcool ne suffisait plus à atténuer, à faire oublier la peur qu’ils avaient eue d’y laisser un bras, la tête ou l’ensemble en morceaux. Oublier les amis perdus, panser les familles écrabouillées par la douleur de la guerre, les controverses inavouées, cachées à jamais dans leur tête cassée. Alors évidement il fallait pour les calmer être d’accord avec eux, les écouter répéter leur plainte, on ne pouvait faire que ça. On ne comprenait rien ou peu de chose à cette histoire, on avait vingt ans. On aurait bien voulu partager mais pas tout, faire le tri, se rappeler les morts, les blessures et les amitiés, mais comment on démonte une arme, ah non merci ! comment d’un coup de révolver on envoie la monnaie, gardez tout. Ils ne parlaient que d’un seul bloc, le mal était trop fort. Mais dans leur « plus jamais ça » on sentait toujours « à vous maintenant, on a donné », alors que nous on aurait bien voulu dire : « et si on faisait tout pour plus que ça recommence », mais à vingt ans on ne sait pas dire ça, pas encore.
C’était donc récurent, journalier, on avait d’autres soucis à résoudre, que de se coltiner les leurs, ceux de la guerre, on était loin, on avait du mal à tout croire, pas le temps. Nous, on voulait bouffer à toutes les cantines. Ça faisait du boucan dans leurs têtes, ça se voyait, dans les nôtres aussi.
Aimé, il gueulait avant de parler, nous, nous avions appris à nous taire. Nous avions tous les trois le même âge et on s’entendait bien, tous les matins ont espérait de petits miracles, mais chaque matin, rien.
Un matin, on apprit que la femme d’Aimé était atteinte d’un cancer. Là, d’un coup, tout à changé, on n’a plus jamais entendu parler de la guerre, ni de nos faces de blancs-becs bons à rien. Ça à duré moins de six mois et là on a vu ce qu’on n’avait jamais vu auparavant. Tous les matins, tel un fildefériste sur sa corde en équilibre, il faisait trois kilomètres à pied, il arrivait de plus en plus tard.
Un jour on avait fait un détour par chez lui, on avait bu un café, il nous avait reçu comme des papes, attendus depuis longtemps, comme jamais il nous avait parlé. On avait eu droit au détail de la mise en bière, « tout l’immeuble est venu, elle a bien été fleurie ».
Nous trois, on était tombés là, je ne sais comment dans cette carriole, avec de la chance ou une vague connaissance. On s’est quitté de vue depuis trente ans, mais dans la tête on y pense encore. L’équipe, elle, est depuis au trois-quarts sous terre ou presque.
A la suite de ça, il y avait Louis, un vieux garçon encore jeune, grand et gros, dodelinant, l’ensemble tremblant comme une feuille. La cérémonie du blanc le matin, au zinc, sans toucher au verre avec les bras dans l’dos, du bout des lèvres, un, puis un autre, et de trois pour tenir debout et le sourire revenu des matins noirs comme des chicots, c’était parti pour la journée.
Il était bon, d’une finesse incroyable. Lui, il ne racontait que des histoires, des belles, toujours les mêmes, des histoires anciennes avec son œil qui te regarde pour que tu ne perdes pas le fil, pour pas que tu te perdes, pour que tu suives sa route un moment et qu’il t’emmène, jamais très loin, dans son pays proche où il ne se passe que de petites choses oubliées depuis longtemps.
Il regardait les autres sans dire un mot, il aurait pu dire, il connaissait la foudre des mieux pensants.
Sur la route étroite, avec sa voiture qu’il ne pouvait plus conduire depuis des lustres ; il me racontait la blanquette de veau qu’il avait mangé en s’arrêtant dans un restaurant au bord du canal et celle qu’il n’avait pas pu retenir, qui l’avait contraint alors à rester seul et à errer. Bouffé de timidité et d’angoisses, il me racontait son pays d’enfance avec l’œil bleu.
Oublié par ses cousins depuis qu’il était sans parents, sans frères, jamais retourné depuis là-bas. Je l’imaginais bien avoir pris le bus, un bouquet à la main, une veste couleur pétrole et une chemise à carreaux boutonnée jusqu’en haut, râpée au col. Il aurait marché le long de la petite route pendant deux kilomètres glissant sans cesse entre le fossé herbeux et le rebord de bitume gravillonné, sous une pluie transversale. Tout le séparait de la nationale au village. Sans prévenir, sans s’annoncer, il savait que ce serait difficile. Il connaissait l’endroit comme sa poche en sonnant à la première maison, celle de son cousin, c’est sa femme qui ne l’avait vu que deux fois en trente ans qui le reçut à la porte, elle prit le bouquet du bout des doigts. Le cousin n’était pas là et il ne rentrerait que le surlendemain et qu’il serait très content de savoir que son cousin était passé, enfin il le crut. Trempé comme un rat, il était rentré en prenant le chemin à l’inverse, c’est comme ça je pense qu’il me le raconta, je ne crois pas qu’il y soit retourné une autre fois.
Une équipe quoi, où Louis faisait office de Prince tous les jours déchu, il était comme un souffre-douleur permanent, l’image inverse des autres.
Il décorait les manches élimées de sa veste de petites brisures de pains bien choisies, glanées sur les tables. Il soufflait comme un gonfleur pour martelas de camping.
En queue de troupe, un gars dont je ne me souviens plus le prénom. Un gars, qui finissait bien l’équipe, un garçon à qui l’on rendait tout, il tirait une cigarette de sa poche avant de te serrer la main, un geste toujours, généreux au premier coup d’œil. Un fil de paysan, de la campagne, paumé mais un peu moins que les autres.
Un jour il m’emmena chez lui dans les collines, pour aller ramasser des griottes. L’arbre était tombé, il est couché, courbé au sol, accroché à une pente de ces montagnes vallonnées. Juste des volumes posés. Faut tenir debout dans les pentes et l’herbe est grasse, bien verte quand les griottes sont mûres, on les voit bien. Quel bonheur d’aller là bas, les journées sont longues et il n’y pas d’heure pour la cueillette. Je suis reçu par ses parents, on est bien reçus, je suis l’ami du fils, celui qui a bien voulu venir à la ferme. C’est une grande bâtisse et c’est grand autour, toutes les choses sont poussées. C’est un bordel de ferrailles et d’anciennes machines, en attente qu’elles rouillent. Un cimetière de tracteurs, le long des murs, adossés aux arbres, à même le sol, un peu partout et sans ordre, il y a la place, alors pourquoi réfléchir.
On entre, c’est comme souvent saisissant à l’intérieur. On discute de choses et d’autres, on ne sait comment remercier pour un tel cadeau, une cueillette.
On dit qu’on va y aller, après quelques civilités, ici ce ne sont pas les mêmes, se sont d’autres façons de faire, on ne s’en va pas sans rester un peu. La bouteille de vin et les verres sortent du placard. On discute de tout, pas vraiment de tout quand même, des choses en commun.
Bon et bien cette fois on va y aller « mais vous allez bien manger avec nous » et c’est un verre de rouge qui vous accroche à la table, je reste pour la soupe.
La toile cirée est venue par bateau, des boussoles et des ancres marines s’entremêlent à l’infini. Il y a tout, c’est un monde de meubles noirs avec des napperons blancs jaunis, tout est figé, ça poisse un peu. Il y a des tue-mouches qui tombent du plafond.
Aux murs sont accrochés des souvenirs de toutes les époques ; une photo de mariage ; dans un cadre le portrait d’un homme qui porte une belle moustache noire et épaisse, il est en costume du dimanche, c’est le tonton ou le parrain, qui est mort écrasé, puis mangé par la batteuse.
Sur le dessus de la cheminée, bien au chaud, une vierge de Lourdes en cire molle et cabossée fait face à un christ réchauffé, avec son rameau de buis coincé dans le dos. Les croyances viennent du sol, elles sont païennes et fortes. On parle du temps qu’il fait, qu’il fera et qu’il a fait surtout, c’est plus sûr.
La soupe c’est des poireaux gros comme des avant-bras, et des patates. En hauteur sous les poutres, une colonie de coupes dorées occupe de petites places. Les plus grandes sont sur le rebord de la cheminée, il y a une plaque gravée sur chacune. Des dates de concours de boules ? de tournois de foot ? de championnats de labours ? Dans une odeur de maison familière près des bêtes.
Les coupes brillent de toute part, elles prennent toute la place dans la pièce sombre.
J’ai dis oui pour la soupe, dans l’imaginaire des assiettes creuses et ébréchées, des morceaux de pain dans un bouillon plat, c’est si chaud qu’on mange lentement.
Je pense au panier trop plein qui m’attend sagement dans mon coffre. Le gout de la griotte, acide et fumée, animale et sanguine cramoisie, un arbre mourant, déchaussé. La confiture du dernier souffle, d’une dernière cueillette.
Ce serait bien « Viens, se serait dommage de les perdre » et pourquoi ça tombe sur moi, parce que je dis oui et quand on vous invite faut dire oui, ça se refuse pas.
Les coupes me regardent toujours. La petite sœur de douze ans est devant moi, toute dorée avec ses bottines de majorettes. Un pull rose au crochet ajouré et bouffant aux manches, une médaille de baptême en or. Elle est jolie, comme la campagne, elle n’a pas finie de pousser. Elle prend son accordéon et elle joue debout devant moi, bousculée en avant par le père à chaque pas qu’elle recule, timide, c’est un fracas de notes qui dégoulinent à toute vitesse, elle est maladroite sans exploit, c’est du par cœur, elle titube, l’instrument sous le menton et ça tricote les pastilles.
On trouve ça beau bien sûr, on sait surtout qu’elle à gagné des coupes, on est fier de les montrer, la soupe a un autre goût. Ça se déchaîne à nouveau comme un roulis, un interminable flonflon, que rien n’arrête. Derrière elle, dans son dos, le petit frère se bat avec les bretelles de son instrument trop lourd, excité lui aussi de vouloir montrer. Sans gène et sans le moindre effort, il pousse sa sœur qui n’en finit pas.
Lui aussi, Il a voulu faire pareil, pas pour gagner des coupes, mais plutôt pour faire comme sa sœur, il a appris seul avec sa sœur, alors, comme il aimait bien ça, on a ressortit le petit accordéon de sa boîte, celui offert par le parrain à Noël.
Et en deux notes, c’est parti, une furie démarre, ça met du volume dans la maison. Le père ne peut plus commenter, ne peut plus parler sur la musique, il se tait le père. Ce n’est pas du musette à proprement parler, c’est déjà différent à la deuxième note, c’est inventé.
C’est un musicien qui joue là, du velours agricole. On ne comprend pas, il s’entraîne jamais, il ne joue pas au moins une heure par jour comme sa sœur. Il ne fait jamais comme sa sœur, les coupes il les a toutes gagnées, ramenées à chaque fois. Mais c’est bien de jouer de la musique devant les gens du village qui l’attire, le père il ne comprend pas pourquoi il ferme les yeux quand il joue, en face du monde. Depuis l’âge de quatre ans, il en a huit et demi.
Il travaille peu à l’école, il est lent dans son travail. Il n’est pas avec les autres et pourtant il n’est pas bête quand il veut. Alors certains jours, il reste à la maison pour aider, y a toujours à faire. Il va garder les chèvres avec son accordéon, il n’a jamais perdu une chèvre. Je ne sais pas ce qu’il va faire, il est fait pour reprendre les bêtes. Il dit qu’il aime les musiques à la télé et qu’il écoute la radio dans son lit.
Un jour, il a pris le bus pour l’école et n’est pas rentré le soir, le lendemain on l’a cherché partout, on n’a jamais su où il était allé. En rentrant il nous a dit : « C’est un métier accordéoniste sur le tour de France, non ! » Il est têtu, dans sa tête, il sait, mais il ne dit rien.
« Ma femme elle pense qu’il pourrait faire les deux, travailler la terre et continuer à jouer de temps en temps de son accordéon ; moi, je ne suis pas contre mais qui va s’occuper des bêtes. »
Il est là, sur une estrade bricolée, en costume et cravate rouge, droit comme un i.
J’ai reconnu sa silhouette de loin, son visage est devenu adulte, je me suis piqué devant lui mais il ne m’a pas reconnu. Il a soulevé son instrument posé sur la chaise à coté de lui. Il à accroché les bretelles dans son dos, j’ai entendu ses yeux se fermer, sur la première note un goût de griottes m’est venu dans la bouche.