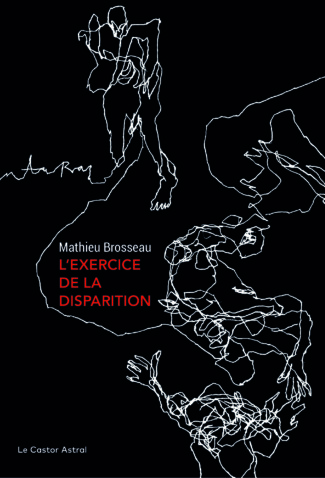Né en 1975, Eric Darsan est écrivain, critique, nomade, et membre actif du Général Instin. Il publie textes et articles dans diverses revues littéraires en ligne (remue.net, Poezibao, Sitaudis, La vie manifeste, etc.) ainsi que sur son site personnel, avec un intérêt particulier pour l’édition indépendante, la littérature contemporaine et expérimentale, poétique et politique. Il est l’auteur du Monde des contrées, paru en 2016 aux éditions Le Tripode et illustré par les 400 coups.
« Mais pour revenir à mon sujet, que j’avais presque perdu de vue, la première raison pour laquelle les hommes servent volontairement, c’est qu’ils naissent serfs et qu’ils sont élevés comme tels. » (Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire).
Roulements d’yeux, de tambour : les enfants uniques s’avancent par deux. Une jeune fille se met à chanter : les femmes-oranges reprennent leur air/souff-l-r-e(nt), sans masque, entre deux nénuphars. Des bouquets de jonquilles encadrent le drapeau, porté comme un linceul par mille hommes marchant au pas comme un seul. Vu du sol, la terre est rouge plus que sienne. Autour du portrait de Ma(k)o®, le défilé devient carnaval — folklore : vélos & chapeaux chinois, danses populaires & hommes d’affaires. Figurines de carton-pâte, lâcher de ballons plastiques par milliers qui empoisonnent l’atmosphère. In-conscience/-toxication massive, collectiv(ist)e. Entracte, poudre aux yeux/nez étiquetée Made in China.
Hon se débat dans son sommeil. Dans son esprit s’est déroulée la plus stupéfiante des fêtes. Un culte du/au progrès, fait fête populaire où se sont co(n)fondus, l’espace d’un instant, Nouvel An chinois & Sacre du printemps, nat-ion/-ivité, & mille fleurs & chars & tigres & dragons. Li&s par des milli€rs/milli(¥)ards/myriades de rubans. Animée par toutes les composantes de la société sous le regard médusé de dirigeants qui ont su renouer(,) avec leur âme d’a-u/-ntan(,) les vertus virtuelles d’une fiction dont tout le réel a été expurgé. A cette fin : une (d)ébauche de moyens sans fin, un programme pour la jeunesse, un divertissement enfantin — Much Ado About Nothing [beaucoup de bruit (Hon traduit d’ados) pour rien].
« J’étais furieux de n’avoir pas de souliers ; alors j’ai rencontré un homme qui n’avait pas de pieds, et je me suis trouvé content de mon sort. » (Proverbe chinois).
Cette nuit de Chine (n.f. : Pays de rêve où l’étranger cherchant l’oubli de son passé dans un sourire a retrouvé la joie d’aimer), les spectateurs (genre pas déconstruit), l’ont partagée avec ses acteurs. Comme un divertissement à leurs conditions respectives — (dé)ca(la)ge, de verre, doré(e), sans frontière. Même confiné, Hon le sait bien : où que son regard s’égare (séjourne, voyage), les personn(ag)es rencontré[e]s parviennent toujours à exercer certaines libertés qui leur permettent de tolérer la contrainte. Comme si toute résistance offrait une consistance à l’adversité. C’est une grande consolation & un grand désespoir à la fois. De voir cette condition humaine partagée & de se dire qu’il y a toujours plus contraint que soi.
Merde in France (Masque à gaz ciao bye bye). Hon se réveille en sursaut/sueur. Alarmé comme toujours par les faux-/non-événements(, )d’ici, d’ailleurs, Hon a (ap)pris l’h-/H-istoire. En marche (what else TINA ?), les commentateurs du cru (distants) ont vu ce qu’ils voulaient savoir, et Hon l’a relayé. Cru dur comme (la dame de) fer que la démonstration de force des soldats t-/v-êtus de plastique (Made in China) était destinée à l’étranger, rien de plus. Faux : [s-/c-hips, plan(e)s, t(h)anks :] think different® : à travers le tigre, au-delà du papier (tue-mouche-moustiques-rats-moineaux), c’est la vie toute entière, quotidienne et planétaire, que vise, verrouille et t(o)u(ch)e le capitalisme autocratique et sa tentation totalitaire, à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières.
Sous le couvert de la démocratie, la république autoritaire réécrit le passé, subvertit le langage, (con)fond sphère publique et privée, intime, surveille et punit sous l’égide de son leader omnipré(sid)ent qui. Instaure une économie de guerre tournée vers la survie (« du jambon, du fromage : des choses concrètes » (Ma(c®)o(n)). Invite à « enfourcher le tigre » plus qu’à chevaucher le dragon, salue Salut (Xi, dit Ma(k)o Moulage®), avec lequel il partage en direct milli(¥)ards et masques au nez des Etats désunis d’Europe et d’Amérique, teste technologies et loi de sécurité avant de les appliquer chez lui. Nie l’universalité des droits, cantonne celle des devoirs à la maison. Sous sa tutelle, la pirotechnie est toujours avenir : entre transhumanisme et collapsologie, elle a de beaux jours devant elle, et nuit(s).
« La bombe atomique de l’esprit fait exploser la bombe atomique de la matière. » (Ma(k)o®)
Hon se lève pour de(/d’un) bon(d). En avant/arrière, c’est toujours pire qu’ici, à ce qu’on dit. Pour en avoir le cœur net, il faudrait abandonner cette idée au logis, voir ailleurs s’il y est, mais Hon ne s’en va pas (monsieur). En l’an pire de l’empire hexagonal, où l’absurdité contagieuse dépasse l’imagination asservie, Hon ne pense pas (monsieur) : Hon s’Assimil®, répète commente revote con(sta)te. L’ennemi, intérieur, est partout le même, sans qui nulle contrainte ne pourrait s’exercer : police, milices, armées, drones et balles impopulaires qui défilent pour la Fête des fantômes et défigurent les figurants. Hon est très conscient, manifeste, mais ça ne change rien. Par crainte de l’action directe et de la violence subie ou infligée, Hon n’y va pas assez, n’ose pas (« Oser lutter, oser vaincre. » souffle Ma(k)o®).
Hon parcourt les journaux, les réseaux, qui ont tant glosé, se sont tant gaussé des chiffres, ont tant et tant. Traité de l’efficacité de leur traitement avant de l’appliquer aux leur(re)s. Compté sur l’amnésie et le contrôle des populations, ali-/dé-mentant tour à tour les rumeurs de complot et le racisme ambiant. Hon se souvient de Wuhan, « la ville la plus française de Chine », berceau de l’industrie et de l’épidémie de zoonose qui co-vide désormais les villes avec l’appui des autorités. Debout devant son frigo fabriqué par des esclaves Ouïghours et rempli d’animaux morts, Hon, attiré par un magnet, décroche la carte postale reçue il y a des mois où figurent deux jeunes filles, un vieil homme en vélo. Entre eux/deux âges, un autre personnage d’origine asiatique consulte son mobile au pied d’un monument d’architecture soviétique.
Hon retourne la carte, comme au jeu de memory, s’attend à découvrir Beijing, survole et lit : « Je t’écris de Tiranë, Shqipëria, au cœur des Balkans. Le Musée National Historique, avec sa mosaïque monumentale, est inspirée du réalisme socialiste. A sa droite, le Palais de la Culture a été achevé par des architectes envoyés par Ma(k)o®. Entre les deux, le building de l’hôtel international communiste. Derrière moi, l’hôtel de ville fasciste. A sa gauche, une mosquée et une tour ottomane restaurée par la Chine. La place Skanderberg, héros de l’indépendance, a été rénovée par un cabinet français dans une vision européenne de la capitale ». Hon repose la carte, sépare mentalement les images décrites, les mélangent à la manière d’un puzzle, tout s’ajoute, mais rien ne s’agence avec ce qu’Hon a apprit.
« La critique littéraire et artistique comporte deux critères : l’un politique, l’autre artistique. » (Ma(k)o®)
Pour comprendre quelque chose, quelqu’un, quelque part, il faudrait toujours commencer au lieu de finir par. Deviner qui est Hon, qui on est et d’où on parle, qui s’a-g/l-ite, but(t)e sur les m-aux/ots. D’une expérience/perception par essence fragmentaire, presser un réel ré-(/)un(/)-ifié d’apparaître à travers la profusion de ses réalités toute(s) relative(s), malgré la confusion et la sidération, la fascination et l’impuissance qu’elle(s) génère(nt). Appliquer au H de l’Histoire, aux aléas de l’actualité, le traitement pro-pédeu-/-phylac-tique d’une critique littéraire qui distingu-/analys-/erait l’effet des faits, (dé)li(e)rait pensée et l’action, praxis et poïèsis. Sortir du mauvais rêve/sort de la dialectique, des crises qui nous séparent, divisent, substituent l’avis à la vie, pour aspirer à la (dé)construction, entre critique et création, vers et fruits, remède et poison, d’une po-é/-li-tique digne de ce nom.
En attendant, tant qu’Hon ne parviendra pas à s’extraire, Hon n’aura rien vu, com/-ap-/-pris, ou plutôt si : tout ça c’est du chinois, vu d’ici.
Crédit photo : ©Huang Gang, 16 Mao (résine peinte), 2005