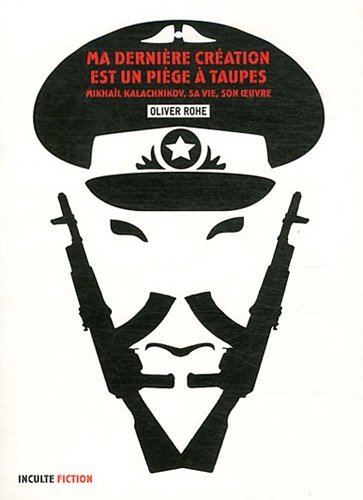Maire Simon. Les pieds nus. Note de lecture
Le genre de l’intime est l’un des plus difficiles à faire vibrer sur une page — mais il convient parfaitement au récit. Au récit en tant que genre, je veux dire, c’est-à-dire : qu’écrire touche au désir, comme à l’angoisse ou à la folie, bref ce que tentent de tenir quelques pages reliées dans un petit parallélépipède très serrés, très carré, très circonscrit, c’est toute l’exubérance du monde.
Monde, au fait, quel est-il, quel pourrait-il être ? Quel pourrait être un monde dans lequel l’être aimé disparaît, a disparu ? Ce monde est impossible et c’est ce monde-là que Marie Simon cherche à nommer ou à désigner au travers de pages frappantes de retenue et de puissance.
Spectaculaire : non pas dans le sens d’une intimité dévoilée — et de l’obscénité qui en découlerait, mais spectaculaire dans le sens de la remarquable construction chorégraphique, a-t-on envie de dire.
Au moment où l’impossible fait irruption dans cette histoire simple : un homme, une femme, leur amour ; l’homme disparaît ; au moment où fait irruption cette mort (qu’il faut encore décrire, circonscrire), au moment où l’impossible vient recouvrir le récit de sa poisse morbide, hiatus.
Deuxième partie, déjà. Toute la première est là pour poser le cadre, pour décrire la solennité et la complétude de cet amour. De la rencontre, de l’apprivoisement, de la jalousie peut-être (dit-on ça et là). Mais peut-être pas.
Avant nous étions trois à nous disputer ton amour. Je ne sais comment j’ai réussi. Peut-être que ce n’est pas moi. Elle a disparu ou tu l’as quittée, ou elle est partie. Je ne sais plus. Je savais que ça arriverait. Reste à trouver ce qui nous sépare encore. (24)
Et plus loin :
Très vite, elle n’est plus là. Cassée dégagée, partie. Sortie. Est-ce qu’elle nous aliés ou séparés ? Tu es là maintenant. Reste la mer. (36)
Le hiatus était déjà désigné, la construction est habile, et peut-être effectivement que ce n’est pas elle :
Tout est en train de filer et je dois fixer en même temps ces choses ce début le matin la soirée — je me disperse mais je sais que je dois les mémoriser — laissez-moi connards connasses — je suis seule.
La narratrice, l’amante, l’aimante, est seule, et seule depuis le début du livre, c’est-à-dire depuis le début. Tout l’art et la tâche, difficile, sera de rendre la mémoire, l’hommage rendu à son amour disparu, Quentin, marin de son état (voir la litanie des « Mon mec… », p. 43-47).
On est déjà surpris, désorienté peut-être, par la simplicité de cette situation : il est marin, il disparaît en mer. La mer a pris l’homme à la femme (son épouse) qui l’aime. On est ensuite touché de la sincérité du texte. Et de sa (sans doute, inhérente) violence.
Cet amour débordant qui opère sur la narration même.
Je chantonne je suis ton seul livre je suis ton seul livre. Parce que je n’aime pas ce que tu lis. Ou que tu ne lis pas. D’ailleurs tu ne lis pas. Tu vois, je suis ton seul livre. (24)
C’est qu’un monde se brise, et avec lui cette unité.
Obnubilée par l’amour — ce qui n’est pas un reproche ici — cette femme amoureuse s’en remet au récit. Or le récit ne l’entends pas de cette oreille. Il porte le hiatus, il a faim de séparation. Il est mer, lui-même, fatal, inexorable.
Je sais que c’est en train de filer je sais que je ne peux pas tout savoir me souvenir de tout que tout sera cher et rare très vite juste une chose juste une phrase juste une attends s’il te plaît dis-moi […] (47).
On ne résiste pas au récit. Et la phrase pas plus que les humains. La suite est d’autant plus touchante que la vérité de la mer (la vérité du récit) a parlé. Il n’y a pas d’issue possible, on ne peut lutter contre les vagues, la chaîne des évènements, contre le flux du récit.
Les pages de la seconde partie sont hantées. Bien que ce soit la vie, qui a été choisie (je ne resterai pas sans bouger, nous dit-elle), cette vie est fantomatique, elle est celle d’un revenant.
Parce que la mer loin, et surtout parce que je t’ai tenu contre moi, tout mouillé, tout vulnérable, tout pâle — mort. (99)
Il n’y a pas d’issue possible, l’amour se brise net, comme le récit de l’amour qui le porte. (Je suis seulement mal habituée, dit elle encore).
Puisque tu ne le peux plus, c’est à moi de te raconter des histoires. (91)
On cherche une autre lieu, on cherche un autre corps, on tente de se distraire, de s’occuper l’esprit. Mais ça ne marche pas. C’est toute la troisième partie qui en vérité revient toujours sur le passé.
J’espérais autre chose (112)
Et surtout :
Le temps ne passe pas.
C’était pourtant écrit, elle l’avait même dit, cette amoureuse, cette aimante excessive, c’est elle qui l’écrit.
En fait, je serai toujours ta femme. (56) Et la page suivante : Tu es encore MON mari.
Nous ferons ce petit voyage dans l’intimité. Pas d’indiscrétion pas de larmes pas d’invités. Rien que des remous et de l’iode. J’ai peur, mais je ne le montre pas. Tu dois avoir encore plus peur que moi. Toi et moi. Je serai près de toi, contre la boîte […] Ce sera bien presque. A un moment, on me l’a dit, tes amis se tourneront vers moi. Ça voudra dire que c’est maintenant. Et ce sera trop court. Je t’embrasserai, et encore. Encore ce matin, encore toi et moi dans le matin, devant l’eau. Tes amis regarderont ailleurs. Et puis ils te soulèveront et moi j’enlèverai mes chaussures et les tiendrai serrées contre moi et puis ils te mettront à l’eau. Ce ne sera pas triste, non, certainement pas. Toi et moi. Parce que nous nous reverrons, nous nous retrouverons et nous nous embrasserons, comme d’habitude. Ce ne sera pas vraiment fini. Tu es mon mari, j’ai mis une robe, et je t’aime. (67-68)
Pieds nus, pourquoi pas, pour dire que ça y est, on a passé le hiatus. Mais ce n’est pas ça qui compte, pour moi.
Je pense à une jeune femme qui aurait cherché dans sa vie les traces tangibles de ses rêves. Elle aurait écrit et, prise par le récit, aurait petit à petit, très subrepticement, sans s’en rendre compte le moins du monde, elle l’aurait quitté, ce monde, et ce monde : elle ; comme il est écrit dans Tristan et Iseult.
Moi aussi je voudrais que tu me racontes une histoire. (128)
Elle aurait touché par extraordinaire le rêve de sa peau nue, puis le rêve s’est évanoui, et tout le réel serait alors cette recherche, cette recherche insensée, éperdue, vers son amour disparu. Elle l’aurait cherché dans le sommeil comme dans la mort. Elle aurait écrit. Elle se serait, tout simplement, endormie. Elle se serait tue. Elle aurait attendu, puis écrit (145).
C’est en ce sens que la vie n’est qu’un songe, une fable mensongère, ou encore une histoire racontée par un idiot, comme le dit Macbeth.