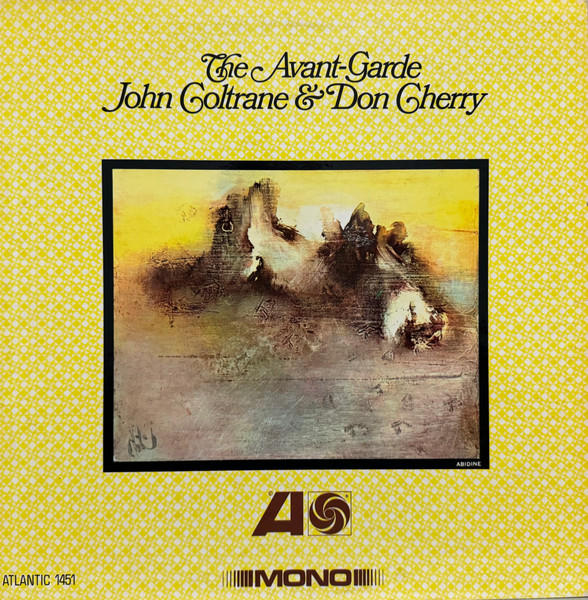Ceci n’est pas une erreur 404.
Probablement mal connu en France, Battiato est l’un des auteurs italiens les plus singuliers et respectés qui soient (au niveau de Conte, de Andrè, Gaber, et probablement un peu plus : Janacci), et dont la disparition récente a permis de montrer l’attachement fort de ses compatriotes à ses excursions musicales souvent “désappointantes”. Portant très haut la foi en la chanson populaire, et ne rechignant jamais, ô grand jamais, à des expérimentations et des hybridations audacieuses, il serait, pour le public français, un peu comme un Christophe plus hardi, pour un anglo-saxon, un Harry Nilsson plus enflammé. Mais les comparaisons n’ont jamais raison, et Battiato ressemble surtout à Battiato : “dentro di me vivono degli organismi che non sanno di appartenere al mio corpo, io a quale organismo appartengo?” Une voix aiguë qui peut à la longue ennuyer, et de très forts positionnements soniques, à la limite de l’avant-garde.
Dans ce disque pourtant, son deuxième, c’est une enveloppe nettement progressive qui voit le jour, comme le démontre le morceau phare Areknames (qui se prononce [â-rék-na-mès], et dont le texte est lisible, à l’envers : “Sisopromatem ereitnorf alled etnem”, le dernier vers, peut en effet être *Mente della frontiere metamorposi S…, et “Areknames”, *Se mankera) qui ferait rougir un Tangerine Dreamer par l’usage accompli des synthétiseurs. Avec Beta, c’est plus vers une espèce de tissu floydien qu’on se dirige (basse, guitare, chant et piano… basse surtout, très Atom Heart Mother). Plancton est figuratif, y compris au niveau du texte, et mêle donc guitare et synthés, folk et progressif allégrement, et Pollution un peu trop explicatif, sans nier toutefois les liens à la chanson italienne (ce chant parlé et vindicatif), voire au classique.
C’est donc un drôle de disque, mais un disque assez cohérent, et qui marque le décalage que représentera par la suite toujours plus l’art de Battiato (“del ritmo magnetico sole-terra, per poter deviare l’umanità dalla catastrofe in cui sta per precipitare” lit-on dans le Manifesto funebre) qui est déjà un peu trop conscient de l’ironie de tout ce cirque. Les pleurs finaux hallucinés, mêlés de plages et de samples classiques, en conviennent.
Il faut de ce pas écouter d’autres albums. Nous verrons ce que nous prépare le hasard.